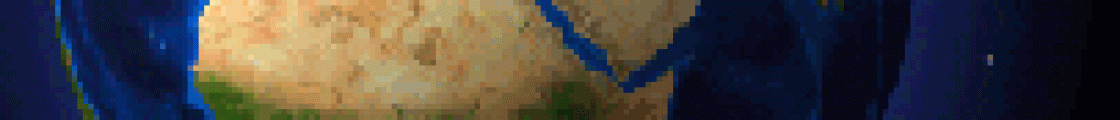Les mutations géopolitiques engendrées par l’effondrement du système bipolaire et les transformations économiques et sociales induites par la globalisation et la révolution de l’information et de la communication posent indiscutablement de nouveaux défis à la communauté internationale. Aucun observateur sérieux ne saurait nier l’impuissance des Etats de la planète à assumer correctement la mission de régulation des conséquences des mutations en cours. Qu’il s’agisse de la sauvegarde de la sécurité et de la paix ou de la lutte contre la pollution, la pauvreté, la grande criminalité ou le terrorisme, les Etats s’avèrent incapables de faire face à des défis qui dépassent désormais largement les frontières nationales et régionales.
Le malaise ressenti par les acteurs de la scène internationale dans leur diversité peut se résumer dans la problématique suivante: on voit bien que les Etats-nations sont désormais incapables de faire face aux nombreux défis qui menacent la cohésion sociale sur laquelle reposent leur pouvoir et leur légitimité mais en même temps il n’existe pas encore de véritable pouvoir supranational alternatif. Entre temps, les mouvements sociaux alternatifs, dont font partie les ONG qui activent sur les nombreux terrains de l’humanitaire, sont divisés sur la question de savoir s’il faut tout simplement résister à la mondialisation qui déstructure les sociétés et désarme les Etats ou bien aller de l’avant en cherchant à lui imprimer une autre orientation plus humaine et plus solidaire.
Entre l’attachement illusoire à un « souverainisme » fatalement dépassé par les évènements et la dérégulation effrénée des prophètes de l’ultra-libéralisme triomphant, n’y aurait-il pas une autre issue à la fois plus réaliste et plus juste? Une telle issue serait fondée sur une limitation des sacro-saintes lois du marché et de la force par un contre-pouvoir qui soit en même temps sur la même longueur d’onde que les défis qu’il est censé relever, c’est-à-dire à l’échelle planétaire. Or qui mieux que l’ONU serait en mesure de réunir le consensus des acteurs de la scène internationale lorsqu’il s’agira d’envisager des actions à la hauteur des défis posés aujourd’hui à la communauté internationale ?
L’ONU : UN CADRE INCONTOURNABLE
Quels que soient les reproches qu’on peut aujourd’hui adresser à l’ONU, il faut convenir que cette institution imparfaite constitue la seule alternative viable à la crise actuelle des relations internationales. En effet, ni les Etats-nations fragilisés par la mondialisation des marchés et des entreprises ni les constructions régionales en mal de politique étrangère et de sécurité commune ne semblent armées pour faire face aux défis posés. Il reste l’unilatéralisme de l’hyper-puissance américaine qui peut faire encore illusion. Mais au vu de l’impasse vers laquelle semble se diriger la dernière aventure de cette puissance en date en Irak, il est d’ores et déjà permis d’émettre de sérieux doutes quant au réalisme de cette solution qui risque de compliquer les problèmes au lieu de les résoudre. On ne comprendrait pas autrement le revirement de la diplomatie américaine et la fourbe intention de l’administration US d’impliquer enfin l’ONU dans la gestion des conséquences d’un conflit qu’elle n’a pas hésité à déclencher de manière unilatérale. En effet, l’incapacité à entraîner dans leur politique aventuriste l’ONU a poussé les USA à contourner cette dernière et à faire cavalier seul avec les résultats que l’on connaît. Si au moment même pareille décision avait conduit certains observateurs pessimistes à conclure hâtivement à la fin de l’ONU, il a suffi quelques mois pour que tout le monde – y compris les USA- se rende compte que la politique unilatérale américaine dans cette région est vouée à l’échec et que l’implication de l’ONU reste une option incontournable même si les différentes parties divergent sur les conditions et les modalités d’une telle implication.
Il faut donc se garder de tirer de faux enseignements des tentatives répétées de contourner l’ONU ou de diminuer ses pouvoirs de la part d’une super-puissance grisée par un triomphe plus lourd de responsabilités que de dividendes. Comme l’a rappelé judicieusement l’ancien secrétaire général de l’ONU, J.Perez de Cuellar : « L’ONU de l’an 2000 doit être très différente de l’organisation actuelle. Mais il n’est pas nécessaire de créer quelque chose d’entièrement nouveau sans tenir compte de ce qui existe. Le grand mérite de l’ONU est justement d’exister et de fournir une base de départ pour la construction de la paix. Il serait donc tout à fait déraisonnable de repartir à zéro. Ce qui est nécessaire, ce sont des aménagements, des constructions complémentaires, des destructions de parties inadaptées pour les remplacer par de nouvelles, plus modernes et plus fonctionnelles. Il s’agit donc d’une réforme en profondeur de l’institution existante ».
Ce diagnostic rejoint celui des experts qui ont eu à se pencher sur la crise de l’ONU. Tout en reconnaissant que « L’ONU traverse aujourd’hui une crise de légitimité », M .Lefebvre a dressé un tableau assez réaliste d’une organisation qui reste incontournable sur la scène internationale : « Il faut sans doute relativiser les appréciations pessimistes portées aujourd’hui sur ce que le général de Gaulle aurait un jour désigné péjorativement comme le « machin ». L’ONU ne peut prétendre à ce qu’elle n’est pas : un gouvernement mondial, chargé de faire respecter le droit international et d’organiser harmonieusement le développement de la planète. L’ONU est entre les mains des Etats, ce qui signifie qu’elle peut être aussi bien le jouet des puissances que l’instrument de la sécurité collective et de la coopération planétaire…L’ONU n’est rien sans les Etats mais les Etats ne peuvent pas grand chose sans l’ONU. Son rôle dans le développement considérable du droit international, sa contribution multiple à l’accroissement de la coopération internationale, sa participation au règlement de nombreux conflits, et par-dessus tout sa fonction de tribune pour le dialogue entre les Etats du monde, font que l’ONU un instrument malgré tout irremplaçable de la société internationale » (M. LEFEBVRE, 2000, 213).
La gestion de la crise irakienne peut constituer un bon test pour l’ONU. D’un côté, les Etats-Unis cherchent à impliquer l’ONU dans cette crise pour à la fois se donner la légitimité internationale qui leur manque et forcer la main aux pays qui rechignent à participer dans les opérations de maintien de l’ordre en Irak. D’un autre côté, les hésitations de l’ONU et des puissances récalcitrantes posent deux questions essentielles: sous quel commandement, américain ou international, agiraient les forces engagées dans ce pays? La communauté internationale sera-t-elle partie prenante dans la gestion politique de la crise? La réponse à ces deux questions détermine pour une large part l’évolution ultérieure des évènements dans cette région du monde. Or, il est irréaliste de s’attendre à une réponse satisfaisante tant que la communauté internationale ne s’est pas résolu à donner à l’ONU les moyens d’agir de manière conséquente pour faire respecter les exigences légales et légitimes inscrites dans sa Charte fondatrice. La question des moyens est loin d’être une simple question technique. Sa résolution appelle une réforme structurelle profonde de l’ONU.
REHABILITER LE CONCEPT DE « SECURITE COLLECTIVE »
oute réflexion sérieuse sur la nécessaire réforme de l’ONU doit partir du principe qui consiste à approfondir ses deux vocations historiques premières qui sont par ailleurs intimement liées: sa vocation d’organisation universelle et sa vocation pacifiste. Le préambule de la Charte de l’ONU rappelle cette double vocation en insistant sur la préservation des générations futures du fléau de la guerre qui a infligé à l’humanité des souffrances indescriptibles. Le maintien de la paix devait être assuré par deux moyens essentiels: un moyen direct représenté par la sécurité collective et un moyen indirect représenté par le respect du droit des peuples à l’autodétermination et à la prospérité partagée. Le premier fut tant bien que mal assuré par l’équilibre de la terreur qui a conduit, durant la guerre froide, les deux blocs stratégiques à contenir les conflits locaux qui ont déchiré le tiers monde dans des limites compatibles avec la paix mondiale. Le second, en revanche, a été contourné durant de longues décennies avec pour conséquence l’accumulation de graves déficits humains générateurs de frustrations et de tensions dans un hémisphère sud devenu subitement la source principale de toutes les menaces réelles et imaginaires. La réhabilitation de ces deux moyens incontournables constituera le fil conducteur de notre réflexion pour une réforme de l’ONU.
La Charte de l’ONU stipule explicitement que le maintien ou la restauration de la paix est assuré par la mise en œuvre des mécanismes de ce qu’on appelle la « sécurité collective ». Par « sécurité collective », on entend le procédé suivant lequel la communauté internationale se ligue contre celui qui se sera d’emblée auto-exclu en rompant la paix qui doit régner au sein de cette communauté. Si lors de la première guerre du Golfe (1991), les apparences étaient sauves et laissaient penser à une opération internationale de restauration du droit et de la paix avec la bénédiction de l’ONU, il en a été autrement lors de la dernière guerre qui a été vécue par une grande partie de l’opinion publique internationale comme une guerre d’agression d’une grande puissance contre un pays du sud affaibli par douze années d’embargo criminel.
Bien entendu, la Charte de l’ONU a prévu des conditions pour la mise en œuvre de la « sécurité collective » qui soient à la fois réalistes et conformes au droit international. Il est irréaliste de s’attendre à une application à la lettre de cette « sécurité collective » au moyen par exemple d’une participation égale de tous les membres de la communauté internationale contre l’un ou l’autre Etat coupable d’une atteinte grave à la paix mondiale. En vertu de la Charte de l’ONU, la responsabilité directe du maintien de la paix incombe principalement aux grandes puissances qui forment ainsi une sorte de « gouvernement de fait ». Ce dernier trouvera néanmoins sa légitimité dans l’universalité des objectifs recherchés : « C’est un gouvernement de fait de la collectivité internationale, à la manière de ce que fut par exemple la Sainte Alliance, mais une sainte alliance universelle, qui n’agirait pas au profit de quelques uns mais dans l’intérêt de la collectivité tout entière et su la base des principes qu’elle s’est elle-même donnés » ( P.REUTER, J.COMBACAU, 1985, 329) .
Mais pour éviter l’arbitraire absolu, ce gouvernement de fait ne peut agir que comme « gouvernement conjoint ». Faute de mieux, c’est-à-dire un gouvernement mondial légitime qui demeure pour l’immédiat une utopie, les promoteurs de l’ONU ont eu recours à la notion de consensus entre les membres de ce gouvernement de fait que sont les membres permanents du Conseil de Sécurité. D’où l’importance capitale du veto dans les délibérations de ce Conseil. La possibilité qu’a chacun des cinq membres du Conseil de Sécurité d’opposer son veto à toute décision indique qu’il ne saurait y avoir de décision importante concernant le maintien de la paix à l’encontre de la volonté de l’un ou l’autre membre de ce gouvernement mondial de fait. Durant la guerre froide, cet équilibre des forces entre les puissances a permis aux autres membres de la communauté internationale une certaine marge de liberté qui explique notamment le fait que la plupart des pays en développement ont réussi à s’organiser dans un bloc dit des non alignés afin de défendre leurs intérêts.
Mais depuis la chute du mur de Berlin, la situation des relations internationales est devenue plus complexe. Le spectre d’un affrontement stratégique aux conséquences incalculables entre les deux blocs a heureusement disparu mais c’est pour laisser place à une gestion des tensions qui déchirent certaines régions du monde qui rappelle la politique de la canonnière ayant accompagné l’aventure expansionniste des anciens empires coloniaux. Confronté aux défis énormes de la transition, les membres du Conseil de Sécurité dont on pouvait attendre une réaction énergique contre la nouvelle tendance impériale américaine, en l’occurrence la Russie et la Chine, n’ont pas utilisé leur veto lors de la crise de 1990-91. En 2003, les USA ont carrément contourné le cadre de l’ONU pour avoir les mains libres dans une opération qu’ils ont planifiée dès le départ de manière unilatérale dans une perspective néo-impériale, surtout qu’entre-temps, une autre puissance, membre permanent du Conseil de Sécurité, la France, a rejoint le camp de ceux qui pensent que cette fois-ci, contrairement à 1991, la guerre n’avait pas de raison d’être.
CINQ AXES POUR UNE REFORME DE L’ONU
L’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui la communauté internationale en Irak avec les conséquences graves qui pourraient en résulter au niveau de toute la région posent l’urgence d’une réflexion sérieuse sur les causes qui ont conduit à cette situation pour en tirer des enseignements et des propositions de réforme susceptibles d’améliorer les mécanismes juridico-politiques de la « sécurité collective ». Nous retiendrons cinq axes essentiels : 1) la question du veto, 2) l’élargissement du Conseil de sécurité 3) l’équilibre institutionnel au sein de l’ONU 4) le renforcement de la capacité de l’ONU, 5) l’extension du champ d’intervention de l’ONU.
1. La question du veto. En vertu des textes fondamentaux de l’ONU, la question du maintien de la paix par la mise en œuvre des mécanismes de la « sécurité collective » obéit au principe du consensus des membres permanents du Conseil de Sécurité. C’est par un glissement graduel dans les usages internationaux que l’abstention lors du vote des décisions importantes du Conseil de Sécurité a été assimilée à une sorte de non-opposition de fait à la décision qui sera finalement prise au nom du Conseil. A titre d’exemple, l’abstention de la Russie et de la Chine lors du vote du Conseil de Sécurité ayant autorisé le recours à la force contre l’Irak en 1990 a été assimilée à un accord tacite même si ces deux puissances n’ont pas participé militairement à l’opération « tempête du désert » déclenchée en février 1991 sous commandement américain. La question se pose de savoir si un retour à la lettre des textes de l’ONU qui obligerait les membres du Conseil de sécurité à voter par oui ou par non à toute décision importante relative au maintien de la paix ne responsabiliserait pas plus les membres du Conseil devant la communauté internationale.
L’objection à une telle option est qu’elle risque de paralyser le fonctionnement du Conseil et conduire certaines puissances à agir en dehors du cadre légal de l’ONU. Mais au vu de la situation actuelle qui voit les USA s’entêter à agir unilatéralement, le retour à un consensus explicite ne saurait aggraver les choses mais contribuerait à mettre les grandes puissances devant leurs responsabilités. La responsabilisation des membres du Conseil s’avère d’autant plus impérieuse et urgente que l’unilatéralisme américain semble, à l’épreuve du cas irakien, voué à l’échec dans la mesure où ce sont les USA qui sont aujourd’hui demandeurs d’une implication de l’ONU dans ce conflit, après s’être rendu compte de leur impuissance sur le terrain.
2. L’élargissement du Conseil de Sécurité. Si on ne voit comment faire autrement que de laisser la question du maintien de la paix du ressort du Conseil de Sécurité, cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’amélioration à introduire au système. Depuis la fondation de l’ONU, le monde a évolué. Le processus de décolonisation a eu pour résultat de renforcer la communauté internationale par l’adhésion de nouveaux membres. De nouvelles puissances régionales ont vu le jour sur tous les continents. Il est naturel que de nombreuses voix se soient élevé ces dernières années pour appeler au renforcement du Conseil de Sécurité par l’adhésion de nouveaux membres plus ou moins représentatifs des différentes régions du monde comme l’Allemagne, le Japon, l’Inde, le Brésil et le Nigéria ou l’Afrique du Sud. Sans donner des garanties absolues, un pareil élargissement du Conseil de Sécurité aurait pour effet certain un rééquilibrage de la balance des pouvoirs qui ne pourrait que bénéficier à la paix mondiale, surtout s’il est accompagné d’une plus grande responsabilisation de tous les membres comme cela a été indiqué au point précédent.
3. L’équilibre institutionnel de l’ONU. En vertu de la Charte de l’ONU, en matière de maintien de la paix, le Conseil de Sécurité exerce la « compétence principale ». En d’autres termes, l’Assemblée Générale composée de tous les membres de l’ONU ne peut intervenir tant que le Conseil s’occupe de la question. Cette division des tâches trouve sa légitimité dans l’exigence de fonctionnalité mais aussi dans l’histoire qui a présidé à la constitution de l’ONU. Les puissances victorieuses de la seconde guerre mondiale qui ont le mérite de défaire le nazisme sont sorties auréolées de ce combat et ont en profité pour se constituer en gouvernement mondial de fait même si l’alliance n’a pas survécu à la guerre froide. L’équilibre institutionnel entre le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale qui était au départ compréhensible ne tarda pas à être remis en question dans les forums internationaux par la majorité des Etats du Tiers Monde qui ont rejoint l’ONU dans les années 50 et 60, notamment à la faveur du mouvement de décolonisation. Jusqu’au milieu des années 50, ce sont principalement les USA qui cherchaient à valoriser le rôle de l’Assemblée générale dans la mesure où ils pouvaient y compter sur la sympathie de la majorité des membres. On se souvient que lors de la crise de Corée, les USA n’ont pas hésité à faire adopter la résolution 377 dite résolution Acheson (du nom du représentant américain à l’ONU) en vertu de laquelle l’Assemblée générale s’est substituée au Conseil de sécurité paralysé alors par l’absence d’une URSS pratiquant la politique de la chaise vide.
Mais dès la fin des années 50, la tendance s’est inversée. L’adhésion de nouveaux membres, pour la plupart appartenant au Tiers Monde allait indisposer les USA et leurs alliés occidentaux. Ce sera au tour de l’URSS de chercher à s’appuyer sur l’Assemblée générale pour contre-carrer les puissances occidentales (USA, Grande Bretagne, France) qui pouvaient se servir de leur droit de veto pour barrer la route à toute décision contraire à leurs intérêts stratégiques. Cela n’a pas manqué de soulever les objections des juristes qui voient d’un mauvais œil une Assemblée représentant la « plèbe » internationale se substituer ainsi à l’ « aristocratie » des membres permanents du Conseil de sécurité : « Que la résolution 377 soit grossièrement inconstitutionnelle, peu importe ici, où l’on ne s’intéresse qu’au mécanisme qu’elle aspire à mettre en place. Elle se présente comme une réadaptation du procédé de la sécurité collective aux circonstances nouvelles qui empêchent l’utilisation de celui prévu par la Charte …En réalité, la substitution d’un organe à l’autre n’est pas un incident secondaire, elle porte atteinte à la nature même du système de maintien de la paix. La sécurité collective de la Charte est indissociable de la décision conjointe des Cinq grands, parce que c’est elle qui garantit son impartialité ; que le Conseil soit dessaisi, que par conséquent l’action puisse se déclencher en dépit de l’opposition d’un membre permanent, et l’ONU devient un instrument aux mains de la majorité : ce n’est plus la « sécurité collective », qui, par essence, était orientée « tous azimuts », c’est tout au plus une banale alliance » (P. REUTER, J. COMBACAU, 1985, 397).
On remarquera ainsi que la question de l’équilibre institutionnel au sein de l’ONU n’a pas obéi à des considérations de principe mais a, au contraire, oscillé au gré des intérêts fluctuants des grandes puissances. Si on en reste sur le seul plan théorique, les partisans des deux camps risquent de faire valoir des arguments tout aussi valables. Il n’est pas réaliste de laisser une question aussi vitale que celle concernant le maintien ou la restauration de la paix à la seule discrétion d’une Assemblée générale qui risque face à des crises graves de montrer au grand jour sa division et son impuissance. D’un autre côté, aucune considération morale ou juridique ne saurait justifier que des puissances de fait, en l’occurrence les membres permanents du Conseil de sécurité s’arrogent le droit de décider en elles, contre l’avis de la majorité des nations du monde, du sort de la guerre et de la paix.
La question de l’équilibre institutionnel au sein de l’ONU pourrait un début de solution si on se place d’un point de vue pragmatique. Au lieu de poser la question comme s’il n’existait tout simplement que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, le débat gagnerait à être élargi à une autre perspective : le Conseil de sécurité pourrait continuer à exercer une compétence principale en matière de maintien de la paix mais en étroite concertation avec les organisations régionales directement concernées par le conflit. Cela signifie que l’ONU pourrait jouer un rôle plus dynamique dans le renforcement de ces organisations régionales au lieu de se contenter de constater de temps à autre leur incapacité à régler le différend qui leur est soumis. Comme on le sait, l’absence d’une politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne et la faiblesse structurelle de la Ligue des Etats arabes ont toujours servi à justifier l’interventionnisme unilatéral américain dans le cadre de l’OTAN.
Bien entendu, les problèmes qui empêchent les organisations régionales de jouer leur rôle ne sont pas les mêmes. Il faut analyser au cas par cas les problèmes et les propositions de solution. Le type de concertation et de coopération de l’ONU avec les organisations régionales devrait être adapté à chaque situation. A cet égard, les efforts actuels de certains Etats africains de doter l’Union africaine d’une force d’intervention militaire qui aurait pour rôle de contribuer à maintenir ou à restaurer la paix sur le continent devraient pouvoir bénéficier du soutien politique et moral de l’ONU. Quelles que soient les raisons invoquées, l’impossibilité d’agir à l’échelle internationale dans le cadre consensuel du Conseil de sécurité ne saurait interdire une action régionale légitime bénéficiant de l’accord de la majorité des Etats appartenant à la région concernée par le conflit. D’ailleurs, c’est le sentiment justifié d’être abandonnés à leur sort par les grandes puissances qui a poussé les Etats de l’Union africaine à réfléchir à un système régional de prévention et de gestion des conflits intra ou inter-africains.
4. Le renforcement de la capacité d’action de l’ONU. L’incapacité de l’ONU à jouer le rôle qui devrait être le sien dans la prévention et la gestion des conflits qui menacent la paix mondiale est régulièrement décriée dans les enceintes internationales et dans les médias. En revanche, la cause principale de cette incapacité est rarement soulevée. Il s’agit de l’absence de moyens conséquents susceptibles de permettre à l’organisation internationale d’intervenir là où la nécessité se fait sentir. La question est loin de se réduire à sa dimension technique comme on peut le penser à première vue. L’insuffisance des moyens financiers est sans doute réelle. La mauvaise volonté des mauvais payeurs n’est pas négligeable. Mais le véritable problème se situe ailleurs. L’incapacité de l’ONU à se doter d’une force armée spécifique d’une centaine de milliers d’hommes comme le recommandent les experts en la matière s’explique avant tout par la mauvaise volonté des Etats qui refusent de mettre à la disposition de l’organisation internationale une partie de leurs forces armées pour des raisons qui ne tiennent pas toujours à l’attachement jaloux à la soi-disant souveraineté nationale.
Doter l’ONU d’une force armée spéciale revient à enlever aux grandes puissances le dernier attribut impérial qui consiste à pouvoir intervenir seuls là où aucun autre Etat ne peut le faire c’est-à-dire en dehors de ses frontières nationales. C’est un pas vers ce qu’il conviendrait d’appeler un gouvernement confédéral mondial. Paradoxalement, ce ne sont plus les nations faibles du Tiers Monde qui ont à se méfier d’un pareil gouvernement dans la mesure où c’est aujourd’hui son absence qui est ressentie comme une menace dangereuse pour leur intégrité. Ce sont les grandes puissances qui n’ont rien à craindre de la jungle de la mondialisation anarchique qui retardent l’échéance d’une gouvernance mondiale qui passe par une réhabilitation du concept de « sécurité collective » afin de l’adapter aux mutations politiques et économiques en cours. Ce n’est donc pas un hasard si les propositions de l’ancien secrétaire général de l’ONU, Boutros Ghali, contenues dans son Agenda pour la paix de 1992, sont restées lettre morte.
Après avoir indiqué les missions de ce qui devrait être une « diplomatie préventive », Boutros Ghali a introduit une distinction entre les trois niveaux que sont le « maintien de la paix » au sens strict avec le consentement des parties, le « rétablissement de la paix » qui comprend le règlement pacifique des différends ainsi que des sanctions et l’emploi de la force et enfin la « consolidation de la paix » qui devrait prolonger les opérations réussies de maintien de la paix. Mais pour assumer ses missions dans un monde où se multiplient les catastrophes humanitaires en même temps que les tentatives de certaines puissances de se servir de catastrophes pourtant prévisibles en vue de réaliser des desseins géopolitiques inavoués, l’ONU devrait accepter des réformes de structure profondes. Ch. Zorgbibe va jusqu’à appeler à « une véritable refonte de la Charte » qui comporterait trois points : « l’établissement d’une instance indépendante d’évaluation des situations humanitaires ; l’engagement des membres permanents du Conseil de sécurité ; le retour au concept de protection d’humanité » (Ch. ZORGBIBE , 2003, 148). Cette proposition intéressante rejoint la préoccupation d’un « mécanisme global d’ingérence » exprimée par Ph. Moreau Defarges qui estime qu’ « il conviendrait d’élaborer un texte – résolution de l’Assemblée générale ? convention internationale ?- qui définirait l’ingérence légitime, ses cas et ses conditions possibles » mais sans se faire trop d’illusions au regard du destin connu par la notion d’ « agression » dans le droit international. En effet, pour Ph. Moreau Defarges, « la légitimité d’un dispositif global d’ingérence suppose un autre système international. L’Etat souverain serait englobé dans et transformé par des structures collectives, surveillant, assumant partiellement ou totalement des compétences de cet Etat : réglementation de la vie économique, protection des droits de l’homme, gestion des ressources naturelles, préservation de l’environnement » (Ph. MOREAU DEFERGES, 1997, 126).
Les voix qui s’élèvent de temps à autre pour incriminer les mauvais payeurs qui tardent à s’acquitter de leurs contributions à l’ONU passent à côté de l’essentiel. L’ONU n’a rien à gagner à courir derrière l’argent des grandes puissances qui n’auraient aucun scrupule à utiliser leur contribution –forcément sans commune mesure avec celle des nations moins riches- comme un moyen de chantage inadmissible lorsqu’il s’agira de trancher des litiges importants au sein de l’organisation internationale. Les finances de l’ONU doivent devenir l’affaire de la communauté internationale, ce qui suppose une autre approche, plus novatrice, de la question de la régulation du mouvement des capitaux à l’échelle mondiale. Au moment où les capitaux acquièrent chaque jour davantage un caractère transnational, comment le financement de la plus éminente des organisations internationales pourrait-il continuer à dépendre des Etats nationaux fussent-ils les plus puissants de la planète ? Cela nous conduit directement au cinquième axe de la réforme de l’ONU.
5. L’extension du champ d’action de l’ONU. Dès la fondation de l’ONU, la question de la paix était intimement liée à celle de la justice. Il est vrai que la différence radicale des systèmes en compétition dans le cadre de la guerre froide ne pouvait que réduire la dernière question à sa dimension rhétorique puisque chacun des deux blocs pouvait interpréter librement à l’intérieur de ses frontières reconnues l’exigence universelle de justice. Cependant, l’arrivée sur la scène internationale de jeunes pays anciennement colonisés et en quête d’une redistribution plus équitable de la richesse mondiale a permis de poser la question sous un nouvel angle. Au-delà des clivages idéologiques inhérents à la guerre froide, les pays en développement ont émis le vœu d’un nouvel ordre économique international plus juste. Mais le plus important est que ces pays ont osé remettre sur la table le lien indissoluble qui existe entre la paix et la sécurité internationales d’une part et le développement de l’autre. L’arrogance qui a gagné les chantres du néo-libéralisme mondial au lendemain de l’effondrement du bloc soviétique semble pour le moment renvoyer aux calendes grecques l’espoir d’un nouvel ordre économique international. L’insistance des Nations Unies sur la nécessaire extension du concept de « sécurité internationale » qui devrait englober les facteurs économiques, environnementaux et humains qui la conditionnent largement comme cela a été rappelé judicieusement en 1994, dans le Rapport mondial sur le développement humain du PNUD reste malheureusement cantonnée dans les forums internationaux sans autre conséquence pratique.
La corrélation entre mal-développement et insécurité n’est pas toujours évidente comme le souligne P.de Senarclens. Mais par delà les effets de surface, la dérégulation qui accompagne le processus de mondialisation ne manque pas d’inquiéter les plus convaincus parmi les défenseurs de l’économie libérale comme en témoigne la peur qui a gagné les milieux de la finance internationale au lendemain du crash asiatique ou argentin. Au vu de l’incapacité structurelle des Etats nationaux à faire face à des problématiques et des crises par définition transnationales, la question ne saurait être posée sérieusement que dans un cadre mondial. On ne voit pas comment des organismes spécialisés comme la Banque mondiale ou le FMI ou encore un cadre comme l’OMC pourraient réussir à assumer une double fonction de contrôle et de régulation des effets sociaux, politiques et sécuritaires de la mondialisation si par ailleurs la seule organisation universelle qui représente l’ensemble des nations de la terre est confinée à un statut de forum sans pouvoir conséquent. La meilleure preuve que les organismes spécialisés ne sauraient suffire est qu’à chaque crise d’envergure, c’est un autre cadre à caractère politique comme le G 8 qui a eu à trancher. Or, il n’est pas sain que ce dernier se substitue de fait à l’ONU dans la gestion des affaires mondiales comme s’il s’agissait désormais du véritable gouvernement mondial de fait, mais avec un lourd handicap lorsqu’il s’agira d’affronter des crises internationales majeures dans la mesure où il ne dispose pas d’une légitimité internationale suffisante.
Seule une extension du champ d’action de l’ONU aux matières politiques, économiques et sociales qui mettent en jeu indirectement la paix et la sécurité internationales, sur la base d’un accord de l’ensemble des Etats membres de la communauté internationale ouvrirait la possibilité d’une véritable régulation mondiale des effets de la globalisation en cours. Pour cela, l’ONU devrait pouvoir compter sur des organismes internationaux réformés pour l’occasion. Les fonctions et pouvoirs du Conseil économique et social tels qu’ils étaient prévus dans le chapitre X du texte de San Fransisco sont aujourd’hui dépassés par le phénomène de la globalisation des marchés. En effet la mission qui consiste à commander « des études et rapports sur des questions internationales dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes » en vue d’adresser « des recommandations sur toutes les questions à l’Assemblée générale, aux membres de l’Organisation et aux institutions spécialisées intéressées » telle qu’elle a été rappelée par l’Article 62 devrait être élargie à des missions d’enquête et de contrôle autrement plus conséquentes. Maurice Bertrand qui a passé dix-sept années au service de l’ONU à Genève a conclu que « pour corriger l’émiettement et les contradictions, il faudrait inventer des structures nouvelles qui rendraient le service essentiel qu’on peut attendre d’une organisation mondiale : aider à la coordination de l’aide en vue d’un développement intégré » ( M. BERTRAND, 1985).
Même s’il n’est pas nécessaire d’envisager une « ONU économique » à côté ou à la place de l’actuelle organisation internationale, la préoccupation reste actuelle. Le même diagnostic a été tenu par l’ancien secrétaire général de l’ONU, J. Perez de Cuellar : « Il n’existe pas actuellement aux Nations Unies d’organe intergouvernemental représentatif qui soit apte à donner des conseils autorisés aux Etats membres et aux organisations du système des Nations Unies sur les priorités des programmes mondiaux, la répartition des responsabilités et l’utilisation des ressources destinées à l’assistance. La plupart des institutions spécialisées et certains des organismes de l’ONU elle-même ont des organes directeurs qui siègent au niveau ministériel. Pourtant, le Conseil économique et social, qui est chargé par la Charte de coordonner les activités économiques et sociales du système et de formuler des politiques en la matière, n’est pas composé de représentants de rang aussi élevé. J’estime qu’il faut remédier à cette situation. Pour atteindre à l’efficacité optimale, le Conseil pourrait devenir, en fait, un Conseil des ministres des affaires économiques et sociales qui aurait qualité pour examiner les plans à moyen terme ou les documents équivalents de tous les organismes du système, et qui contribuerait ainsi à assurer une utilisation rationnelle des ressources à la lumière des priorités mondiales qu’il aurait définies et à renforcer et à harmoniser l’ensemble du système ».
Un programme aussi ambitieux suppose que l’ONU cesse de compter sur la seule politique économique des grandes puissances pour faire face aux obligations de la régulation internationale comme cela transparaît malheureusement à travers l’Agenda pour le développement de 1994 du secrétaire général des Nations Unies. Cela suppose également que l’ONU puisse compter sur la mobilisation de fonds propres. La ponction d’un pourcentage qui reste à convenir sur les bénéfices engrangés par les banques à la faveur des mouvements transnationaux de capitaux constitue une piste sérieuse à ne pas négliger. Les mouvements sociaux alternatifs qui militent pour une mondialisation à visage humain auront sans doute un rôle capital à jouer dans ce sens qui pourrait se traduire par exemple par la revendication d’une charte éthique obligeant les banques à céder volontairement un pourcentage – qui serait minime en comparaison avec leurs bénéfices- de leurs gains annuels à l’organisation internationale.
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
- BERTRAND Maurice : Refaire l’ONU, Genève, Editions Zoé, 1986
- BERTRAND Maurice : « Pour une organisation mondiale de troisième génération », Le Monde diplomatique, octobre 1985.
- CUELLAR (de) J.Perez : communiqué de presse 7/87, Paris, Centre d’information des Nations Unies, 1987.
- GHALI Boutros : Agenda pour la paix, 1992.
- GHALI Boutros : Agenda pour le développement, 1994.
- JOUVE Edmond : Relations internationales, Paris, PUF, 1992
- LEFEBVRE Maxime : Le jeu du droit et de la puissance, Paris, PUF, 1997.
- SENARCLENS (de) Pierre : Mondialisation, souveraineté et relations internationales, Paris, Armand Colin, 1998
- MOREAU DEFARGES Philippe : un monde d’ingérences, Paris, Presses de sciences po, 1997.
- ZORGBIBE Charles : L’avenir de la sécurité internationale, Paris, Presses de sciences po, 2003.