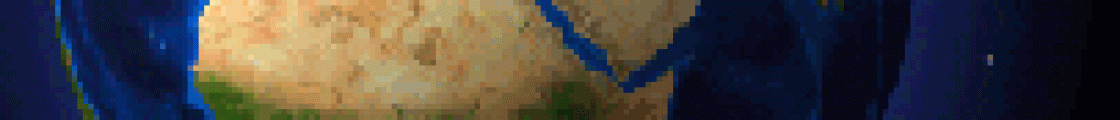Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du triomphe de la Révolution Algérienne, un triomphe devenu un symbole pour tous les peuples en lutte pour leur émancipation nationale, nous publions le fameux discours du jeune sénateur démocrate du Massachusetts du 2 juillet 1957, un discours franchement en faveur de l’indépendance de l’Algérie et qui dénonce en des termes très durs l’impérialisme occidental,et particulièrement l’impérialisme français en Algérie et qui montre combien le retard mis à régler la question algérienne pouvait se retourner contre les intérêts stratégiques du « monde libre » engagé à l’époque dans la guerre froide contre le bloc soviétique.
Monsieur le Président, la plus puissante force de notre monde n’est aujourd’hui ni le communisme ni le capitalisme, ni la bombe H ni le missile guidé, il s’agit de l’éternelle aspiration de l’homme à être libre et indépendant. Le grand ennemi de cette force considérable qu’est la liberté est, faute d’un terme plus précis, l’impérialisme qui actuellement se réfère à l’impérialisme soviétique et, que nous l’apprécions ou pas, et bien qu’ils ne soient pas comparables, l’impérialisme occidental.
Par conséquent, les plus importants critères pour juger la politique étrangère américaine sont notre façon de relever le défi de l’impérialisme et nos actions pour défendre l’aspiration humaine à la liberté. Ces critères, plus qu’aucun autre, décideront du jugement de notre nation par les millions d’habitants d’Asie et d’Afrique non-alignés, et seront observés anxieusement par les amoureux de la liberté gardant espoir derrière le rideau de fer. Si nous échouons à relever ce défi de l’impérialisme soviétique ou occidental, alors aucune aide étrangère, aucune expansion de l’armement, aucun nouveau pacte ou nouvelle politique ou conférence de haut niveau ne pourra prévenir de nouveaux reculs dans notre évolution et notre sécurité.
Je suis aujourd’hui préoccupé par le fait que nous échouons à relever ce défi qu’est l’impérialisme, dans ses deux sens, et qu’ainsi nous manquons à nos devoirs envers le monde libre. Je propose donc, puisque le sénat et la nation se préparent à commémorer le 181e anniversaire de la plus noble expression de l’homme contre la répression politique, de commencer une série de discours en deux parties, analysant le rôle de l’Amérique dans la lutte sans relâche pour l’indépendance qui met à rude épreuve les forces impérialistes à l’intérieur des deux blocs, soviétique et occidental. Mon intention n’est pas de parler de principes généraux, mais de cas précis, de proposer non pas des critiques partisanes mais ce que j’espère être des réponses constructives.
Il y a plusieurs cas d’affrontements entre l’indépendance et l’impérialisme dans le bloc soviétique qui requièrent notre attention. Un, au-dessus du reste, se détache dangereusement, la Pologne.
Le secrétaire d’État, dans sa conférence de presse du matin, à ce sujet, suggéra que si les gens souhaitent faire quelque chose à propos des exemples de colonialisme, ils devraient considérer le cas de la Lituanie gouvernée par les Soviétiques et les pays satellites, Tchécoslovaquie, Pologne, et autres.
Je suis d’accord avec lui. Pour cette raison, j’espère parler, d’ici deux semaines, d’un problème que je pense primordial, en un mot de la Pologne.
Il y a plusieurs cas d’affrontements entre l’indépendance et l’impérialisme dans le bloc occidental qui requièrent notre attention. Mais ici aussi l’un d’eux, plus que les autres, est absolument essentiel, l’Algérie.
Je dois discuter cet après-midi de nos échecs et de notre avenir en Algérie et en Afrique du Nord, et aussi ultérieurement parler de la Pologne à cette assemblée
M. le Président, la guerre en Algérie confronte les États-Unis à la plus grave impasse diplomatique depuis la crise en Indochine, et cependant nous avons non seulement échoué à faire face au problème de manière franche et efficace, nous avons même refusé de reconnaître qu’il nous concernait. Aucun problème ne constitue un défi plus difficile pour les responsables de notre politique étrangère, et aucun problème n’a été négligé à ce point. Quoique j’hésite quelque peu à m’attaquer au genre d’examen public de ce cas dont j’espérais –- lorsque je commençai l’étude intensive du problème il y a 15 mois – qu’il serait transmis par le département d’État au Congrès et au peuple, le Sénat est en droit, à mon avis, de recevoir les réponses aux questions fondamentales posées par cette crise.
Je suis encore plus réticent à paraître critique envers notre premier et plus ancien allié, dont l’assistance dans notre propre guerre d’indépendance ne sera jamais oubliée et dont le rôle qu’il a habituellement tenu dans l’enchaînement des événements du monde a toujours été une attitude de coopération et de leadership constructif. Je ne veux pas que notre politique soit anti-française, pas plus qu’elle ne soit antinationaliste – et je suis convaincu qu’un nombre croissant de français, dont nous devons tous reconnaître la patience et l’endurance, réaliseront que les points de vue exposés dans ce discours sont, à long-terme, dans leur intérêt.
Je ne dis rien aujourd’hui qui n’ait déjà été énoncé par des chefs responsables de l’opinion française, et même par un nombre croissant de français eux-mêmes.
Pour commencer, il faut noter que des diplomates français et américains ont le même point de vue sur la question de l’Algérie et cela depuis plusieurs années. Ils considèrent que ce n’est pas un sujet de débat pour la politique étrangère américaine ou pour la marche du monde. C’est uniquement un problème interne à la France, consistant en un soulèvement dans une province, une crise qui réagira de façon satisfaisante à une anesthésie locale. Mais, quelle que soit la validité de ces clichés, les faits bruts et récents sur le sujet sont que la transformation du nationalisme africain et les effets secondaires de plus en plus graves de cette crise ont transformé l’Algérie en un problème international et par conséquent américain.
La guerre d’Algérie, impliquant plus de 400 000 soldats français, a ôté aux forces continentales de l’OTAN assez d’hommes pour les rendre squelettiques. Elle a brouillé les espoirs européens d’un marché commun et sérieusement compromis les réformes libérales prônées par l’OCDE en forçant la France à imposer des restrictions à l’importation car elle est en économie de guerre. Elle a fait l’objet de plusieurs appels à débat dans le cadre des Nations Unies. Nos réactions équivoques et notre opposition à ce débat ont altéré notre leadership et notre prestige dans cette organisation. Elles ont dégradé nos relations avec la Tunisie et le Maroc, qui font naturellement cause commune avec les chefs algériens et qui ont des reproches justifiés à nous faire, car nous avons des accords économiques et militaires avec un gouvernement français qui sanctionne économiquement leurs soutiens au nationalisme algérien.
Elle a affaibli l’efficacité de la force de la doctrine Eisenhower pour le Moyen-Orient et nos programmes d’aide étrangère et d’information. Elle a mis en danger le maintien de certaines de nos bases aériennes les plus stratégiques, et menacé nos avantages géographiques sur l’orbite communiste. Elle a affecté notre position aux yeux du monde libre, notre leadership dans la lutte pour garder ce monde libre, notre prestige et notre sécurité ; ainsi que notre leadership moral dans la lutte contre l’impérialisme soviétique dans les pays derrière le rideau de fer. Elle a fourni des munitions puissantes aux propagandistes anti-occidentaux dans toute l’Asie et le Moyen-Orient – et sera l’élément le plus gênant face à la conférence d’Accra en octobre des nations libres de l’Afrique, qui souhaitent, en facilitant la transition vers l’indépendance des autres colonies africaines, rechercher des voies communes par lesquelles ce grand continent pourra rester aligné avec l’Occident.
Enfin, la guerre d’Algérie n’a cessé de drainer la main-d’œuvre, les ressources, et l’esprit de l’un de nos alliés les plus anciens et les plus importants – une nation dont la force est absolument vitale pour le monde libre, mais qui a été contrainte par ce conflit épuisant à reporter de nouvelles réformes et les services sociaux à domicile, à étouffer les nouveaux plans importants pour le développement économique et politique en Afrique occidentale française, le Sahara, et dans une Europe unie, pour faire face à un mouvement communiste intérieur consolidé à un moment où le communisme recule ailleurs en Europe, pour étouffer le journalisme libre et critique, et libérer la colère et les frustrations de son peuple par une instabilité gouvernementale perpétuelle et une attaque précipitée sur Suez.
Non, l’Algérie n’est plus un problème spécifiquement français – et ne le sera plus jamais. Et bien que leur sensibilité à son examen par cette nation ou l’ONU soit compréhensible, une discussion franche et complète d’une question si importante pour nos intérêts tout comme aux leurs devrait être évaluée des deux côtés d’une Alliance atlantique qui a un véritable sens et une solidarité.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait la moindre valeur dans le genre de discussion qui a caractérisé l’approche d’autrefois de ce problème et d’autres du même genre – de tièdes encouragements et de la morale des deux côtés, une neutralité prudente sur les véritables enjeux, et une réaffirmation du fait évident que nous dépendons de nos amis européens, de notre évident engagement malgré tout aux principes d’autodétermination, et de notre désir naturel de ne pas nous impliquer. Nous nous sommes convaincus nous-mêmes que nous avions de cette façon satisfait les deux côtés en faisant l’autruche, alors qu’en réalité nous n’avons gagné que la méfiance de tous.
Il est donc temps que l’on prenne en main le véritable problème qui nous est posé en Algérie – problème qui ne peut plus être évité ni par les Nations Unies ni par l’OTAN – problème qui devient de plus en plus difficile à résoudre, comme une guerre acharnée apparemment sans fin détruit, un par un, les ponts de moins en moins nombreux qui restent vers un accord raisonnable. Chaque mois la situation devient plus tendue, les extrémistes gagnent de plus en plus de force des côtés français et algérien. Le gouvernement, récemment investi par l’Assemblée française, est présidé par un Premier ministre clairement identifié avec une politique sans aucune concession valide ou réalisable ; et son cabinet, bien que reposant sur un équilibre des partis similaire à celui de son prédécesseur, a été purgé de tous les membres associés de quelque façon que ce soit à une politique de négociation en Algérie. Le gouvernement français, quelle que soit la personnalité de son dirigeant, semble attaché aux mêmes formules rigides qui régissent ses actions en Algérie depuis si longtemps ; et le seul signe d’espoir est l’expression plus claire de l’intérêt pour un règlement parmi les penseurs indépendants en France, un exemple notable étant l’ouvrage bien argumenté publié récemment par M. Raymond Aron, intitulé « La tragédie algérienne ».
M. Aron, principal commentateur politique du journal conservateur Le Figaro, a exhorté à la constitution d’un État algérien comme le meilleur choix entre deux maux. Mais les perspectives d’un tel règlement offert ou accepté par son propre gouvernement sont fort éloignées, si l’histoire des échecs des négociations passées en est une indication. En février 1956 le Premier ministre Mollet, bombardé avec des tomates et des briques, a plié devant la fureur d’une foule française à Alger, et a remplacé le futur ministre résident français soupçonné de pencher vers un règlement rapide. A l’automne dernier, lorsque Mollet lui-même autorisa les émissaires français à tenir des négociations pour le cessez-le-feu avec les nationalistes à Rome et ailleurs, et encouragea la discussion sur la question entre les rebelles et les gouvernements tunisiens et marocains, les principaux dirigeants rebelles algériens ont été pris en otage par les Français lors du transit aérien entre Rabat et Tunis à l’occasion de ces réunions. Cette mesure, semblant prise à l’initiative du ministre français de la Défense et du ministre résident, et, en fait, à l’insu du Premier ministre, M. Mollet lui-même, a non seulement fait s’évanouir tous les espoirs d’un cessez-le feu, mais aussi eu les répercussions les plus défavorables pour la France dans tous les pays non-alignés.
Après l’apaisement des troubles de Suez, le Premier ministre tunisien Bourguiba a de nouveau tenté de trouver un terrain d’entente ; et, avec beaucoup d’efforts, il a persuadé les représentants nationalistes d’accepter le principe des élections sous contrôle international, sous réserve de garanties, si les Français se conformaient aux résultats. Mais, encore une fois, M. Mollet lui a coupé l’herbe sous le pied ; et, plus récemment, M. Bourguiba a été frustré par l’action de la France qui a arbitrairement coupé les subventions économiques pour la Tunisie. Une autre manifestation de violence a été récemment prévue au cas où l’actuel ministre résident, l’intransigeant Robert Lacoste, serait remplacé par un modéré. Une organisation extrémiste française à Alger qui a voué aux gémonies M. Mendes-France et les défenseurs de la réforme modérée est en effet subventionnée par Lacoste et le gouvernement. Et la politique française continue d’insister pour que ni négociations ni élections ne puissent avoir lieu avant la fin des hostilités – un engagement, comme je vais en débattre dans un moment, qui rend moins probables à la fois les négociations et la fin des hostilités, tout comme en Indochine.