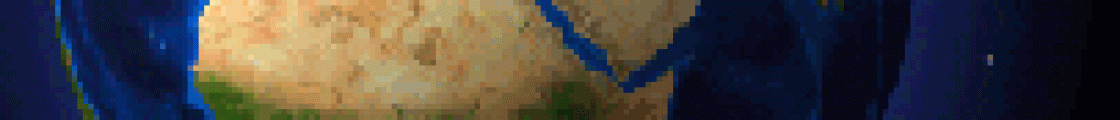Dans son dernier ouvrage, Le Monde arabe dans la longue durée, Samir Amin revient sur les secousses actuelles touchant le monde arabe qu’il analyse à travers une approche historique globale de la région.
Les Lettres françaises : Votre ouvrage porte un titre et un sous-titre qui semblent rentrer en contradiction l’un avec l’autre. Votre titre fait référence au « monde arabe dans la longue durée », alors que le sous-titre renvoie aux événements les plus récents, le fameux « printemps arabe ». Mais y a-t-il franchement contradiction ?
Samir Amin : Je ne suis pas de ceux qui pensent que les événements peuvent être appréciés comme ça, sans retour en arrière plus sérieux. Les mouvements politiques, quels qu’ils soient, se développent dans des sociétés qui ont une histoire et une culture politique particulière qui est le produit de cette histoire. Si on ne connaît pas toute cette culture politique, on risque de porter des jugements trop rapides, ou superficiels. Il faut une analyse des événements immédiats touchant le monde arabe – ce qui constitue le premier chapitre de mon livre –, une analyse des forces sociales et politiques en présence, de leur identité sociale, de classe, de leur rhétorique, de leur pensée politique, de leur vision de la culture politique dans laquelle ils s’inscrivent. Mais cette analyse indispensable des événements actuels, il faut la replacer dans le cadre de la longue durée. La « longue durée » c’est à mon avis d’abord, pour ce qui concerne l’Égypte, les deux siècles depuis la prise du pouvoir par Méhémet Ali (1804-1849), soit les deux siècles de la modernité. C’est la raison pour laquelle je lis ces deux siècles comme une série successive de vagues longues, d’un demi-siècle chacune : des vagues de montée des forces de transformation et d’émancipation sociale et des vagues de recul, de stagnation. Mais lorsqu’on a fait cette analyse pour l’Égypte, on a toutefois besoin de situer ces vagues longues de l’histoire égyptienne dans une histoire plus longue, celle du monde arabe. Ce qui implique de se poser des questions qu’on ne se pose pas assez : qu’est-ce que le monde arabe ? À partir de quand commence-t-il ? On parle des sociétés musulmanes… qu’est-ce que ça veut dire ? Quels sont les rapports entre la religion – ou ses interprétations successives – et la culture politique ? Je crois qu’il n’y a pas de contradiction entre une vision à long terme et l’analyse des événements immédiats.
LF. Selon vous, la « longue durée » de l’histoire de la région du Moyen-Orient – qu’on peut élargir au Proche Orient – est celle d’une « plaque tournante » de l’économie monde. Qu’entendez-vous par là ?
SA. La géographie compte ! Le Moyen-Orient, qui est devenu le Machrek arabe, se trouve au cœur de l’Ancien monde. Il est la seule région – avec ses prolongements en Asie centrale, au Sahara… – qui est en contact avec toutes les autres grande régions de l’Ancien monde, avec l’Europe, l’Afrique sub-saharienne, mais aussi avec la Chine et l’Inde et le sud-est Asiatique. Le Moyen-Orient a bénéficié de cette position comme plaque tournante pour les contacts, les échanges, la fameuse « route de la soie » qui ont connecté toutes les régions de l’ancien monde, à partir au moins d’Alexandre le Grand, soit bien avant l’arabisation de la région. L’hellénisme est l’ancêtre de la formation du monde arabe. Cette région a bénéficié de cette fonction de plaque tournante puisque, jusqu’à Gengis Khan et Marco Polo, le contact entre l’Europe et la Chine et l’Inde passait par cette plaque tournante. C’est une raison des Croisades d’ailleurs : le contrôle de ces routes. Cette position a donné des caractéristiques que l’Islam a intégré, notamment un caractère marchand, l’importance des relations commerciales, caractéristique présente dans la culture de la région. Cet avantage explique l’Islam dans sa première grandeur, l’Islam des trois premiers siècles, des Omeyyades à Damas aux Abbassides de Bagdad. Au XVe siècle, cet avantage disparaît lorsque les Européens découvrent et contrôlent de nouvelles voies maritimes, passant par l’Atlantique ou par le passage du Cap de Bonne Espérance. Ils peuvent établir dorénavant une relation directe avec l’Asie. C’est un des éléments du « déclin de la région » en dépit de sa réunification tardive par l’Empire ottoman.
LF. Vous parlez alors d’un « régime mamlouk » qui dominerait durant plusieurs siècles la région et donc les traces se feraient encore sentir…
SA. Cette forme de pouvoir caractérise la région à partir des Croisades. Saladin est l’inventeur de ce système. On ne peut comprendre la culture politique du monde arabe moderne sans prendre en compte cette forme politique. C’est la forme du long moment de déclin et non de la « grandeur ». Elle associe en une seule classe dominante, les hommes de guerre – les « mamlouks » au sens propre – mais aussi les hommes de commerce – qui aspire à retrouver la fonction de plaque tournante commerciale – et les hommes de religion. Cette forme n’a jamais été véritablement déconstruite. Il y a eu des tentatives comme celle de Méhémet Ali en Égypte qui a massacré les mamlouks, mais il a reconstitué une classe très analogue, cette fois à sa dévotion. On ne peut comprendre la nature des « régimes militaires » du monde arabe contemporain (Algérie, Syrie, Égypte, Irak…) sans prendre en considération cette longue tradition.
LF. Il y a eu toutefois dans la région des forces révolutionnaires et progressistes. On pense notamment aux puissants partis communistes de l’Irak ou du Soudan. Quel bilan tirez-vous de leur rôle historique ?
SA. J’ai appelé ce passage de mon livre « avancées et reculs ». Des avancées suivies de reculs dramatiques. Cette région du monde n’est pas une région stagnante dans sa pensée politique. C’est un région qui a été très attirée par le communisme de la IIIe Internationale comme cadre de la vision de la lutte d’émancipation sociale. D’où l’importance, même s’ils ont été relativement petits, de ces partis communistes qui ont été très actifs et qui ont eu un poids dans l’histoire de la région, y compris le communisme égyptien. À un moment donné, on a l’impression d’avancées rapides avec des victoires non négligeables comme au Yémen. Je dis de l’Afghanistan que le meilleur moment de son histoire moderne est celui du régime dit « communiste », un régime que j’analyse plus comme un régime national populaire, teinté de despotisme éclairé plutôt que « socialiste » au sens le plus rigoureux du terme. Un régime dont le bilan a été très positif.
LF. Avec le déclin des forces communistes, dorénavant très affaiblies comme au Soudan, ou inexistantes comme en Afghanistan, il y a eu le déclin corrélatif des partis nationalistes arabes, notamment la transformation des partis Baath, en Syrie et en Irak, en courroie de transmission du pouvoir sans contenu idéologique net. Ce déclin a laissé un espace pour l’Islam politique, l’islamisme. À ce propos vous refusez les distinguos que l’on fait entre les différentes formes d’Islam politique, « dures » ou « modérées ».
Il y a un trait commun et dominants entre ces partis, malgré les diversités nationales. La matrice de la plupart de ces partis, Ennahda en Tunise, le FIS en Algérie, ce sont les Frères musulmans égyptiens. Ces Frères musulmans sont un parti pas tant « musulman » que « réactionnaire » sur le plan social. Pas seulement « conservateur » mais « réactionnaire». Jusqu’aujourd’hui on voit les frères musulmans refuser en Égypte une législation fixant un salaire minimum, s’opposer aux grèves ouvrières, rejeter les revendications des petits paysans qui veulent conserver leurs terres pour résister à l’expropriation. Tous ces partis sont réactionnaires. Ils ne sont pas du tout opposés au libéralisme économique : au contraire ils ne disent rien sur ce plan. On va le voir avec Ennahda en Tunisie d’ailleurs. Leurs options sont celles du capital international dominant des puissances occidentales. C’est la raison pour laquelle ces islamistes sont les alliés et non les ennemis des puissances impérialistes, et notamment des États-Unis. Ce n’est pas un hasard si c’est l’Arabie Saoudite qui est mise au premier plan à l’heure actuelle. De manière caricaturale, on en fait le défenseur de la démocratie ! C’est d’ailleurs l’Arabie Saoudite qui contrôle la Ligue arabe, une ligue qui n’a d’ailleurs plus aucune valeur. Les peuples arabes se foutent d’ailleurs pas mal de la Ligue arabe. Ils ne lui attribuent aucune légitimité.
LF. Pour revenir sur la question des événements immédiats, que pensez de ce « printemps arabe » auquel vous accolez un point d’interrogation ?
SA. J’ai mis ce point d’interrogation car je pense que nous vivons actuellement l’automne du capitalisme. C’est-à-dire l’implosion du système capitaliste arrivé à son stade actuel, celui des monopoles généralisés, mondialisés et financiarisés. Mais les mouvements de protestation, de lutte, de remise en cause de l’ordre politique ne sont pas encore le « printemps des peuples ». Ni celui des peuples arabes, ni même celui de l’Amérique latine qui est pourtant plus avancée, et a fortiori celui de l’Europe, même s’il y a une montée des mouvements et des luttes. La question qui se pose est : à quelles conditions, l’automne du capitalisme et le printemps des peuples pourront coïncider ? Comment pourrions-nous faire de l’automne du capitalisme le printemps des peuples, arabes évidemment, mais aussi des autres ? J’essaie de dégager ces conditions. J’en vois deux : l’une c’est que la légitimé des luttes de transformation sociale ne soit pas effacée par la légitimité électorale, celle des urnes. La légitimité des luttes est pour moi d’une importance supérieure à celle des urnes. Je fais référence aux élections récentes en Tunisie. En Tunisie, « l’illusion démocratique », celle de la légitimité des urnes, l’a emporté sur celle des luttes. Ce n’est pas le cas égyptien toutefois. Dans le cas égyptien, les élections ont leur importance, mais elles ne sont pas vues, en tout cas par les protagonistes principaux du grand mouvement populaire, comme la forme suprême de la légitimité. L’autre est que ces luttes s’inscrivent dans la perspective d’une longue transition vers le socialisme.
Entretien réalisé par Baptiste Eychart