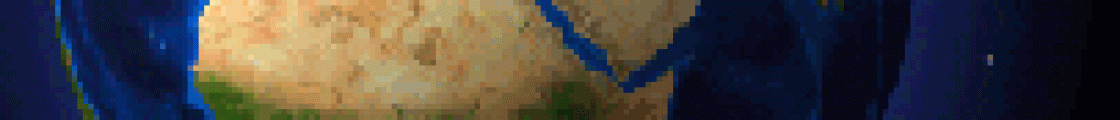La résistance du peuple palestinien à la colonisation sioniste ne date pas de la création de l’OLP ni du déclenchement de la lutte armée. Elle a commencé en réaction aux premiers mouvements de colonisation sioniste. Cette résistance bien qu’elle soit essentiellement dirigée contre la spoliation des terres des Palestiniens fut également une résistance de la société urbaine palestinienne pour ses droits civils et politiques dans le cadre d’un mouvement national prometteur. La grève générale de 1936 fut un tournant majeur dans le cadre de l’histoire du peuple palestinien. C’est ce qu’ a essayé de démontrer Elias Sanbar dans un ouvrage historique, Palestine 1948 - L’expulsion (1). La grande grève de 1936, en particulier, y est présentée sous un jour nouveau, comme la manifestation éclatante d’une volonté de résistance unitaire qui, pendant des mois, mobilisa l’ensemble de la société palestinienne. Au moment où à travers les « marches du retour » déclenchées à partir du 30 mars dernier dans l’enclave de Gaza, le peuple palestinien semble renouer avec la forme de la grève générale et de l’insurrection pacifique, la lecture des pages consacrées par Elias Sanbar à la grande grève de 1936 peut nous inspirer bien des enseignements politiques.
Durant le Mandat, la révolution de 1936-1939 émerge par exemplarité. Point culminant d’une crise au cours de laquelle les parties en lutte, conscientes de jouer le décisif, avaient usé de tout leur arsenal social, elle fut entièrement placée sous le signe de la conservation et de la préservation. Menacé de disparition, le peuple arabe de Palestine résista par un attachement acharné à tout ce qui déterminait son identité. La révolution de 1936-1939 fut un cas exemplaire de l’endurance du monde menacé et surtout de l’adresse extrême avec laquelle les rapports sociaux traditionnels furent, jusque dans leurs moindres rouages, mis au service de l’entreprise de sauvegarde.
Elle « débuta » le 21 avril 1936 par une grève générale, à la veille de laquelle la prise de conscience des Palestiniens, de clairsemée, divisée, localisée – telle région plus menacée, telle catégorie plus frappée qu’une autre – était devenue unanime. C’était la période où l’immigration, du fait surtout de la poussée du nazisme en Allemagne, atteignait des chiffres jamais vus, et où apparaissaient les premiers résultats massifs de l’achat des « terres vidées ». Les années 1930-1933 virent ainsi la naissance des bidonvilles autour des principales agglomérations urbaines palestiniennes, notamment à Haïfa, qu’habitaient les paysans expulsés, chômeurs dans leur grande majorité, ou employés dans les projets de l’Etat mandataire : les chemins de fer, les ports et la raffinerie de l’Iraq Petroleum Company. Là, sur ces lieux de travail, les Palestiniens découvraient accidentellement les cargaisons d’armes acheminées en contrebande par les colons. Mais cette grève n’eut pas que des causes locales ; la région arabe avoisinante passait par une succession de soulèvements anticoloniaux, profondément répercutés d’un pays à l’autre. Plus proche, en Syrie, une grève générale avait arraché au Mandat français des concessions qui allaient dans le sens de l’accession à l’indépendance.
L’interaction de ces facteurs locaux et régionaux fit qu’à la veille de la Grande Grève régnait un climat d’unité nationale. Dépassant le fractionnement des clans, des organisations, ou tout simplement la « variété » régionale, une question traversait la Palestine. Elle posait la nécessité d’organiser une riposte généralisée…
LA société palestinienne vivait unanimement la joug de la colonisation ; ce furent ses dirigeants effectifs, les chefs de ses clans et de ses familles, qui prirent la direction du mouvement. Ces chefs, grâce à la cohésion sociale de l’ensemble des classes, et surtout à la nature du pouvoir qui y avait cours, allaient se révéler parfaits meneurs de leur barque. Mais si les dirigeants étaient traditionnels, la pratique même du pouvoir apparue avec la grève était nouvelle. Elle se distinguait de celle déployée sur une assise clanique fractionnée (un chef par clan, dans son clan) et couvrait le réseau général des clans, Entre ces derniers, le consensus tribal avait, avec la grève, cédé la place au national. Dans leur souci de se sauvegarder de la disparition, les différentes factions arabes avaient, on les élargissant, procédé à la fixation et à la consolidation des rapports menacés. Issue des tribus de Palestine, entité constituée de l’articulation nouvelle entre les clans, la grande tribu palestinienne était née. Elle prit de court les sionistes, gêna les Britanniques confrontés à une insurrection généralisée, mais surprit surtout les chefs palestiniens eux-mêmes.
La Palestine avait déjà connu la circulation des groupes de partisans armés, l’éclatement des révoltes et les issues sanglantes des soulèvements nationaux de 1921, 1929, 1933 et 1935, l’organisation des partis et groupes patriotes, mais tout cela ne représentait pas encore, bien qu’il le préparât, le saut qualitatif que fut la Grande Grève. Avec cette dernière, on passait des manifestations d’une résistance généralisée mais plurielle à l’expression unitaire, celle d’un seul corps. L’activité antérieure des chefs palestiniens avait visé à le former pour étendre leur pouvoir et, simultanément, investir cette extension dans leur projet de non-dissolution. Mais une chose était d’oeuvrer et une autre de se retrouver dirigeants sollicités par un exercice du pouvoir différent de celui qui l’avait précédé.
Le deuxième trait original de cette grève, celui de sa « fermeture », découlait de la formation de la grande tribu palestinienne. Dans les présentations habituelles de la grève, l’accent est toujours mis sur sa longue durée qu’expliqueraient soit la ténacité des grévistes, soit une certaine vision de l’organisation inspirée consciemment ou non de l’héritage des luttes ouvrières et syndicales. Or ici, ce qui fit durer la grève, ce qui fit surtout qu’elle aurait pu encore se prolonger, ce qui la fit « marcher », c’est qu’elle n’était pas une grève au sens habituel du terme mais plutôt un acte de boycottage national, de « fermeture » totale au pouvoir central. La distinction entre ces deux types de lutte provient essentiellement du fait que, à la différence de l’arrêt par une grève d’un certain nombre d’activités et du blocage consécutif des rouages, surtout économiques, d’une société, la « fermeture » représente une auto-exclusion de la sphère des rapports à l’Etat. Avec elle, on est en quelque sorte « hors la société ». Durant la grève de 1936, les Palestiniens se retirèrent du jeu, et ce retrait, fait nouveau, avait les moyens de s’exercer à l’échelle d’un peuple tout entier. Ces moyens, les Palestiniens ne les détenaient que parce que leur grève se déroulait dans le cadre de la grande tribu palestinienne. Car si elle se fermait à l’Etat du Mandat, elle ne se figeait pas pour autant intérieurement. Au contraire, elle fonctionnait, se dirigeait, se soignait, se nourrissait, se transportait, combattait…, et la grève devenait une sorte d’expérimentation de fait de l’indépendance. Les Palestiniens, au sein d’un territoire politique nouveau, puisqu’il fonctionnait malgré la rupture avec l’Etat, allaient ainsi, pendant six mois, vivre avec leurs pouvoirs, leurs contradictions et leurs formes sociales spécifiques, une période unique, sorte de préfiguration d’une patrie débarrassée de la colonisation. C’est pourquoi cette grève de 1936 fut avant tout une épreuve de force avec le Mandat, auquel la direction palestinienne espérait soutirer des concessions qui seraient autant de contraintes imposées au mouvement sioniste.
MAIS les chefs palestiniens, qui découvraient l’étendue de leur pouvoir nouveau, voyaient également dans la grève un puissant moyen de pression sur les Britanniques, et par là leur faisaient, bon gré mal gré, jouer un rôle d’arbitres. Ainsi la « fermeture » à l’Etat, immense espoir pour le peuple, n’était pour sa direction que savant dosage de mesures menaçantes, destinées à laisser entrevoir à cet Etat, dont on se coupait, que les choses allaient empirer tant qu’il ne céderait pas, c’est-à-dire on réalité tant qu’il ne choisirait pas. Pour ces dirigeants qui avaient toujours un oeil fixé sur les sionistes et l’autre sur les Britanniques, guettant de la part de ces derniers le moindre geste d’une volonté qui ne les exclurait pas mais les intégrerait à un projet de pouvoir « national », les autorités mandataires allaient entrebâiller une porte. Agitant la menace d’un engagement militaire sans précédent et tendant simultanément la perche des négociations, le pouvoir colonial promit contre l’arrêt de la grève l’envoi d’une commission d’enquête pour déterminer l’avenir du pays. La grève s’arrêta et une trêve s’installa, aussitôt mise à profit par toutes les parties.
Pour la colonisation, il était très urgent de faire réintégrer la communauté palestinienne dans la sphère des rapports à l’Etat, il fallait que cette dernière fonctionnât à nouveau selon les « règles du jeu » admises. La direction palestinienne céda en acceptant de rencontrer la commission d’enquête et d’envoyer une délégation à Londres. L’acquis était en principe de taille pour les Britanniques, mais il ne dura pas longtemps. Les chefs palestiniens demeuraient avant tout méfiants : inégalement confiants dans le Mandat, le renforcement constant des sionistes était là pour confirmer les thèses des plus durs et des plus pessimistes. Si, partiellement contraints et partiellement victimes d’une illusion, ils avaient accepté de temporiser, de donner une chance aux pourparlers, ils demeuraient néanmoins soucieux de ne pas se laisser abuser par leurs ennemis. Aussi la capacité des Palestiniens à déplacer leur « tribu » hors des rapports à l’Etat ne fut-elle pas abandonnée, mais mise en veilleuse. Très activement d’ailleurs. Les maquis complétaient leurs préparatifs et les « gangs », comme les appelleront les Britanniques, constitués et armés, attendaient le deuxième temps de la sortie des règles du jeu, celui de l’insurrection armée générale.
Le déclenchement de la grève signala une nouvelle structuration de la communauté nationale palestinienne, sa réussite confirma sa potentialité de victoire. C’est pourquoi lorsque la grève s’arrêta, les Palestiniens demeuraient sur l’offensive. La direction des clans, devenue une sorte de direction nationale, en tira aussi profit. La grève lui avait fait découvrir son assise transformée, et, très vite, l’expérience du pouvoir aidant, cette direction avait restructuré ses réseaux. Une hiérarchisation s’instaura entre les divers chefs eux-mêmes. Le clan des Husayni, auparavant prédominant, se rapprocha pour la première fois d’une position hégémonique. Son chef, le grand mufti, Amin al-Husayni, devenait le Shaykh al-Mashâyikh , cheikh des cheikhs, et la Commission supérieure arabe se mua en al-Hay’a al-Arabîya al-Ulya , haut comité arabe, et principal outil institutionnel de ce dirigeant.
Les sionistes perçurent alors mieux que d’autres l’ampleur des transformations, ce qui consacra les thèses de certains, dont Ben Gourion, qui pressaient leur mouvement de créer une armée en prévision de la guerre qu’il allait falloir tôt ou tard mener. C’est après la grève générale de 1936 que la Haganah, jusque-là simple groupe armé, commença à s’organiser en véritable armée de la communauté juive. Cette mutation se doubla d’une autre : le Yishouv (communauté des colons juifs en Palestine) réalisa sa fermeture aux Arabes. Désormais, les principes d’économie et de travail juifs, les réseaux fermés de coopératives de production et de distribution, etc.. allaient fonctionner pleinement. L’afflux de moyens monétaires gigantesques, provenant de l’exode de certains juifs allemands qui fuyaient le nazisme comme des souscriptions massives des organisations de soutien américaines, finançaient l’opération.
(1) Elias Sanbar (rédacteur en chef de la Revue d’études palestiniennes), Palestine 1948. - L’expulsion , à paraître aux éditions Les livres de la Revue d’études palestiniennes, Paris, 240 pages, 79 F. Diffusion Distique, 17, rue Hoche, 92240 Malakoff.