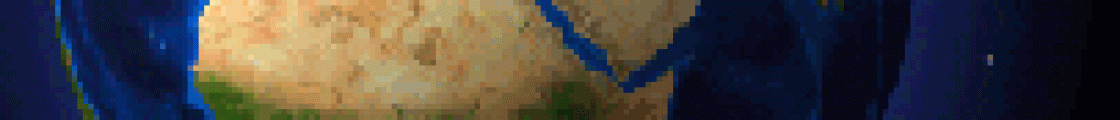Le document préparatoire à la rencontre « Les usages alternatifs du droit » qui fait l’état des lieux des « pratiques alternatives » du Droit rencontrées par l’association Juristes-Solidarités lors de ces dix dernières années (Huyghebaert 2000) nous fait prendre conscience de la diversité sémantique de cette expression et des situations auxquelles elle renvoie. En effet, les « pratiques alternatives du Droit » renvoient à des réalités aussi diverses que des actions de sensibilisation, d’éveil au droit et de popularisation du droit, à des actions promouvant l’accès au droit des populations, à des actions de formation de parajuristes, à des actions juridiques visant à appliquer, neutraliser ou créer des droits en conformité avec l’attente des populations, à des actions judiciaires visant à faire évoluer le droit formel en faveur des plus démunis et enfin à des actions de résolution extra-judiciaire des conflits. Leurs domaines d’action, les enjeux qu’elles poursuivent couvrent toute une palette allant des conflits liés à la famille et à la femme, aux initiatives populaires visant en milieu urbain à se faire reconnaître des lieux de vie, en passant par les conflits liés à l’élevage, à l’agriculture et aux relations entre éleveurs et agriculteurs, les réactions face aux réformes agraires, les expropriations et déplacements forcés etc. S’ajoute à cette hétérogénéité celle de la diversité des situations et la spécificité des pratiques alternatives du Droit dans les diverses aires géographiques illustrées dans le document par L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, le Maghreb, l’Amérique latine, l’Asie du Sud et du Sud-Est et l’Europe (surtout la France – pour tout ce qui précède voir Huyghebaert 2000 : 105-107).
On peut se demander si on est vraiment en présence d’un ensemble cohérent de phénomènes où si parler des « pratiques alternatives du droit » n’est pas encore une fois une manière de tomber dans ce que Louis Dumont (1991 : 140-141) appelait le piège de l’ « englobement du contraire ». Au lieu d’appréhender la diversité des situations dans leur originalité, on les englobe dans une catégorie générale et on les construit ensuite par rapport au référent implicite de cette catégorie – ce dernier étant de plus perçu comme hiérarchiquement supérieur. En ce qui nous concerne, on part du « droit » (sous-entendu le « droit étatique ») comme catégorie englobante. Et on construit ensuite les pratiques alternatives de ce droit qui se définissent avant tout par rapport à leur « déviation » du modèle général, un peu comme lorsqu’on parle dans le domaine économique du « secteur informel », mais qui se révèle dans certains contextes bien plus riche que le secteur « formel ». Il faut donc s’interroger : parler de « pratiques alternatives du droit » ne nous enferme-t-il pas dans une définition négative qui peut empêcher en dernière analyse à laisser émerger des approches véritablement alternatives (au sens fort) au modèle du droit dominant, étatique et moderne ? Car tant qu’on parle de « pratiques alternatives du droit » ne reste-t-on pas dans le mythe de la « suprématie du droit » au moins au sens que l’on accepte implicitement que le « droit » est ce qui régule en dernière analyse notre vivre ensemble ? Mais il semble que s’il faut approfondir cette piste, les choses sont néanmoins plus complexes. En effet, les pratiques alternatives du droit ne se construisent pas uniquement de manière négative comme le fait apparaître l’analyse sémantique du terme, mais renferment un contenu positif qui permet de les identifier et dont l’une des caractéristiques et justement de remettre en question le monopole sur le « juridique » du droit entendu au sens formel ou droit étatique, voire même dans ce domaine limité, du monopole qu’en aurait une catégorie particulière de citoyens, les juristes.
Les pratiques alternatives du droit, comme nous l’enseigne l’expérience de Juristes-Solidarités, semblent avoir en commun qu’elles visent toutes de provoquer et de contribuer de manière plus ou moins délibérée à « un changement d’attitude des plus démunis par rapport à la loi afin que ces derniers passent d’une attitude légaliste passive (l’individu considéré et se considérant comme incompétent subit le droit élaboré en dehors de lui) à une attitude légitimiste active (la personne apprend à connaître le droit, le rapporte à son quotidien, l’utilise, participe à son évolution : elle se l’approprie). » (Huyghebaert 2000 : 105-107). Il est peut-être utile ici de rappeler que les « démunis » sont, si l’on prend une perspective globale, non pas l’exception mais plutôt la règle dans notre monde contemporain. Réfléchir aux pratiques alternatives du Droit ne nous emmène donc pas simplement à la « périphérie de nos systèmes juridiques » mais plutôt au cœur du mystère de la reproduction de nos vies en société, ce qui outre des implications théoriques a aussi des implications politiques importantes par rapport aux choix des « projets de société » pour ce vingt-et-unième siècle.
Il s’agira donc pour nous de réfléchir aux implications d’une prise au sérieux de ce que l’on appelle les pratiques « alternatives » du droit. Pour ce faire, il sera tout d’abord essentiel d’expliciter une distinction implicite dans les diverses façons de pratiquer le « droit » de manière alternative. En effet, on peut tout d’abord pratiquer le « droit », entendu comme « droit formel ou étatique » de manière alternative, c’est-à-dire en tentant de l’ouvrir aux perspectives de ceux que souvent il a tendance à ignorer, voire de l’utiliser pour faire avancer certains combats « d’émancipation ». Mais la référence aux pratiques alternatives au Droit renvoie aussi à d’autres modes de résolution des conflits et de reproduction de la société que le droit étatique moderne, des « droits traditionnels » ou des « droits de la pratique ». Il sera donc utile de commencer à clarifier la distinction entre le « droit, normes générales et impersonnelles » des juristes et le « Droit, phénomène juridique » des anthropologues. Une fois ces clarifications faites on pourra ensuite s’engager dans deux pistes de réflexion qu’ouvrent les pratiques alternatives du Droit quant aux modalités et aux mises en forme de notre « vivre ensemble » et du rôle qu’y jouent ou peuvent y jouer le droit entendu au sens strict, ainsi que le Droit entendu au sens large comme ce qui « met en forme et met des formes à la reproduction des sociétés dans les domaines qu’elles considèrent comme vitaux ».
Les « pratiques alternatives » nous font d’une part prendre conscience que le phénomène juridique déborde les systèmes et normes juridiques et les discours savants – ou, si nos inversons la perspective, que « le droit officiel et savant » ne constitue qu’une pointe émergée de l’iceberg de la reproduction de nos vies en société et de la résolution de nos conflits (ex : Le Roy 1997). D’autre part, elles nous rappellent qu’il existe d’autres mythes fondamentaux pour penser notre vivre ensemble, alternatif au nôtre, celui du Droit. Nous sommes donc, d’une part, invités en plongeant au cœur des pratiques alternatives du droit à aller au-delà d’un simple « alternatif » qui serait aux marges ou « aux confins du droit » (Rouland 1993) pour fondamentalement repenser le Droit, comme « phénomène juridique » faisant partie et contribuant en même temps à la régulation de nos « grands jeux en société ». La complexité est donc au rendez-vous et nous poussera à orienter nos interrogations de la recherche de la réalisation d’États de Droit (comprise uniquement de manière institutionnelle comme la transplantation de ce modèle moderne d’organisation de la vie en société partout dans le monde) à une réalisation d’états (situations) de Droit pluralistes et ancrées dans les pratiques et les représentations des acteurs sociaux. Mais d’autre part, il s’agira de brosser un tableau impressionniste d’ » alternatives » possibles à notre mythe actuel « légicentré », « logocentré » et anthropocentré lorsqu’on s’ouvre au mythe émergent de l’interculturalisme et du pluralisme de la réalité (Vachon 1997 ; 1998). Notons d’ailleurs qu’au cours de nos cheminements les concepts de « droit » autant que de « Droit » risquent de se trouver remis en question par la perspective « émancipatrice » inhérente à la démarche « alternative ». Nous y reviendrons. Mais soulignons déjà maintenant que nous ne pourrons dans cette intervention que soulever un certain nombre de questions qui, espérons-le, pourront être enrichies dans notre travail collectif et approfondies dans de futurs travaux. Mais il est impensable pour l’instant de vraiment faire le tour d’une question dont on ne commence qu’à entrapercevoir la profondeur des implications.
1. Le droit des juristes et le Droit des anthropologues. Fondements épistémologiques pour s’engager dans une approche « alternative » du Droit
Il est fort utile de bien clarifier nos prémisses épistémologiques si nous voulons approfondir les enjeux de ce que l’on appelle communément les pratiques alternatives du Droit. Il semble en effet qu’on ait tendance à confondre deux acceptations très différentes du terme Droit lorsqu’on aborde les pratiques alternatives – peut-être même encore plus dans le cadre plus spécifique des actions menées par Juristes-Solidarités. En effet, cette association entretient depuis sa création des relations étroites avec le Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris (LAJP) et est ouverte à un éclairage anthropologique de son activité et du phénomène juridique (Martin 1998). Or le « droit » des juristes et celui des anthropologues n’est pas le même et je les distinguerai par la suite en identifiant le premier par un « d » minuscule et le second par un « D » majuscule. On pourrait faire une première distinction en disant que le « droit » des juristes est plutôt le « droit des manuels » (Alliot 1985), des codes et au sens plus large des textes, alors que le « Droit » des anthropologues est plutôt le « droit vivant » ou celui des pratiques, voire le « phénomène juridique » qu’on pourrait définir comme ce qui met en forme et met des formes à la reproduction de notre humanité dans les domaines que nos sociétés considèrent comme vitales. Cette première distinction est utile pour prendre conscience de deux façons différentes d’être alternatif dans le domaine du « juridique ».
Commençons par l’approche alternative du droit dans le premier sens où la pratique alternative constitue une pratique alternative du droit (avec un petit « d »). Les illustrations qu’en donne Juristes-Solidarités sont celles d’une interprétation du droit par des juristes ou une mobilisation des ressources du droit existant par des groupes particuliers pour faire accepter leurs revendications. On pourrait parler ici d’une approche et d’une utilisation émancipatrice du droit existant (voir de Sousa Santos 1995). Ce genre d’action ou d’activisme nous fait prendre conscience du caractère hautement politique du droit (voir par exemple Le Roy 1991, 1993). Contrairement à ce que l’on enseigne dans les Facultés de droit où on relève que l’un des signes diacritiques de ce dernier est sa « neutralité » on prend ici conscience que le droit exprime et enterrine des intérêts spécifiques. On commence à s’acheminer vers une vision plus anthropologique où le droit n’apparaît plus simplement comme un corpus de textes flottant au dessus de la société et qui est supposé s’y appliquer avec plus ou moins de succès et de bonheur, mais comme partie émergée de l’iceberg du Droit, « phénomène juridique » que Michel Alliot (1983 : 85-86) définissait comme « lutte et consensus sur le résultat des luttes dans les domaines qu’une société considère comme vitaux ». Ensuite, on prend conscience non seulement du caractère politique du droit positif mais aussi de son interprétation et de son application par les juges. Le juge n’est pas le simple porte-parole de la Loi. Bien que devant s’inscrire dans le cadre préétabli du droit positif il a néanmoins à travers son pouvoir d’interprétation une assez grande marge de manœuvre dans sa manière de dire le droit (Ost & van de Kerchove 1989) – et comme le relève le document de Juristes-Solidarités( Huyghebaert 2000) des juges engagés n’hésitent pas à utiliser cette marge pour faire avancer des causes auxquelles ils sont sensibles. Enfin on se rend compte qu’une attitude active face au droit, une prise en main de celui-ci par les acteurs concernés au lieu d’une délégation de responsabilité aux « professionnels du droit » et en premier lieu des avocats, permet d’influer sensiblement sur la pratique du droit et sur les décisions de justice rendues. L’exemple des paysans en France regroupés en lobby pour défendre leur point de vue face à la Justice est parlant, ainsi que celui des travailleurs indiens à Bombay s’entraînant à plaider et plaidant eux-mêmes leur cause face à leurs employeurs.
Cette première catégorie de pratiques alternatives du droit qui reste inscrite dans le cadre du droit positif et du « droit des juristes » lance déjà un premier défi aux approches positivistes du droit : rien n’oblige d’aborder le droit comme un simple instrument de gestion rationnelle des sociétés entre les mains de professionnels et de spécialistes (voir Eberhard 1999). Cette image ne correspond en premier lieu pas à la pratique effective du droit telle qu’elle apparaît dès lors qu’on intègre un point de vue plus sociologique ou anthropologique à côté de l’approche purement juridique. Ensuite, on se rend compte du caractère « responsable » et « citoyen » que peut revêtir une pratique du droit à tous les niveaux si on accepte de faire du droit son affaire et de ne pas déléguer ses responsabilités à d’autres, que ce soit les professionnels en ce qui concerne les utilisateurs, « l’État » ou « les textes » en ce qui concerne avocats et juges, et la « Grundnorm » ou la Constitution et ses principes transcendants en ce qui concerne le législateur. On pourrait dire que si tous prenaient le droit au sérieux on pourrait s’acheminer vers un « jeu du droit » où « créateurs » (législateur), appliqueurs (magistrats et avocats) et « utilisateurs » de droit pourraient tous jouer un rôle important en négociant ensemble les modalités de notre vivre ensemble.
Ensuite se pose la question d’une approche alternative du Droit au sens plus fort de phénomène juridique. L’intérêt des anthropologues pour les pratiques des acteurs nous fait tout d’abord plonger dans les défis du pluralisme juridique qui remettent en cause les constructions monistes du Droit. Le Droit ne se résume pas au droit étatique. Il existe d’autres ordres normatifs qui complètent ou parfois contredisent cet ordre. Ainsi le pluralisme juridique nous lance le défi de repenser le Droit autrement qu’à travers le topos exclusif du droit étatique. Il nous oblige à nous ouvrir à d’autres topoi et donc à une démarche diatopique et dialogale (Vachon 1990b). Et il est primordial de noter que dans de nombreux contextes non-occidentaux ce sont ces autres topoi qui sont plus centraux dans la régulation sociale que le topos étatique. On peut même noter une revalorisation de ces topoi après l’expérience amère des promesses non tenues de la modernité qui a révélé son caractère mythique (voir par exemple Sall 1996). Plus fondamentalement d’ailleurs, dès lors que nous nous ouvrons aux expériences d’autres cultures nous sommes obligés de constater la « non-universalité du droit » (Sinha 1995). De nombreuses cultures n’ont pas dans leur culture, dans leur langue, des concepts équivalents à celui de « droit ». Mais nous laisserons pour l’instant de côté cette question et n’y reviendrons que lors de notre dernière partie où nous tenterons de dégager des pistes pour des alternatives fondamentales au « droit moderne » à travers le dialogue interculturel et où nous approfondirons ce que signifie la prise au sérieux des diverses « cultures juridiques homéomorphes » de notre monde (Vachon 1990). Mais la reconnaissance d’une multitude d’ordres normatifs n’est pas suffisante. Il semble que nous soyons en plus invités à repenser de manière « multijuridique » (Le Roy 1998) la reproduction de nos sociétés contemporaines et d’aborder le droit et le Droit à travers le grand « jeu des lois » de notre vivre ensemble (Le Roy 1999) ce qui permettra d’aborder des alternatives au modèle moderne de « l’État de Droit ».
2. Le Droit dans le grand jeu de la reproduction de nos sociétés. Pour une approche complexe et dynamique de « l’état de Droit »
Aborder le Droit non plus uniquement comme un système normatif, distinct du reste de la réalité sociale, voire autopoïétique, et qui organise cette dernière par son extériorité, mais comme « Droit-comme-règle-du-jeu » (Le Roy 1999 : 36) de la reproduction de nos vies en société semble constituer une rupture épistémologique fondamentale qui semble inévitable pour relever les défis qui émergent avec ce que André-Jean Arnaud appelle la « postmodernité ». Ces défis sont (plus spécifiquement pour le juriste) ceux du pragmatisme, du décentrement du sujet, du relativisme, de la pluralité des rationalités, des logiques éclatées, de la complexité, du retour de la société civile et du risque pour ne reprendre que les éléments dégagés par André-Jean Arnaud (1998 : 153). Nous y rajouterions ceux du pluralisme et de l’interculturalisme (voir par exemple Eberhard 1999b).
Aborder le « Droit » comme « règle du jeu social » qui permet la reproduction de nos sociétés nous invite à un changement de perspective radical. Il s’agit de s’émanciper d’une épistémologie de la simplicité où on restait enraciné dans des visions où en dernière analyse c’est le droit, ou le juridique au sens moderne qui continuait toujours à surdéterminer le reste du social pour s’engager dans une épistémologie de la complexité (Le Roy 1999 : 45 ss ; 177 ss) qui oblige à s’ouvrir à la totalité sociale, à ses diverses composantes et à leurs multiples interactions dynamiques. On passe ainsi d’une part d’une épistémologie de la transparence à une épistémologie de l’opacité (Le Roy 1999 : 388) et d’une épistémologie structurale à une épistémologie processuelle et dynamique (Le Roy 1999 : 29 ss). Pour concrétiser cette transition paradigmatique où il s’agira de réfléchir non plus au droit ou à la reproduction sociale à partir du topos du droit mais au Droit, phénomène juridique, à partir de la totalité sociale où d’une part il s’inscrit et que d’autre part il contribue à mettre en forme, Étienne Le Roy propose une approche en termes de « jeu des lois » (1999) qu’il nous semble utile d’approfondir ici car elle illustre comment d’ « alternatives » ce qu’on appelle communément les « pratiques alternatives du Droit » deviennent centrales et apparaissent tout d’un coup au cœur du « mystère » du Droit. Ce qui oblige de nous engager dans des approches alternatives pour repenser nos Droits dans nos sociétés contemporaines.
En partant des pratiques des acteurs et en les prenant au véritablement au sérieux nous sommes finalement obligés de repenser autrement nos théories du Droit. Rappelons nous que le rôle du chercheur est de rendre compte de la réalité et proposer des modèles permettant de la rendre intelligible : il faut donc que ces modèles collent à la réalité et il faut se garder de la tentation, oh combien grande, de vouloir faire coller la réalité à ses théories, aussi belles ou parfaites qu’elles puissent sembler. Mais nous voilà aussi, et encore une fois, renvoyés de manière fondamentale à la dimension « alternative » d’une telle démarche. L’anthropologue du Droit a, en effet, une double inscription. Si son inscription anthropologique lui impose les contraintes de la scientificité, son inscription juridique lui impose de réfléchir à l’utilisation de ses « trouvailles » par rapport à l’organisation du social : « à qui ça sert, à quoi ça sert ? » pour reprendre la principale consigne d’Étienne Le Roy à tout chercheur en anthropologie du Droit à la fin de l’introduction à son manuel (1999 : 34). Réfléchir au Droit à partir de la totalité sociale implique une perspective particulière consistant à considérer comme important ce que les divers acteurs sociaux font et ce qui leur apparaît comme important et légitime. C’est aussi accepter de repenser nos droits étatiques à l’aune de cette exigence dialogale visant à prendre au sérieux les diverses perspectives. Et ceci apparaît d’autant plus pressant qu’on se situe dans des contextes ou l’État est une réalité assez lointaine pour de grands pans des populations comme c’est le cas par exemple dans le contexte africain. Il apparaît dans cette perspective, et nous n’y insisterons pas beaucoup ici, qu’il convient de fondamentalement repenser nos approches de l’État de Droit d’abord dans les contextes où nous l’avons exporté et où il continue de s’obstiner à ne pas fonctionner, puis chez nous.
L’État de Droit repose sur trois piliers. Il est fondé sur des normes générales et impersonnelles inscrites dans la hiérarchie du système juridique, supposées connues par tous et préexistants aux litiges, sur l’obligation de l’autorité instituante (l’État) de respecter les règles qu’elle a formulée et enfin sur « l’exigence de conformité du Droit à des valeurs de société correspondant à une éthique commune au plus grand nombre » (Le Roy 1999 : 266). C’est sur ce dernier fondement qu’il s’agira de s’appuyer pour s’orienter d’une réflexion uniquement en termes de « transplantation du modèle moderne de l’État de droit » sur toute la planète vers une réflexion en termes de réalisation d’ « états de Droit » comprises comme situations de Droit (Le Roy 1999 : 264) bâtissant sur les représentations et pratiques des acteurs concernés. Cette exigence n’est pas uniquement « éthique » pour rendre justice aux exigences du dialogisme et de l’interculturalisme mais est aussi hautement pragmatique : l’État de Droit moderne nécessite une infrastructure extrêmement lourde et coûteuse que ne peuvent se permettre de nombreux États (fonctionnaires, publication de journaux, cadastres etc.). L’État ne peut donc pas gérer toute la société dans un monopole – il est important que des pouvoirs soient délégués que des articulations entre « droit moderne » et « droits vivants » soient trouvés afin de tendre vers l’idéal d’une sécurisation de tous les acteurs dans le jeu social.
Pour illustrer notre propos afin de rendre plus concrètes nos élucubrations, il est utile de se reporter à l’ouvrage collectif d’Étienne Le Roy, d’Alain Karsenty et d’Alain Bertrand sur la sécurisation foncière en Afrique (1996) qui aborde une telle problématique. Étienne Le Roy (1996 : 185-186) insiste dans les prolégomènes à l’analyse dynamique de la gestion foncière qui sera développée ensuite en suivant la démarche du « jeu des lois / jeu de l’oie » sur le fait que « Nous ne reviendrons pas sur une analyse de ce qu’implique la référence à l’exigence de ‘l’État de Droit’. Nous avons déjà indiqué par ailleurs qu’il ne s’agit pas seulement d’obliger le législateur, et plus généralement l’État africain, à fonder sa politique sur des normes générales et impersonnelles préexistantes aux conflits (première condition) ou à accepter d’être tenu par les règles qu’il énonce (deuxième condition). Il convient, en outre, que les normes et les sanctions soient fondées sur des valeurs et des représentations partagées par le plus grand nombre (troisième condition, généralement ignorée). Ceci implique de renoncer aux dispositifs du droit ‘savant’, celui des élites plus ou moins directement transposé des législations occidentales, pour promouvoir un cadre de régulation inspiré du droit ‘vivant’, ‘pratique’, tel qu’il est vécu par les populations rurales africaines. » Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra faire justice à la contemporanéité africaine qui se situe ni dans la « tradition » ni dans la « modernité » mais dans un entre-deux qu’il s’agira de garder ou de rendre créatif et qui est, comme on peut facilement l’imaginer, éminemment complexe. C’est pour pouvoir aborder cette complexité que le modèle du jeu des lois a été proposé. Il s’agit de rentrer dans la réflexion sur le Droit et de la sécurisation foncière non pas du point de vue du système juridique, et qui peut mener à une approche tout à fait déconnectée des réalités du pays, mais de celui des acteurs jouant le jeu social autour de cette problématique. On entrera ainsi dans le « jeu » autour du foncier par les statuts des acteurs puisque ceux-ci sont toujours inscrits dans des collectifs divers et ne se résument pas à des individus généraux et abstraits (case 1). On poursuivra par les ressources (2) autant matérielles, qu’humaines ou idéelles qu’ils peuvent mobiliser dans leurs conduites (3) plus réactives (tactiques) ou plus stratégiques, qui s’inscrivent dans des logiques (4) plus institutionnelles ou plus fonctionnelles, dans des espaces (5) et des temporalités (6) plus ou moins grands, et s’expriment dans des forums divers (7) qui peuvent être traditionnels ou modernes plutôt de négociation ou de confrontation, en fonction des enjeux (8) de la partie, de ce qui peut être gagné ou perdu, et qui se cristalliserons dans des ordonnancements (9), au sens de mise en forme du social, plus imposés, négociés, acceptés voire qui peuvent mener à une contestation de l’ordre établi. C’est à travers toutes ces cases qu’on en arrive finalement aux règles du jeu dans le domaine du foncier qui sont autant constitués de normes générales et impersonnelles, que de modèles de conduite et de comportements que d’habitus ou systèmes de dispositions durables selon Bourdieu. Car comme le montrent les analyses contemporaines de l’anthropologie du Droit, le Droit ne repose pas sur un unique fondement, les normes générales et impersonnelles auxquelles nous avons tendance à le réduire dans les traditions civilistes, mais est tripode : le phénomène juridique est un processus continue qui s’approche à travers le jeu de ses trois pôles constitutifs énumérés ci-dessus (Le Roy 1998 ; 1999 : 189 ss).
La prise en compte des « pratiques alternatives » est dans une telle démarche primordiale. En effet, dans le jeu foncier en Afrique on peut identifier trois pôles d’acteurs : l’État africain, les organisations locales de producteurs et les bailleurs de fonds internationaux (1996 : 215 ss). Le jeu se joue entre ces trois acteurs, et que bien qu’ils s’inscrivent tous dans des logiques différentes et qu’ils poursuivent tous des objectifs particuliers, on ne peut ignorer l’un d’eux ou construire l’un d’eux a priori comme « mauvais joueur », comme on a souvent tendance à le faire avec l’État ou les bailleurs de fonds si on se situe dans des approches se voulant « alternatives ». La question qui se pose à nous de nos jours nous semble bien être de penser le ET dans toute sa complexité plutôt que d’opposer des réalités en postulant que l’une d’elles détient toute la vérité. On constate en effet, que si de nombreux juristes ou « développeurs » survalorisent et idéalisent le rôle du droit et de la justice étatique, de nombreux penseurs alternatifs survalorisent les « grassroots » ou la « base », et en font une présentation idyllique qui fait abstraction d’une part des contextes modernes qui sont là et ont des effets réels et d’autre part de leur complexité interne.
D’une part l’État existe, le marché international existe, les firmes multinationales existent, quoi que l’on puisse en penser. Il faut donc accepter l’existence de ces réalités pour les intégrer dans notre réflexion, tout autant qu’il faut intégrer les réalités des visions du monde, logiques et pratiques « alternatives ». D’autre part, les réalités aux « grassroots » ne sont pas toujours aussi idylliques qu’on les présente – ce serait là peut-être un effet d’englobement de contraire inversé qui nie la complexité des situations existentielles des « autres » où il existe aussi des phénomènes d’exploitation, de domination etc. (voir Mahajan 1998 : 26). Vu que certains d’entre nous ont été déçus par la modernité, ils pensent trouver chez les autres des modes de vie « authentiques », plus « harmonieux », plus près d’une « sagesse primordiale » etc. Nous ne nions pas que nous pouvons trouver des choses très valables et très précieuses dans nos diverses traditions humaines et le dialogue interculturel sur nos problèmes fondamentaux ne nous semble pas uniquement souhaitable mais indispensable mais il y a un problème si nous construisons encore l’Autre avant tout par rapport à notre propre expérience et comme notre image inversée. Cette fois, notre image de nous-mêmes étant négative en projetant une image positive sur l’autre – ce qui ne le fige pas moins dans ce qu’il n’est pas.
Il y a donc un jeu complexe qui se noue entre les différents acteurs du foncier. Invitant notre lecteur à se reporter directement à l’ouvrage collectif d’Étienne Le Roy Étienne, d’Alain Karsenty et d’Alain Bertrand (1996), nous nous contenterons de relever l’importance de la prise en compte dans la réflexion des « pratiques alternatives » des acteurs à la base pour une approche renouvelée de la sécurisation foncière et de « l’état de Droit » en Afrique. Pour Étienne Le Roy (Le Roy, Karsenty & Bertrand 1996 : 240-241, 243) « (…) il n’y aura pas, dans les États d’Afrique francophone, une bonne gestion de la terre et de ses ressources sans une profonde réforme des conceptions et des fondements du Droit et de l’État. (…) Il est nécessaire de fonder la légitimité de nouveaux organes de gestion sur une autonomie institutionnelle et sur leur capacité à répondre au besoin de sécurisation patrimoniale. (…) Il convient (…) que ce dispositif soit conçu comme l’expression d’un consensus négocié par les parties prenantes plutôt que l’affirmation de principes d’essence universelle et de nature abstraite, venant de l’extérieur de la société et s’imposant indiscutablement à ses membres. (…) c’est l’autorité qui fait la patrimonialité (…) Plutôt qu’à une définition abstraite et mimétique de l’intérêt général, une autorité foncière ou de gestion de ressources naturelles doit répondre aux préoccupations des usagers et y répondre prioritairement, surtout lorsqu’il s’agit de protection des sols et de baisse de fertilité, par des actions visibles et communes dépassant les seuls intérêts locaux, individuels ou technocratiques. » Mais pour arriver à ce genre d’arrangement encore est-il primordial d’ouvrir sa conception du Droit à travers une perspective anthropologique qui fait apparaître ce dernier comme « lutte et consensus sur le résultat des luttes dans les domaines qu’une société considère comme vitaux » (Alliot ) et pour citer le doyen Hauriou (in Le Roy, Karsenty & Bertrand 1996 : 267) comme ce qui « constate des armistices sociaux ». En effet, dans le contexte africain de nombreux armistices existent bien qu’ils ne soient pas reconnus sur la scène officielle et qu’ils ne soient pas canonisés dans les formes du droit étatique. « Dans la mesure où les États et les bailleurs de fonds ont été amenés, par opportunité ou sens tactique, à accepter l’informalité dans les rapports économiques, l’irrégularité ou l’indocilité dans le fonctionnement du système politique, l’illégalité dans la vie juridique, ils ont manifesté des formes de connivence ou de gestion participative qui expriment autant leur propre ‘domestication’ qu’une adhésion minimale des populations. Pour expliquer cet enchâssement des acteurs, de leurs ressources, de leurs conduites, de leurs enjeux, il faut une conception renouvelée du juridique. Par l’expression ‘droit de la pratique’ nous avons commencé (…) à en dégager les soubassements. La pratique n’est pas seulement la praxis opposée au logos du Droit officiel étatique. C’est aussi la clientèle de l’homme de l’art, dans le cas, celle des courtiers du développement qui organisent ou stimulent les filières, animent les ‘grappes’, coordonnent les dons et les recours. Expression de ces ‘cultures communes’ en émergence dans divers pays, les pratiques articulent sur un mode souvent endogène une lecture exogène de la loi ou du code. A la manière d’un pidgin, ces nouvelles formulations ‘articulent’ les diverses composantes de la société pour réduire l’écart entre tradition et modernité et faire, dans cet ‘entre-deux’ toujours tensionnel, de leurs pratiques les leviers de leur développement. Le Droit de la pratique ne s’oppose ni au Droit officiel ni aux régulations coutumières qui, intervenant à des échelles différentes, expriment des besoins (donc des logiques) qui ne sont pas nécessairement concurrentiels. Par sa fonction d’articulation, il permet de répondre au souci de faire émerger une unité juridique qui ne soit pas fondée sur l’uniformité mais bien sur la complémentarité des différences (qui reste un idéal dominant des sociétés africaines. Il répond ainsi au souhait de disposer d’un Droit ‘à géométrie variable’, un Droit susceptible de s’adapter aux divers enjeux, donc de mobiliser des dispositifs de régulation propres aux statuts des acteurs ou au fonctionnement des forums, de manière processuelle ou dynamique mais aussi fonctionnelle. (…) Ces formules institutionnelles ne peuvent cependant être concrétisées à l’encontre de l’exigence de l’État de Droit qui demande également à être repensé. » (Le Roy, Karsenty & Bertrand 1996 : 267-269).
Reste à noter que s’il convient de repenser l’état / État de Droit en prenant en compte les « pratiques alternatives » du Droit il faut néanmoins rester extrêmement vigilants. L’expérience a montré que souvent la mise en forme de l’informel par l’État à d’une part résulté en un plus grand contrôle de ce dernier sur les diverses collectivités plutôt que de leur garantir une certaine autonomie et que d’autre part elle a mené à « désamorcer » les dynamiques émancipatrices de ces pratiques en remplaçant des mouvements de mobilisation en vue d’un changement véritables en miroir aux alouettes qui sous couvert de la prise en compte des revendications, en fait les rend inefficaces et les étouffe ainsi en fin de compte. Notons enfin, que nous avons effectué ici un détour anthropologique par l’Afrique noire francophone et par une problématique particulière qui nous ont permis d’illustrer ce que peut signifier prendre les pratiques alternatives du Droit au sérieux dans ce contexte et de susciter peut-être quelques réflexions à portée plus générale pouvant se révéler intéressantes pour d’autres contextes. Mais n’oublions pas la diversité des situations et les usages alternatifs spécifiques qu’on y rencontre, comme l’illustre si bien le document de Juristes-Solidarités (Huyghebaert 2000 – voir aussi Capeller 1992 : 372 ss ; Rojas 1992 : 411 ss). Et plongeons maintenant dans une autre forme « d’alternatif » fondamental si nous prenons les acteurs, leurs pratiques leurs logiques et leurs représentations du monde au sérieux : celui de l’interculturalisme et du pluralisme de la réalité.
3. Alternatives aux approches modernes du Droit – Le mythe émergent du pluralisme et de l’interculturalisme de la réalité
Nous nous appuierons pour les développements qui suivent sur la démarche interculturelle de Raimon Panikkar et de la manière dont elle a été illustrée et approfondie à l’Institut interculturel de Montréal (IIM) et plus particulièrement par l’un de ses co-directeurs, Robert Vachon. Une contribution de ce dernier (2000), à un numéro récent du Bulletin de Liaison du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris portant sur les Droits de l’homme et les cultures de la Paix et intitulée « Au-delà de l’universalisation et de l’interculturalisation des droits de l’homme, du droit et de l’ordre négocié » peut servir comme bon point de départ à notre réflexion. L’auteur souligne dans ce texte que toutes les réflexions du Laboratoire sur le « droit », les « ordonnancements sociaux », « l’universalisme » apparaissent comme problème commun à toutes les civilisations uniquement à partir de notre fenêtre culturelle : « Le point de référence est universel si on le contemple de la position où est établie la culture qui l’affirme, mais pas universel si le regard qu’on porte sur lui vient du dehors. De l’intérieur, on prend le cadre pour le tout, mais de l’extérieur, on a son propre cadre, sa propre fenêtre. » (Vachon 2000 : 10). Or c’est bien la reconnaissance de la pluralité des fenêtres quant à la manière même de poser nos questions fondamentales, et par là une vision radicalement pluraliste de la réalité (Panikkar 1990 ; Vachon 1997), qui sous-tend toute la démarche de l’IIM. Il ne s’agit pas uniquement de s’ouvrir à un pluralisme juridique en reconnaissant les diverses pratiques des acteurs mais de reconnaître que l’horizon ultime de notre vivre-ensemble ne doit pas forcément être constitué par le Droit, même avec un grand « D », mais qu’il existe d’autres équivalents homéomorphes qui peuvent être moins anthropocentrés et plus cosmo- ou théocentrés (voir Panikkar 1993) tels le dharma indien, le li chinois etc. (voir Eberhard 2000 : 130 ss)
Que cela signifie-t-il par rapport à des approches alternatives du Droit ? Cela signifie qu’il est peut-être nécessaire de compléter les approches alternatives du Droit (avec minuscule et majuscule) comme nous les avons développés précédemment par des approches alternatives au Droit comme référent ultime de notre « vivre-ensemble ». Robert Vachon (1995a, 1995b, 1995c) a très bien illustré ce genre démarche dans un travail intitulé « Guswenta ou l’impératif interculturel » où il a tenté de dégager des fondements interculturels pouvant permettre de s’acheminer vers un accord de Paix entre la Nation canadienne et les nations Mohawk. Il n’est pas possible de reprendre ici le développement de tous ses travaux. Il est néanmoins important de souligner l’originalité de sa démarche : il ne s’agit pas uniquement d’aboutir à une reconnaissance des « droits autochtones » et de parvenir ainsi à une « intégration harmonieuse » des Mohawks dans le cadre de l’État-Nation canadien, ce dernier étant supposé non questionnable et apparaissant du point de vue moderne comme l’horizon ultime de toute négociation. Il s’agit plutôt de se placer dans l’entre-deux créatif de la rencontre entre deux traditions et de deux visions du monde et de favoriser l’émergence d’un accord, d’une concorde entre les deux (Vachon 1995a : 10). Pour ce faire, il faut prendre conscience que nos présupposés respectifs ne sont pas les mêmes et que d’intégrer une vision du monde dans une autre, c’est en fait fondamentalement la transformer. Pour prendre la mesure des enjeux qui nous attendent dès lors que nous nous ouvrons véritablement à une écoute des divers acteurs et à leurs visions du monde qui peuvent être alternatives aux nôtres, il nous semble utile d’illustrer nos propos par quelques exemples concrets que donne Robert Vachon (1995a : 15) par rapport au dialogue entre Nations Canadienne et Mohawk dans leur recherche d’un accord de Paix:
« Les gouvernements occidentaux parleront de revendications territoriales et de négociation (mythe de la territorialité et de la rationalité), alors que les Mohawks parleront plutôt de redressement des torts et de reconfirmation de l’alliance fraternelle, permanente et éternelle, établie au début de la colonie : la Guswenta (basée sur le mythe de Kayanerekowa, « la grande paix ».
Pour le ministre moderne, l’important et le concret c’est le développement économique et l’autonomie gouvernementale des Autochtones (basées sur le mythe anthropocentrique que tout doit être développé et contrôlé par l’être humain, un gouvernement, une constitution écrite). Alors que pour le Mohawk traditionaliste (dont le mythe est plus cosmocentrique), la question primordiale et concrète n’est pas de développer la terre-mère, de la contrôler, mais de s’y harmoniser. Pour lui, l’important n’est pas d’avoir un gouvernement – même autonome – mais d’être membre de la communauté (sans chefs qui commandent et sans sujets qui lui obéissent) du grand cercle des Mohawks, des Haudenosaunee et des autres êtres vivants.
Les gouvernements occidentaux modernes – partant toujours de leur mythe anthropocentrique – parleront de ‘bâtir ensemble notre avenir’, alors que les Mohawk traditionalistes s’intéresseront plutôt à vivre le présent en continuité avec la tradition ancestrale (selon leur mythe cosmocentrique). Les premiers verront la vie surtout comme un problème à résoudre ou quelque chose à achever, alors que les seconds la verront plus comme un mystère de plénitude à découvrir et à laquelle s’harmoniser. Les premiers parleront de mécanismes de prévention et de résolution des conflits alors que les seconds parleront de guérison (healing) en étant fidèles aux cérémonies traditionnelles mohawks.
Un dernier exemple. Les gouvernements et les spécialistes modernes parleront de la nécessité d’un cadre de référence – entendant par là lois, balises, définitions, faites de main d’homme et basées sur des principes cohérents, clairs, bien définis, contrôlables et efficaces. Les Mohawks traditionalistes parleront plutôt du contexte que constituent ‘les dispositions inscrites dans la nature des choses’, ‘le cercle de la vie’, qui échappent finalement à la rationalité et à la pensée humaine, ainsi qu’à son contrôle et ayant leur efficacité propre. »
Il apparaît très clairement que pour s’engager dans de véritables dialogues prenant au sérieux ces différentes perspectives une nouvelle méthode (Vachon 1995c), celle du dialogue dialogal (Panikkar 1984b), est nécessaire ainsi qu’un désarmement culturel fondamental (Eberhard 2000a ; 2000c ; Panikkar 1995 ; Vachon 2000 : 18 ss) qui nous permette d’aborder l’autre sans tomber dans le syndrome du « rouleau compresseur occidental » (Latouche 1991 : 8) que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Ceci suppose aussi de s’ouvrir à ce que Robert Vachon (1997) appelle le « mythe émergent du pluralisme et de l’interculturalisme de la réalité » qui nous pousse à reconnaître que » Si le défi de la pluralité c’est de faire et d’établir l’unité malgré les différences, d’imaginer une société cohérente etc., le défi du pluralisme c’est aussi de vivre l’harmonie dans et à cause des différences et de maintenir la cohésion et l’équilibre organique, sans exiger qu’il y ait toujours pour cela cohérence et unité. C’est l’effort suprême de composer avec la diversité sans abandonner l’identité, en ayant soin d’aborder cette dernière non pas nécessairement et toujours comme l’unité intelligible des éléments ou facteurs pluriels qui constituent soit mon être, soit ma personne ou communauté ou culture (l’identification), mais comme la conscience que ces éléments ou facteurs appartiennent ensemble. L’identité quelle qu’elle soit, ne saurait être réduite aux interprétations qu’on en a ou qu’on peut en avoir. (…) Le pluralisme nous amène à reconnaître qu’il peut y avoir plusieurs centres d’intelligibilité v.g. que le logos n’en est pas l’unique mais qu’il y a aussi le mythos ; qu’à part le monde des concepts et des objets il y a aussi le monde des sujets et des personnes. De plus, il nous amène à reconnaître qu’il n’y a pas de nécessité ou même de convenance que la réalité soit réduite à un seul centre d’intelligibilité à valeur universelle. Il va même jusqu’à nous aider à reconnaître que la réalité n’a pas nécessairement à être intelligible. Cela équivaut à un appel à la confiance cosmique, i.e. à la conviction, croyance, mythe (à l’acceptation, à l’expérience, au postulat) que la réalité est l’ultime terrain que nous ayons pour trouver sens à quoi que ce soit. » (Vachon 1997 : 9-10)
Ainsi notre plongée dans les « pratiques alternatives du droit » nous a tout d’abord ouvert à une autre manière d’envisager et de pratiquer le droit (avec un petit » d ») avant de nous ouvrir à une première vision alternative du droit correspondant à la perspective anthropologique du Droit comme phénomène juridique (avec un grand « D »). Cette deuxième ouverture nous a incité à déplacer nos réflexions sur l’État de Droit en les complétant par des réflexions sur l’état de Droit et nous a donc invité à « repenser notre droit » de manière différente. Enfin, avons-nous été menés par notre prise au sérieux des pratiques et représentations de ceux qui ne partagent pas notre mythe moderne du droit/Droit, et que nous considérons comme étant « à la marge », mais qui inversement peuvent considérer notre modernité comme à la marge de leurs expériences de vie essentielles, à nous ouvrir à l’idée de rechercher des alternatives possibles à notre culture moderne (voir Panikkar 1982). Car « il n’y a pas de pluralisme culturel sans pluralisme politique. Si les diverses cultures sont mises en demeure d’adopter une forme unique de politique, on réduit (…) la culture au folklore. » (Panikkar 1999 : 38).
Peut-être que nous ressortons quelque peu étourdi des perspectives qui se dessinent devant nous. Et le travail pour dégager toutes les implications des pistes dégagées ci-dessus semble considérable. Nous espérons cependant avoir au moins fait sentir l’importance et la pertinence de mener des recherches plus approfondies dans le domaine des « pratiques alternatives du Droit » pour nous donner les moyens de réinventer dans une démarche dialogale les modalités de notre vivre-ensemble contemporain.
Bibliographie :
ABEL Richard, 1981, « Règlement formel et informel des conflits : analyse d’une alternative », Sociologie et Justice, Paris, Seuil
ALLIOT Michel, 1983, « Anthropologie et juristique. Sur les conditions de l’élaboration d’une science du droit », Bulletin de Liaison du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris, n° 6, p 83-117
ALLIOT Michel, 1985, « L’anthropologie juridique et le droit des manuels », Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, p 71-81
ARNAUD André-Jean, 1998, « De la globalisation au postmodernisme en droit » Entre modernité et mondialisation – Cinq leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’État, France, L.G.D.J., Col. Droit et Société n° 20, 185 p (145-178)
BAUMAN Zygmunt, 1987, Legislators and Interpreters – On Modernity, Post-modernity and Intellectuals, Great Britain, Polity Press, 209 p
BAUMAN Zygmunt, 1998, Globalization. The Human Consequences, Great Britain, Polity Press, 136 p
BONAFE-SCHMITT Jean-Pierre, 1987, « La part et le rôle joués par des modes informels de règlement des litiges dans le développement d’un pluralisme judiciaire (Étude comparative France-USA), Droit et Société, n° 6
BOURDIEU Pierre, 1986, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, septembre, p 3-19
CAPELLER Wanda de Lemos, 1992, « Un regard différent : l’Amérique latine, les juristes et la sociologie », Droit et Société, n° 22, p 363-373
de SOUSA SANTOS Boaventura, 1995, Toward a New Commnon Sense – Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, New York-London, Routledge, After the Law Series, 614 p
DUMONT Louis, 1991 (1983), Essais sur l’individualisme – Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Saint Amand (Cher), Seuil, 3e éd., Col. Points, Série Essais, 310 p
EBERHARD Christoph, 1999a, « Les politiques juridiques à l’âge de la globalisation. Entre archétypes, logiques, pratiques et ‘projets de société’. », Bulletin de liaison du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris, n° 24, p 5 – 20
EBERHARD Christoph, 1999b, « Pluralisme et dialogisme. Les droits de l’homme dans une mondialisation qui ne soit pas uniquement une occidentalisation », Revue du MAUSS semestrielle, n° 13, 1er semestre, p 261-279
EBERHARD Christoph, 2000a, Droits de l’homme et dialogue interculturel. Vers un désarmement culturel pour un Droit de Paix, Thèse de Doctorat en Droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 464 p (synthèse consultable sur http://www.dhdi.org)
EBERHARD Christoph, 2000b, « Justice, Droits de l’Homme et globalisation dans le miroir africain : l’image communautaire », Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques, n° 45, p 57-86
EBERHARD Christoph, 2000c, « Ouvertures pour la Paix. Une approche dialogale et transmoderne », Bulletin de liaison du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris, n° 25, p 97-113
EBERHARD Christoph, 2001, « Towards an Intercultural Legal Theory – The Dialogical Challenge », à paraître dans Social & Legal Studies. An International Journal
ESTEVA Gustavo, 1993, La nouvelle source d’espoir : « les marginaux », Interculture, n° 119, 66 p
ESTEVA Gustavo, PRAKASH Madhu Suri, 1998, Grassroots Post-Modernism – Remaking the Soil of Cultures, United Kingdom, Zed Books, 223 p
HESSELING Gerti, LE ROY Étienne, 1990, « Le Droit et ses pratiques », Politique Africaine, Décembre, n° 40, p 2-11
HURTADO Fernando Rojas, 1992, « Les services juridiques alternatifs en Amérique latine. Réflexions à propos des résultats d’une recherche », Droit et Société, p 409-431
HUYGHEBAERT Patricia, 2000, 1989-1999 : Capitalisation de 10 années d’expériences. Un état des lieux des pratiques alternatives de droit (Afrique, Amérique Latine, Asie, Europe, Maghreb), Juristes-Solidarités, Paris, 110 p
KOTHARI Rajni, 1990, State against Democracy. In search of Humane Governance, India, Aspect Publications Ltd, 308 p
LATOUCHE Serge, 1991, La planète des naufragés – Essai sur l’après-développement, Saint-Amand (Cher), La Découverte, Col. Essais, 235 p
LE ROY Étienne, 1990, « Le justiciable africain et la redécouverte d’une voie négociée de règlement des conflits », Afrique Contemporaine, 4e trimestre, n° 156 (spécial), p 111-120
LE ROY Étienne, 1991, « Les usages politiques du droit », COULON Christian, MARTIN Denis-Constant (éds.), Les afriques politiques, Saint-Amand (Cher), La Découverte, Col. Textes à l’appui, Série Histoire contemporaine, 294 p (109-122)
LE ROY Étienne, 1992, « Un droit peut en cacher un autre », Informations sociales, Mars, n° 22, p 10-19
LE ROY Étienne, 1993, « De la norme à la pratique du droit, construire le droit », Bulletin de Liaison du LAJP, n°18, juin, p 64-71
LE ROY Étienne, 1997, « La face cachée du complexe normatif en Afrique noire francophone », ROBERT Philippe, SOUBIRAN-PAILLET Francine, van de KERCHOVE Michel (éds.), Normes, Normes juridiques, Normes pénales – Pour une sociologie des frontières – Tome I, CEE, L’Harmattan, Col. Logiques Sociales, Série Déviance/GERN, 353 p (123-138)
LE ROY Étienne, 1998, « L’hypothèse du multijuridisme dans un contexte de sortie de modernité », LAJOIE André, MACDONALD Roderick A., JANDA Richard, ROCHER Guy (éds.), Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Bruxelles, Bruylant/Thémis , 266 p (29-43)
LE ROY Étienne, 1999, Le jeu des lois. Une anthropologie « dynamique » du Droit, France, LGDJ, Col. Droit et Société, Série anthropologique, 415 p
LE ROY Étienne, KARSENTY Alain, BERTRAND Alain (éds.), 1996, La sécurisation foncière en Afrique – Pour une Gestion viable des ressources renouvelables, Clamecy, Karthala, 388 p
LUMMIS C. Douglas, 1996, Radical Democracy, Ithaca and London, Cornell University Press, 185 p
MAHAJAN Gurpreet, 1998, Identities and Rights. Aspects of Liberal Democracy in India, India, Oxford University Press, 190 p
MARTIN Boris, 1998, « Lorsque recherche et pratique se rejoignent : l’exemple du Laboratoire d’Anthropologie Juridique et de l’Association Juristes-Solidarités », Bulletin de liaison du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris, n° 23, p 63-64
OST François & van de KERCHOVE Michel, 1989, Entre la lettre et l’esprit. Les directives
d’interprétation en Droit, Bruxelles, Bruylant, 334 p.
OST François, van de KERCHOVE Michel, 2000, « De la pyramide au réseau ? Vers un nouveau mode de production du droit ? », Revue Interdisciplinaire d’Études Juridiques, n° 44, p 1-82
PANIKKAR Raimundo, 1982, « Alternatives à la culture moderne », Interculture, Vol. XV, n° 4, Cahier 77, p 5-16
PANIKKAR R., 1984 (1982), « La notion des droits de l’homme est-elle un concept occidental ? », Interculture, Vol. XVII, n°1, Cahier 82, p 3-27
PANIKKAR Raimon, 1984b, « The Dialogical Dialogue », WHALING F. (éd.), The World’s Religious Traditions, Edinburgh, T. & T. Clark, 311 p (201-221)
PANIKKAR Raimon, 1990, « The Pluralism of Truth », Harry James Carger (éd.), Invisible Harmony. Essays on Contemplation and Responsibility, USA, Fortress Press, 210 p (92-101)
PANIKKAR Raimon, 1993, The Cosmotheandric Experience – Emerging Religious Consciousness, New York, Orbis Books, 160 p
PANIKKAR Raimon, 1995, Cultural Disarmament – The Way to Peace, USA, Westminster John Knox Press, 142 p
PANIKKAR Raimon, 1999, « La découverte du métapolitique », Interculture, n° 136, p 24-60
POPPOVIC Malak El-Chichini Poppovic & PINHEIRO Paulo Sérgio, 1996 « Pauvreté, droits de l’homme et processus démocratique », Droit et Société, n° 34, p 635-648
ROULAND Norbert, 1988, Anthropologie juridique, France, PUF, Col. Droit fondamental Droit politique et théorique, 496 p
ROULAND Norbert, 1993, Aux confins du droit, Mayenne, Odile Jacob, 318 p
SALL Babacar, 1996, « Anétatisme et modes sociaux de recours », Cahier du GEMDEV, n° 24, p 169-176
SINHA Surya Prakash, 1995, « Legal Polycentricity », PETERSEN H., ZAHLE H. (eds.), Legal Polycentricity : Consequences of Pluralism in Law, UK, Dartmouth, 245 p (31-69)
VACHON Robert (éd.), 1990a, Alternatives au développement. Approches interculturelles à la bonne vie et à la coopération internationale, Victoriaville (Québec), Institut Interculturel de Montréal – Édititons du Fleuve, Col. Alternatives, 350 p
VACHON Robert, 1990b, « L’étude du pluralisme juridique – une approche diatopique et dialogale », Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, n° 29, p 163-173
VACHON Robert, 1995a, Guswenta ou l’impératif interculturel – Première partie : Les fondements interculturels de la paix, Interculture, Vol. XXVIII, n° 2, cahier n° 127, 80 p
VACHON Robert, 1995b, Guswenta ou l’impératif interculturel – Partie 1, Volet II : Un horizon commun, Interculture, Vol. XXVIII, n° 3, cahier n° 128, 43 p
VACHON Robert, 1995c, Guswenta ou l’impératif interculturel – Volet III : Une nouvelle méthode, Interculture, Vol. XXVIII, n° 4, cahier n° 129, 47 p
VACHON Robert, 1997, « Le mythe émergent du pluralisme et de l’interculturalisme de la réalité », Conférence donnée au séminaire Pluralisme et Société, Discours alternatifs à la culture dominante, organisé par l’Institut Interculturel de Montréal, le 15 Février 1997, 34 p, consultable sur http://www.dhdi.org
VACHON Robert, 1998, « L’IIM et sa revue : Une alternative interculturelle et un interculturel alternatif », Interculture, n° 135, p 4-75
VACHON Robert, 2000, « Au-delà de l’universalisation et de l’interculturation des droits de l’homme, du droit et de l’ordre négocié », Bulletin de liaison du Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris, n° 25, p 9-21
VANDERLINDEN Jacques, 1993, « Vers une nouvelle conception du pluralisme juridique », Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, XVIII, 2, p 573-583
VANDERLINDEN Jacques, 1996, Rendre la production du droit aux « peuples », PolitiqueAfricaine, n° 62, p 83-94
Cet article constitue une contribution de l’auteur au workshop « Les usages alternatifs du Droit », organisé par Juristes-Solidarités à l’Institut International de Sociologie Juridique à Onati, 16-18 mai 2001)