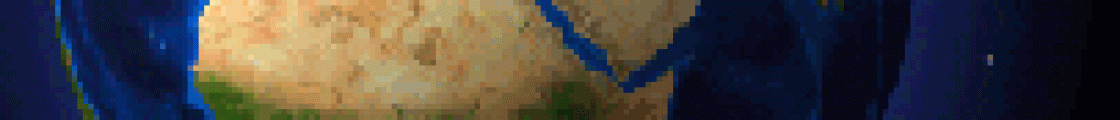En tant que membre de ce groupe appelé « Arabes israéliens », je vais tenter, à travers ma propre expérience que je qualifie désormais de « palestinienne » et non plus d’« arabe israélienne », d’expliquer les raisons de ce changement. J’espère sincèrement par ce bref paragraphe descriptif aider à une meilleure appréhension de la situation globale des Arabes d’Israël.
Je suis née et j’ai grandi à Nazareth, la plus grande ville arabe dans le nord d’Israël, dans une famille chrétienne maronite bénéficiant d’un statut socio-économique aisé. Bien que Nazareth soit une ville comprenant aussi bien des musulmans que des chrétiens, j’ai essentiellement grandi dans un environnement chrétien catholique. Seule une famille musulmane vivait dans notre voisinage et je me rappelle qu’on disait d’elle : « c’est une famille calme et pacifique comme nous ». Enfant, je fréquentais une école française catholique privée où une large majorité d’élèves et d’enseignants étaient chrétiens. Pratiquement tous les chrétiens et musulmans issus d’une classe sociale aisée fréquentent des écoles privées encore aujourd’hui car le niveau scolaire y est bien plus élevé que dans les établissements publics. Toutefois, cette majorité chrétienne a disparu dans le secondaire car de nombreux élèves musulmans, originaires des villages environnants, fréquentent les collèges et lycées de Nazareth puisqu’il n’existe pas d’établissements scolaires en dehors de la ville. En tant que maronite, j’appartenais aux « scouts du Cèdre maronite », ce qui tendait à renforcer mon attachement à l’Église et, d’une certaine façon, au Liban. On nous distribuait des tee-shirts avec le cèdre libanais dans le dos et l’inscription « Je t’aime Liban » sur la poitrine.
La politique ne jouait pas un grand rôle dans ma vie quotidienne et je fus élevée en tant qu’Arabe israélienne mais surtout en tant que chrétienne et maronite.
De l’identité arabe israélienne à l’identité palestinienne
Le terme « palestinien » m’était relativement « étranger », même après la création du Mouvement de libération pour la Palestine. Je savais que j’étais arabe mais je m’identifiais en tant qu’Arabe d’Israël. Je n’utilisais le terme « palestinienne » ni pour me définir, ni pour désigner la majorité des Arabes vivant en Israël. D’ailleurs, on appelait les gens vivant en Cisjordanie Dafawi, et dans la Bande de Gaza Gazaoui,et non pas Palestiniens.
Dans ma famille, on évitait de parler de politique, excepté lorsqu’on parlait des activités politiques de mon grand-oncle qui était le secrétaire de la branche du Parti travailliste israélien à Nazareth. Comme la majorité des habitants de Nazareth à cette époque, nous étions affiliés au Parti travailliste. Cela a commencé à changer dès 1975, après la victoire du Parti communiste aux élections locales de Nazareth, qui a écarté la liste soutenue par des partis israéliens juifs pour les élections locales des conseils arabes affiliés au Parti travailliste.
Mon identité actuelle et ma conscience socio-politique de minoritaire dans l’État d’Israël sont constituées de plusieurs éléments. Ce processus identitaire a débuté lors de mon adolescence, lorsque j’ai commencé à m’interroger sur les déterminants religieux chrétiens et plus précisément maronites de mon identité. Les massacres de Sabra et Chatila – deux camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth-Ouest au Liban -, perpétrés les 16 et 17 septembre 1982 par les phalangistes, milice chrétienne libanaise dirigée par Élie Hobeika, dans un secteur occupé par l’armée israélienne depuis l’opération Paix en Galilée, et le sentiment d’injustice et de révolte que j’ai ressenti, ont fortement influencé cette remise en question identitaire. Je ne pouvais pas « appartenir » à la communauté maronite dont sont issus certains des membres du groupe des phalanges qui ont participé au massacre. Bien que ce fût la première fois que je rejetais fermement une part de mon identité, je me suis néanmoins toujours interrogée sur mes origines. Je me suis toujours demandé pourquoi je ne pouvais pas voir mon oncle vivant au Qatar ? Pourquoi ne pouvait-il pas nous rendre visite ? Pourquoi ne devais-je pas prononcer « Israël » quand je lui parlais au téléphone ? Mes parents ne m’ont jamais fourni les réponses que j’attendais, bien au contraire, ils me disaient : « Il faut rester en dehors de la politique. » Pour moi, il ne s’agissait pas de politique, mais simplement de mon identité familiale et de mon histoire personnelle.
Du côté de mon père, ma famille est originaire du Liban ; du côté de ma mère, de Syrie. Ces deux familles se sont installées sur la terre que l’on appelait autrefois la Palestine et qui, depuis 1948, se nomme Israël. La famille de mon père arriva en Palestine en 1922, celle de ma mère vers 1876.
À l’école, on nous a appris au cours de nos leçons d’histoire que, sous le mandat britannique, la Palestine a été promise au peuple juif pour qu’ils y établissent un État après les terribles discriminations qu’ils ont subies en Europe et surtout à cause de l’Holocauste. On m’a enseigné qu’après un tel désastre il était tout à fait « humain » de promettre aux Juifs la terre de Palestine afin qu’ils aient un endroit dans le monde pour se protéger. La Palestine n’était-elle pas « une terre sans peuple pour un peuple sans terre » ? Quand j’interrogeais mon professeur d’histoire au sujet des Arabes vivant aujourd’hui en Israël, il répondait vaguement qu’il existait bien des Arabes vivant en Palestine mandataire mais qu’ils avaient perdu la guerre de 1948, gagnée par les Juifs qui avaient dès lors établi l’État d’Israël. Il n’était jamais fait mention de Palestiniens mais d’Arabes.
C’est à cette époque que ma quête d’identité est devenue une obsession. Je commençais à poser de nombreuses questions à mes parents au sujet de mon oncle, pourquoi ne pouvais-je le voir ? Enfin, un jour, j’obtins la réponse tant attendue. Mon oncle avait dû fuir Israël au début des années 1960 car il était recherché par les services de sécurité d’Israël en raison de sa participation au mouvement Al-Ard. Il gagna le Liban puis l’Égypte pour poursuivre ses études de journalisme, puis il se rendit dans le Golfe pour trouver du travail et mourut en 1995 au Qatar. Il ne fut autorisé qu’une seule fois, en 1980, à pénétrer sur le territoire « israélien » pour assister aux funérailles de sa mère. J’avais à peine cinq ans. C’est à cette époque que j’ai commencé à interroger mes vieilles tantes au sujet de la guerre de 1948 et sur ce qu’était mon pays avant cette guerre, puis je me suis mise à lire des ouvrages d’histoire sur le passé de la région et la création de l’État d’Israël. Je me rappelle avoir beaucoup lu sur le mouvement sioniste et apprécié leur organisation et leurs structures dédiées à un seul objectif : la création en Palestine d’un État pour le peuple juif.
J’ai toujours su que je vivais en Israël, un État juif avec pour langue l’hébreu, mais je n’ai jamais compris pourquoi les Arabes étaient plus pauvres que les Juifs et pourquoi Nazareth Ilit (une ville juive voisine de Nazareth) était plus propre et développée que Nazareth. « Cela doit être une question de mentalité, me disais-je, les Juifs ont une mentalité occidentale alors que nous avons une mentalité orientale. »
Bien que la langue officielle d’Israël soit l’hébreu, j’ai principalement parlé arabe jusqu’à ce que je quitte à dix-huit ans Nazareth pour Jérusalem où j’ai poursuivi mes études à l’Université hébraïque. Auparavant, l’hébreu n’était à mes yeux qu’une langue étrangère que l’on étudie à l’école au même titre que l’anglais ou le français. L’hébreu était toutefois moins « déconnecté » de ma réalité quotidienne que les deux autres langues, car présent à la maison par le biais des journaux écrits et télévisés, ou quand mon père parlait avec ses collègues juifs qui nous rendaient souvent visite. Toutefois, cette langue ne nous était pas propre et nous ne l’utilisions que pour communiquer avec les Juifs. L’arabe était l’unique langue utilisée au sein de ma famille, à l’école et dans le voisinage. Je me souviens d’ailleurs que lorsque je me rendais avec ma famille à Haïfa ou à Tel-Aviv, mes parents exigeaient de nous de parler doucement et calmement alors que les enfants juifs criaient et parlaient très fort. Je ne comprenais pas pourquoi.
Mes parents sont nés au début des années 1940 (mon père en 1942 et ma Mère en 1944). Ils étaient donc très jeunes lors de la création de l’État d’Israël. Il sont vécu sous le régime militaire israélien jusqu’en 1966. Ils ont donc passé le plus clair de leur enfance dans une atmosphère pesante où personne ne pouvait s’exprimer ou se déplacer librement. En outre, face au « spectacle » de mon oncle chassé d’Israël par les services de sécurité israéliens et obligé de fuir et de disparaître de leurs vies, mes parents se sont tenus à l’écart de la politique. Cela explique que l’unique conseil qu’ils m’aient donné lorsque je suis partie à l’université fut : « Reste en dehors de la politique. » Le seul conseil que je n’ai pas Pu suivre.
J’ai débuté mes études à l’Université hébraïque de Jérusalem en 1994, un an avant les accords d’Oslo. La vie que j’ai menée à Jérusalem m’a rapprochée des Palestiniens et m’a éloignée des Israéliens. L’atmosphère à l’époque était relativement calme à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ce qui m’a donné l’occasion de les visiter et permis de rencontrer les Palestiniens des Territoires. Ces rencontres et les liens que j’ai développés avec des habitants de Cisjordanie et de Gaza ont joué un rôle certain dans l’évolution de mon identité, et ce principalement de deux manières. L’interaction quotidienne avec plusieurs personnes a renforcé mon sentiment d’appartenir à leur groupe et d’en être un membre à part entière, par le biais de la culture et de la langue. Être assise dans un café, lire le menu en arabe et non en hébreu, parler arabe avec tous les gens et partager le même attachement à la tradition locale était, pour moi, quelque chose de vraiment dynamisant. Je me suis souvent trouvée dans des situations où il fallait que je m’explique sur mon statut de citoyenne d’Israël, particulièrement lorsque j’étais introduite auprès de gens qui nous appellent les « Arabes juifs » ou qui nous accusent de trahison du simple fait que nous possédons la citoyenneté israélienne.
La rencontre avec les « Palestiniens des Territoires » a directement et indirectement participé au processus constitutif de ma propre identité : face à l’injustice et aux humiliations quotidiennes qu’ils subissaient, j’ai ressenti le sentiment pressant qu’il fallait que je m’engage politiquement dans le mouvement des étudiants arabes et que je participe aux manifestations contre l’occupation, d’autant plus que l’échec de la mise en œuvre des accords d’Oslo était patent et que la situation ne cessait de se détériorer dans les Territoires palestiniens (ce qui allait conduire bientôt au déclenchement de la seconde Intifada). Enfin, mes relations avec les Juifs vivant à Jérusalem, et particulièrement avec ceux qui étudiaient avec moi, constituent un facteur supplémentaire de mon identification aux Palestiniens. J’étais perçue par les Juifs israéliens de manière négative pour le simple fait Que j’étais arabe. C’était tout du moins ce que je ressentais.
Comme il semblerait que « je ne ressemble pas à une Arabe », phrase que j’ai entendue si souvent de la part d’Israéliens, je me déplaçais facilement dans les transports en commun sans que les soldats me contrôlent ou que les gens me regardent avec suspicion. Jusqu’au jour où mon téléphone portable se mit à sonner et que je répondis en arabe. J’ai alors perçu toute la suspicion des gens autour de moi et même entendu des paroles haineuses et racistes à l’encontre des Arabes.
Le tournant du 28 septembre 2000
La présence d’Ariel Sharon sur l’esplanade d’Al-Aqsa le 28 septembre 2000 fut vécue comme une provocation par le peuple palestinien et le monde arabe en général, et cela en raison de son passé, de sa responsabilité dans les massacres de Sabra et Chatila, et des représentations qu’il suscite dans l’esprit des Palestiniens et des Arabes d’Israël. Ce fut le déclencheur de la seconde Intifada. Le fait que Sharon ait choisi cette place hautement symbolique, tant sur le plan religieux que sur le plan national, joua un grand rôle dans le déclenchement de la seconde Intifada, également appelée Intifada Al-Aqsa. Pour la première fois dans leur histoire, les Arabes d’Israël, qui ont ressenti l’acte de Sharon comme une offense envers l’islam mais plus généralement envers l’ensemble des Arabes, se sont révoltés et ont exprimé leur solidarité envers les Palestiniens. La mort de 13 Arabes d’Israël, tués par la police israélienne en octobre 2000 lors des manifestations De solidarité avec les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, a aussi contribué À radicaliser la population arabe d’Israël qui avait désormais ses martyrs. Cependant, il me semble que la participation des Arabes israéliens aux révoltes dites d’« octobre 2000 » trouve ses raisons dans les injustices et les humiliations auxquelles ils font face depuis la création de l’État d’Israël. Ils n’ont jamais bénéficié de politiques adéquates pour s’affirmer comme des membres à part entière de l’État israélien et s’identifier en tant qu’Israéliens et non pas Palestiniens.
Au cours de la guerre du Liban en juillet 2006, les Arabes d’Israël ont manifesté leur solidarité avec le peuple et la résistance libanais et leur hostilité à la politique israélienne. Une fois encore les Israéliens juifs y ont vu la preuve irréfutable de la déloyauté des Arabes israéliens, tandis qu’inversement ceux-ci considèrent l’attitude des Juifs israéliens envers eux comme la manifestation la plus éclatante de l’incapacité d’Israël à accepter leur présence.
Les Arabes israéliens
Israël compte aujourd’hui près de 20% de citoyens arabes, soit 1200000 personnes descendant des Arabes restés dans les frontières d’Israël après 1948. Entre 1947 et 1949, la guerre qui oppose Juifs et Arabes pour le contrôle du territoire a quasiment vidé de sa population arabe le territoire de l’État israélien tel qu’il est proclamé le 14 mai 1948 : des 800000 Arabes qui le peuplaient durant les dernières années du mandat britannique, seuls 20% demeurent en 1949, soit environ 160000 personnes qui constituent 12% de la population arabe qui résidait en Palestine avant la guerre, c’est-à-dire environ 1300000 personnes selon le chiffre avancé par Benny Morris (1987).
La majorité des Arabes israéliens sont en Galilée (60%). Dans cette région, où les Arabes sont encore majoritaires, on compte de nombreux Arabes chrétiens, descendant des propriétaires terriens des grands domaines qui s’étendaient sur les collines qui dominaient la plaine. Ils n’ont pas voulu abandonner leurs terres en 1948, à la fois par attachement et sans doute parce qu’ils pensaient que cette Occupation israélienne ne durerait pas grâce à l’aide que leur apporteraient les États arabes voisins. Environ 20% vivent dans le Triangle, région entre la ligne verte et la côte entre Haïfa et Tel-Aviv. Après 1948, ce triangle a été nommé le « Petit Triangle » pour le différencier du « Grand Triangle » qui inclut Naplouse, Jénine et Tul-Karem, région appelée ainsi pendant la révolte arabe des années 1936-1939 du fait de la concentration des « résistants » et parce que l’ensemble des villages arabes y forment un triangle en vue aérienne. 10% vivent dans le sud À Al-Naqab dans le Néguev et les 10% restants vivent dans les villes mixtes de la plaine côtière.
Nazareth est la ville d’Israël qui compte le plus d’Arabes (61700 habitants dont 67% de musulmans et 33% de chrétiens), la deuxième est Um al-Fahem dans le district d’Haïfa (38000, tous musulmans) et la troisième est Rahat dans le district sud (34100 Bédouins arabes musulmans).
Il faut rappeler que la majorité des Arabes qui habitent Jérusalem ne sont Pas des citoyens israéliens. La citoyenneté leur a été proposée en 1967 lors de L’annexion de la partie est de la ville par Israël, mais ils l’ont refusée afin de marquer leur opposition à l’annexion.
Des citoyens de seconde zone
Discrimination juridique
La politique israélienne à l’égard des Arabes israéliens a toujours été marquée par une « hésitation » entre méfiance et aspiration à une société véritablement démocratique. En théorie, l’État d’Israël considère les Arabes israéliens comme des citoyens « non juifs » égaux en droit. Une égalité devant la loi qui est ancrée dans la déclaration d’indépendance. Or, les Palestiniens d’Israël (ils ne se définissent plus comme Arabes israéliens) ont appris à leurs dépens, tout de suite après la création de l’État, ce que signifiaient ces déclarations d’intention puisqu’on les plaça sans ambages sous administration militaire pendant dix-huit ans (1948 – 1966), limitant leurs droits civiques, à part celui de voter, au minimum. Si les conditions de sécurité difficiles qu’a dû affronter l’État israélien ont influé sur le sort pour le moins inconfortable fait aux citoyens arabes d’Israël, elles ne sauraient toutefois le justifier. Une autre décision, prise en 1949 (et restée en vigueur jusqu’à récemment), l’illustre de manière significative. Dans l’état civil israélien, les Juifs inscrivent la mention « juif » à la rubrique « communauté », tandis que les Arabes musulmans ou chrétiens y portent la mention « arabe », mais pas les druzes, qui portent la mention « druze ». Or, en Israël, l’« ennemi », c’est l’Arabe. Qu’il Réside sur le territoire de l’État ou de l’autre côté de la frontière n’y change rien. Par ailleurs, les Juifs sont les seuls à bénéficier de certains droits, en particulier ceux ouverts au titre de la loi du retour, qui permet aux conjoints éventuellement non juifs des Israéliens juifs de s’installer en Israël et d’en devenir citoyens à part entière. Ceci n’est évidemment pas le cas pour le conjoint arabe d’un citoyen Arabe d’Israël. La loi de retour concerne seulement les Juifs et précise que tous Les Juifs dans le monde peuvent « retourner » en Israël et prendre la nationalité israélienne.
On distinguera quatre catégories de discrimination par la loi à l’encontre des Arabes israéliens des lois en leur défaveur parce que servant directement les intérêts de la majorité juive : loi du retour ou droit à l’immigration, loi de la nationalité ou droit à la naturalisation, droit à l’implantation, loi sur l’expropriation des terres. Autant de lois qui confèrent aux organisations nationales juives un statut particulier. Les critères législatifs qui avantagent automatiquement et explicitement la majorité juive en matière de répartition des ressources sont décisifs pour ce qui est de l’emploi, de la retraite, des prestations sociales, de l’aide au logement, de l’impôt, de la formation. Par contre, il faut noter l’absence de critères législatifs dans la répartition des ressources, en particulier dans le secteur public : budget des municipalités, territoires de développement, formation et services sociaux, espaces constructibles et agrandissement des communes. Dans tous ces secteurs, le législateur a laissé une importante marge de manœuvre aux fonctionnaires et à l’exécutif. Il n’est pas rare qu’un village entier soit dépendant des bonnes grâces d’un seul et unique fonctionnaire. Et il n’est pas non plus rare que des groupes ou des localités fassent l’objet d’un chantage s’ils veulent ne serait-ce que bénéficier de leurs ressources. Un moyen auquel les partis de gouvernement et leur dépendance ne rechignent pas avant les élections ; des lois qui avantagent directement les organisations nationales et non gouvernementales juives puisqu’elles excluent Les Palestiniens, comme le Fonds national juif et l’Administration des terres d’Israël.
Durant les premières décennies qui suivirent la fondation de l’État, la plupart des Palestiniens n’avaient pas une conscience claire de ces discriminations. Ils étaient faibles et isolés, encore sous le choc, et ne pouvaient percevoir rapidement les différences de statut à travers les méandres de la vie quotidienne. L’administration militaire, qui plus est, allait promouvoir un clientélisme reposant sur la collaboration et une activité réduite des partis d’opposition. Les élites palestiniennes ont encore aujourd’hui à combattre les séquelles de cette période de collaboration.
La prise de conscience vint par la suite et cela reste aujourd’hui encore une affaire de travail politique. Il y a maintenant une majorité des Arabes israéliens qui se revendiquent Palestiniens et qui réclament le statut de minorité nationale.
Désintégration économique : de la société agraire à la réserve de travailleurs
Jusqu’en 1949, 85% des Palestiniens vivaient de la terre, une petite partie d’entre eux travaillant dans la construction, le commerce ou la pêche. Ils étaient jusque-là dépendants des rapports sociaux et de production villageois. Le réaménagement des structures de propriété entraîné par le processus d’implantation israélien fit s’écrouler le système économique et social des Palestiniens. La subordination de l’espace palestinien à l’autorité juive et sa transformation en territoire judéo-israélien constituaient pour la minorité arabe un point de départ défavorable. D’abord en raison de la concurrence des Juifs techniquement plus avancés, déjà, en agriculture et dans l’industrie ; ensuite à cause du manque de sol et de ressources, du fait de la politique d’expropriation, sous couvert de mesures d’urgence, par les Israéliens [Saker, 1981, p.207-208].
La minorité palestinienne a plus souffert que tous les autres groupes de la population du centralisme strict en vigueur dans le pays, en particulier du point De vue économique. Le gouvernement place presque tous les secteurs, y compris l’import-export, sous son contrôle immédiat. Une politique sur laquelle pesait largement des facteurs très imbriqués comme la sécurité, l’accueil des immigrants, les implantations et les prestations sociales.
Le centralisme économique des Israéliens lia tous les groupes sociaux et tous les individus au pouvoir central et les rendit ainsi très dépendants de celui-ci. Le programme économique était élaboré en fonction d’une hiérarchie précise des couches de la population dont on influençait énormément, de la sorte, le niveau Et le style de vie [Eisenstadt, 1985, p. 332-333]. Or, semblable influence continue De peser sur les Palestiniens, qui ne sont pas en mesure d’exercer des pressions d’ordre politique et économique. Le gouvernement répartit les ressources en fonction de l’influence de lobbies économiques ou politico-idéologiques. Les plus puissants d’entre ces lobbies ignorent les Palestiniens. On peut les citer : la Histadrut (confédération syndicale), les fédérations patronales, les associations commerciales, les organisations kibboutziques, celles des Moshav (collectifs d’« implantations » indépendantes), fédérations agricoles, partis politiques et organisations confessionnelles [Yashai, 1987].
En Israël, il faut faire partie des collectivités judéo-sionistes pour prendre part équitablement à l’utilisation des ressources. Or, les Palestiniens ne peuvent, indépendamment de leur loyauté envers l’État, faire partie de ces collectifs.
Principaux aspects de la discrimination : expropriation de la terre et du patrimoine.
Les nouveaux immigrants devaient disposer de l’espace où s’implanter et édifier leur indépendance économique. Les autorités israéliennes se réclamèrent donc du code foncier ottoman de 1858 et exproprièrent la terre qui restait aux Palestiniens. Ce fut la confiscation d’environ 93% de tout l’espace [Granott, 1956, p. 110]. Après le Jour de la Terre de 1976, les autorités israéliennes changèrent de méthode et ne confisquèrent plus qu’indirectement la terre. On enleva la compétence sur la terre aux communes palestiniennes et on la transféra aux implantations juives voisines. C’était la « restructuration » des communes au profit des régions au début des années 1990. Ce transfert délibéré autorisa les nouvelles instances compétentes à confisquer jusqu’à 40% de la terre pour des projets public et à refuser d’accorder aux municipalités des budgets suffisants en matière d’infrastructures. Les « régions de développement » laissent de côté presque tout le secteur palestinien, alors que celles-ci bénéficient de privilèges nombreux en termes d’infrastructures, d’aménagement et de créations d’emploi. Le Bureau central des statistiques (BCS) []évalue régulièrement le niveau socio-économique des conseils locaux en Israël. À l’issue de l’enquête, un classement est effectué selon plusieurs facteurs incluant les caractéristiques socio-démographiques, les niveaux d’éducation, les revenus et les subventions gouvernementales. Le BCS dénombre 210 conseils locaux classés selon dix niveaux socio-économiques (1 pour le groupe le plus pauvre, 10 pour le plus riche). Selon ces critères, les 82 conseils locaux arabes se retrouvent tout en bas de l’échelle avec 80% des conseils réunis au sein du groupe le plus bas, 93% de l’ensemble des conseils locaux sont arabes dans le deuxième groupe et 88% dans le troisième. Presque 45% de la communauté arabe se trouve représentée dans les deux groupes les plus bas et 97% des Arabes sont confinés dans les quatre groupes les plus bas. Les citoyens arabes du Néguev se concentrent dans le premier groupe, ce qui signifie qu’ils constituent la classe sociale la plus défavorisée ; au bout de cinquante-sept ans, il y a de nombreuses communes palestiniennes toujours sans administration. En 2005, c’étaient quelque 96000 Palestiniens qui vivaient dans près de 40 communes « non reconnues [] ». Ces dernières n’ont pas de budget et sont à peu près dépourvues de services sociaux, sanitaires et pédagogiques ; les investisseurs palestiniens sont désavantagés par rapport à leurs collègues juifs. Comme les communes palestiniennes ne font pas partie des secteurs en développement, elles bénéficient de moins d’allégement d’impôt et de crédits favorables. Une situation qui a peu évolué depuis la loi modifiée de 1990 aux termes de laquelle seules les petites entreprises doivent, indépendamment de leur localisation et de leur environnement, bénéficier de crédits à intérêts favorables, d’un soutien financier de l’État et de réductions d’impôt [Haidar, 1993]. Selon les chiffres officiels, les petites entreprises auraient reçu de 1990 à 1994 environ 600 millions de shekels (1shekel =0,18euro) ; celles qui sont palestiniennes, 2,5% de ce montant (Israel Statistical Yearbook 1994, tableau n°2014). C’était l’époque où les partis et députés arabes étaient en mesure de jouer un rôle actif dans la politique du pays, car le gouvernement Rabin dépendait de leurs voix et de leur soutien. Voilà pourquoi il allait se montrer généreux dans l’allocation de ressources au secteur arabe. Par contre, les ministères de l’Éducation et du Travail n’ont pas attaché le moindre intérêt à la formation dans le secteur arabe [Services d’inspection de l’État, 1993]. Celle-ci est demeurée pour l’essentiel théorique et académique. La plupart des diplômés ne peuvent En rien contribuer au développement économique, en particulier dans l’industrie. Les rares Palestiniens qui ont fait des études scientifiques sont le plus souvent employés dans l’enseignement, ce qui correspond à un gaspillage des compétences et relève d’une mesure délibérée afin de maintenir l’économie arabe en l’état [] ; la destruction de leur agriculture et une industrie primitive ont contribué à ce que les travailleurs palestiniens soient forcés d’aller se faire employer comme journaliers dans des localités juives éloignées. En 1961 déjà, quelque 54% des employés palestiniens devaient se déplacer quotidiennement sur de longues distances [Ben-Porat, 1996], environ 82% en 1986 [Statistical Abstract of Israel, 1987]. Nombre de secteurs leur restent fermés pour raisons de sécurité, un prétexte communément avancé. En somme, le régime ne souhaite pas l’intégration Ou l’absorption de la population arabe dans la communauté juive et n’a pas fait d’efforts en ce sens.
Israël, l’État des Juifs ?
L’impossible nettoyage ethnique
Tandis que certains soulignent que la seule solution à long terme consisterait À mieux intégrer les citoyens arabes en mettant fin aux « discriminations dont ils souffrent », le terme « nettoyage ethnique », utilisé par certains Juifs, permettant de transférer tout ou partie de cette population hors des frontières d’Israël, fait aussi rapidement son chemin. Selon un sondage réalisé par l’institut Jaffee pour les études stratégiques, publié dans le quotidien Haaretz du 12 mars 2002, 31% des Juifs israéliens se déclaraient favorables à un transfert autoritaire des citoyens arabes, tandis que 60% approuvaient un transfert moins explicite, sous la forme de mesures d’encouragement à quitter le pays. Les autorités, quant à elles, réfléchissent activement aux moyens de réduire le nombre des citoyens arabes sans provoquer une nouvelle Nakba, une « catastrophe » semblable à celle qui a touché le peuple palestinien en 1948.
Pendant que les experts en « affaires arabes » et la classe politique juive s’affairent à échafauder pareils projets, les citoyens arabes affirment en masse leur refus de quitter la terre de leurs ancêtres. En mars 2001, près de 95% d’entre eux se déclaraient hostiles au transfert de population, tandis que 70% refusaient d’envisager le transfert de souveraineté sur les villages du Petit Triangle (sondage réalisé par l’Institut Guivat-Haviva entre janvier et mars 2001).
Une autre enquête commandée par l’Université de Haïfa, quelques mois après les révoltes d’octobre 2000, indique que seulement 27% des Israéliens juifs voient d’un bon œil les interventions policières à l’encontre des manifestants juifs, tandis qu’ils sont 61% à vouloir ce genre d’intervention à l’encontre des protestataires arabes israéliens []. Dans un sondage mené quelques jours après les émeutes du 8 octobre 2000, 60% des Juifs interrogés ont déclaré vouloir que les Arabes israéliens soient « transférés » à l’extérieur des frontières israéliennes et près de 78% ont approuvé les interventions musclées de la police israélienne à l’égard des Arabes israéliens lors des troubles [Sultany, 2003 ; Zureik, 2001]. Concrètement, cela est révélateur des profonds conflits identitaires en Israël. La majorité juive n’entend pas vivre avec la minorité arabe, sentiment qui se renforce à mesure que la situation géopolitique se détériore. Cela pose le difficile problème de la coexistence entre les groupes socio-religieux en Israël. Pendant les négociations pour le processus de paix avec les Palestiniens, le gouvernement israélien A envisagé de « donner » la population de la région du Triangle, où se trouvent concentrés les Arabes musulmans sunnites affiliés au mouvement islamique « radical » du Cheikh Raed Salah, à l’autorité palestinienne en échange des colons juifs de Cisjordanie. Les habitants de cette région, avec le soutien de l’élite politique et intellectuelle arabe, refusent fortement ce plan et insistent sur leur lien avec la terre.
Un sondage de 2005 mené pour le compte du Centre de combat contre le racisme en Israël a démontré que 68% des Juifs israéliens n’accepteraient pas de vivre dans un immeuble avec des Arabes, et 63% des Juifs israéliens approuvent l’affirmation suivante : « Les Arabes représentent une menace pour la sécurité et la démographie de l’État d’Israël »[Awawdi, 2005].
Cette radicalisation parmi les deux communautés (les Arabes se définissent de plus en plus comme des Palestiniens et les Juifs refusent l’existence des Arabes dans les frontières d’Israël) exprime les difficultés à trouver des solutions, non seulement à l’échelle du conflit israélo-arabe mais aussi au niveau interne, entre les Arabes et les Juifs d’Israël.
Dès lors, pour les Israéliens, c’est bien la question du caractère juif de l’État qui est en question. Comment Israël peut-il demeurer l’État des Juifs si 20% de sa population est arabe ? La question se pose avec une acuité sans précédent depuis que les citoyens arabes ont acquis un poids politique inédit. Le gouvernement d’Itzhak Rabin, qui venait de signer les accords d’Oslo en 1993, ne s’est maintenu au pouvoir que grâce à l’appui des députés arabes. Or, les partis auxquels ils appartenaient, proclamaient l’appartenance consciente et active des citoyens arabes d’Israël au peuple palestinien jusque dans l’enceinte du Parlement, la Knesset. Ceci avait pour effet de susciter chez des Israéliens juifs une grande inquiétude. La question pour ces Israéliens se posait alors ainsi : le sort d’Israël doit-il dépendre d’« extrémistes » arabes qui ne participent aux institutions démocratiques de l’État juif que pour mieux en saper les fondements ? Un temps l’apanage de la droite israélienne, ce soupçon transcende aujourd’hui les appartenances partisanes pour toucher une très large partie de la population juive. Une chose est sûre : Israël se trouve là confronté à l’un des défis majeurs des années à venir. Car les Arabes d’Israël continueront de peupler son territoire, quand bien même une solution au conflit israélo-palestinien serait trouvée. Leur avenir, en effet, n’a jamais été inclus dans les négociations, et l’Autorité palestinienne ne revendique sur eux aucune souveraineté.
Bibliographie
AWAWDI B. et HAYDAR Ala’ (dir.), Racisme contre les Arabes palestiniens citoyens d’Israël, Centre de combat contre le racisme en Israël, 2005.
BEN-PORAT Y., Arab Labour Force in Israel,Jérusalem, 1996.
EISENSTADT S. N., The Transformation of Israeli Society. An Essay in Interpretation, Boulder, Westview Press, Colorado, 1985.
EL-ASMAR F., To Be An Arab in Israel, The Institute for Palestine Studies, Beyrouth, 1978.
GRANOTT A., Agrarian Reform and the Record of Israel, Londres, 1956. -, Israel Statistical Yearbook, 1994.
HAIDAR A., Les Obstacles au développement dans le secteur arabe (hébreu), Institut pour le développement économique, Tel-Aviv, 1993.
MORRIS B., The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
SAKER A., Le Mouvement ouvrier en Palestine. Du mandat britannique à 1980, Damas, 1981.
Services d’inspection de l’État, Rapport pour l’année 1992, n° 42, Jérusalem, 1993 (hébreu).
SULTANY N., Citizens without Citizenship : Mada’s First Annual Political Monitoring Report : Israel and the Palestinian Minority 2000-2002, Mada-Arab Center for Applied Social Research, Haifa, 2003.
YASHAI Y., Les Lobbyistes d’Israël (hébreu), Tel-Aviv, 1987.
ZUREIK E. T. « Review essay : being Palestinian in Israel », Journal of Palestine Studies, 30 (3), 2001, p.88-96.
[1] Bureau central des statistiques : http://www.cbs.gov.il.
[2] Association of Forty, disponible sur www.assoc40.org.
[3] Cf.° N. LEWIN-EPSTEIN, The Arab Economy in Israel : Growing Population-Jobs, Mismatch, Pinas Sapir Center for Development, Tel-Aviv, 1990. De même J. HOFMAN, « L’identité ethnique des Arabes en Israël et en Cisjordanie »(hébreu), Megamot, n°20, 1974, p. 319-320 et Aziz HAIDAR, « Les Arabes en Israël et leur formation universitaire »(arabe), Journal of Palestinian Studies,n°15, été 1993, p.38-58.
[4] Halaby MOE’EN, « Mua’da al Bahth : al-Mujtama’ al-Yehudi al-Israeli Yadrug al-Wada’ al-Dimuqrati ka-‘Amil Thanawi fi Hayatihi »(Recherche qui dit que la société juive israélienne considère la démocratie comme un facteur secondaire dans sa vie) (en arabe), Kul al-Arab, 6 avril 2001, p.10.