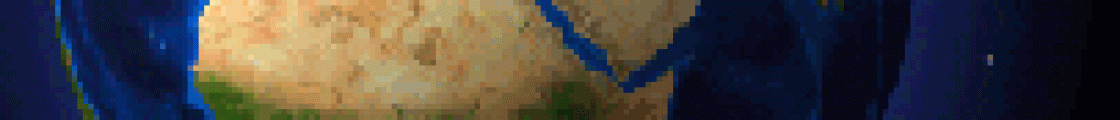Par Roland Laffitte
Le livre distingue deux périodes. La première retient les proclamations allant de celle de Bonaparte dans l’Égypte de 1798 à celle de Catroux dans la Syrie et le Liban de 1941 ; la seconde période court depuis celle de George W. Bush en Afghanistan et en Irak, à celle de François Hollande à Bamako en 2013, en passant par celle de Nicolas Sarkozy à Tripoli en 2011. Et il cherche à mesurer le fossé existant entre ces proclamations et la réalité des intentions et des actes. Voici des extraits de la rubrique « Derrière l’écran des manifestes » qui suit le discours de François Hollande à Bamako le 2 février 2013 :
[Ce discours] suggère quelques remarques. Tout y est des antiennes lénifiantes de la libération des peuples. Le libérateur autoproclamé n’a d’autre intérêt particulier que celui qui s’identifie avec ceux de l’humanité entière, aujourd’hui la lutte contre le « terrorisme ». Confondant, dans ce terme flou à la gamme d’acceptions terriblement élastique, les opposants armés au pouvoir en place ‒ indépendamment du jugement que l’on peut porter sur leur action ‒, il dissimule ses intentions derrière l’étendard de droits de l’homme et d’une démocratie érigés en religion universelle. Le libérateur n’a, devrait-on penser, aucune arrière-pensée de contrôle dans le pays où il répand ses troupes : aucune visée sur les promesses d’un sous-sol que l’on dit – mais sans que cela soit toutefois encore vraiment prouvé ‒ riche en uranium, hydrocarbures et terres rares. Il n’affiche aucun objectif de maîtriser un territoire pour des raisons géostratégiques, comme si celles-ci ne constituaient pas un invariant dans la politique sahélienne et africaine de la France, même si cette dernière soit en négocier aujourd’hui les termes avec d’autres empires. Il n’a d’autre motivation, à ses dires, que philanthropique, que son dévouement historique au peuple malien, sa volonté altruiste d’aider au rétablissement des libertés du pays contre des oppresseurs étrangers. Il vient en toute fraternité participer au développement et à sa marche vers la démocratie, un instant suspendue de son cours naturel par des éléments allogènes dont l’activité n’airaient aucune racine dans la vie du pays et qui seraient en quelque sorte tombés de façon inopinée d’une planète lointaine et mystérieuse.
Tout cela serait bien plus crédible si le poids de la France ne restait pas déterminant dans l’économie et la société malienne, où de multiples accords inégaux, sur les plans aussi bien culturel qu’administratif, financier autant que militaire, verrouillent les relations entre un petit pays pauvre et la France aisée, même si sa puissance à l’échelle internationale n’est qu’un pâle reflet de celle d’hier. La France est loin d’être étrangère à la situation catastrophique du Mali actuel […]. Affaibli par une succession de crises climatiques de plus en plus graves qui entrainent le déracinement de populations nombreuses, pas seulement notamment celles du Nord, le pays est en effet mis à mal, tout comme ses voisins, par la tutelle financière du FMI et du club de Paris devant lesquels l’État français s’est habilement défaussé, pour dicter leur loi : sous peine de se voir couper les bourses, le Mali est condamné à une ouverture libérale par aux conséquences désastreuses : fragilisation de la production locale ‒ y compris celle du coton ‒ par la concurrence de pays riches comme les États-Unis, limitation, comme au Niger, des prises de participation publiques dans les sociétés étrangères et privilèges fiscaux qui leur livre le pays sans contrôle, liquidation du patrimoine public au profit d’une bourgeoisie serve d’intérêts étrangers, et mise en coupe réglée des classes populaires. La soumission du pays aux appétits des financiers globaux alimente une corruption à grande échelle de couches entières de l’État ‒ et notamment l’armée ‒ impliquées dans le négoce international et la dilapidation des biens publics. À cela s’ajoute que la situation géographique fait qu’il constitue actuellement est, pour son malheur, voie de passage de trafics de tous ordres entre l’Amérique latine et l’Europe ‒ en premier lieu celui de la drogue ‒ reliant notamment du Nigéria à l’Algérie. L’État est si faible que, loin de pouvoir résister aux pressions des trafiquants, il s’en est fait, par des pans entiers, largement le complice. Devant les exactions odieuses des salafistes et des narco-(d)jihadites, il était aisé d’invoquer le danger pour justifier une intervention française et beaucoup de Maliens s’y sont laissé prendre. Mais ces courants eux-mêmes prospèrent sur le terreau d’une décomposition sociale dont la France est pour large part responsable.
La réalité est qu’au Mali la France est l’acteur principal de l’équipe des pompiers pyromanes internationaux. Le jour où il y a le feu dans l’immeuble, il est difficile de reprocher à ses habitants de faire appel à celui qui se propose de l’éteindre et qui seul a le moyen de le faire, et de le faire sans s’inquiéter de sa nature profonde. […] En cinquante ans, les gouvernements successifs ont eu, à maintes reprises, l’occasion de tourner la page d’un passé peu glorieux, de rompre avec la politique dite du « pré carré » ou de la « Françafrique ». Mais chaque velléité d’un secrétaire d’État français d’infléchir quelque peu le cours de choses en prenant au mot les proclamations présidentielles, s’est soldée par son élimination du gouvernement : pensez à Jean-Pierre Cot ou à Alain Joyandet. Quant aux tentatives africaines de modifier le rapport existant, elles se sont heurtées à une hostilité évidente dans l’attente de l’occasion favorable pour remplacer les gouvernements réfractaires ou rebelles par d’autres, soumis et dociles, et cela dans des conditions parfois dramatiques : songez à Thomas Sankara, assassiné en 1987.
En fin de compte, aucune tentative de rompre ou même de transformer substantiellement la nature des rapports d’étroite dépendance qui lient à l’impérialisme français les États appelés par un pudique euphémisme « anciennes colonies d’Afrique », n’a réussi. Tout reste donc à faire pour engager une véritable politique de coopération massivement compensatrice des dommages de la colonisation et vraiment désintéressée. […] François Hollande ne manque pas d’audace quand il invoque l’indépendance de 1960. Il est probable que, dans son esprit, cette indépendance fut « octroyée » par la France, et que pour lui comme pour son prédécesseur, « l’homme africain n’est pas encore assez entré dans l’histoire ». En tout cas, lui et ses ministres, Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian en tête, ne laissent pas beaucoup de place à l’« homme malien » lorsqu’avec une assurance hautaine de proconsuls, ils donnent publiquement des ordres sur la date des élections qui doivent parachever la fiction démocratique de la tutelle étrangère sur le Mali réclamée par les financeurs – Europe, Amérique du Nord, FMI, etc. ‒ dont la France recherche l’aide. […] Quand Hollande parle de la France venant au secours des Maliens pour une « nouvelle indépendance », il renouvelle l’imagerie coloniale-paternaliste de la République féconde et généreuse protégeant ses enfants africains…
Après avoir constaté que les formes de domination impérialiste dépendent d’un côté du différentiel social entre pays dominant assujettis et, de l’autre, de la liberté ‒ ou de l’absence de liberté ‒ que le jeu des puissances impérialistes laisse aux pays dominés, un long « Épilogue » s’efforce de caractériser les différentes formes de cette domination et aborde alors le paragraphe suivant :
Le « Nouvel impérialisme libéral »
Si la forme de « l’impérialisme colonial » a aujourd’hui en grande partie brûlé ses cartouches, le phénomène de domination et de dépendance se perpétue dans les zones où il a épuisé sa course, mais il y prend des allures nouvelles.
[Une des théorisations les plus révélatrices de l’impérialisme moderne est due à Robert Cooper, en son temps conseiller de Tony Blair, et nommé en 2010 conseiller du SEAE (Service Européen pour l’Action Extérieure)].
Au temps où « ordre signifiait empire », pose en postulat notre théoricien pétri d’humanités latines, « ceux qui étaient dans l’empire avaient ordre, culture et civilisation, et au-dehors n’étaient que barbares, chaos et désordre ». C’est « pourquoi nous avons besoin d’empires »[1]. […] L’éblouissant stratégiste répartit les États en trois classes. La première est constituée par les « États “modernes” traditionnels » ‒ une prouesse sémantique ! ‒ comme l’Inde, le Pakistan ou la Chine « dont la conduite comme États utilise, selon leurs intérêts, pouvoir et raison d’État ». […] Une telle définition a pour effet d’ériger discrètement en axiome que la seconde classe, celle des « États postmodernes », ceux qui furent hier des puissances coloniales, parviennent, comme chacun sait, à courber « pouvoir » et « raison d’État » aux exigences supérieures de la morale politique et des valeurs des « nations civilisées » […]. Quant à la troisième classe, elle réunit les « États prémodernes » : on ne sera pas étonné qu’il regroupe des anciennes colonies que la faillite a conduites à un « état hobbesien de guerre de tous contre tous »[2], ceux qui, dans la terminologie moderne, sont qualifiés d’« États-voyous », ou d’« États sans foi ni loi ». […]
Le malheur pour le monde, poursuit Robert Cooper, c’est que les États de cette troisième classe « peuvent être trop faibles même pour assurer leur propre sécurité ; abandonnés à eux-mêmes, ils font peser une menace internationale, mais cela peut fournir à des acteurs non-étatiques une base qui représentent un danger pour le monde postmoderne. Si ces acteurs non-étatiques, notamment des narcotrafiquants, des organisations criminelles ou terroristes prennent ces bases prémodernes pour des attaques à des parties mieux ordonnées du monde, alors les États organisés peuvent éventuellement avoir à répondre »[3]. Robert Cooper désigne nommément l’Afghanistan, mais très tôt l’Irak a été de facto joint à ce groupe par Bush, et plus récemment par les États-Unis et l’Europe, la Libye de Kadhafi et la Syrie de Bachar el-Assad si l’on ajoute à la description ci-dessus les États accusés de « massacrer leur propre peuple ». C’est le grand avantage des notions floues que ce pourvoir les élargir à loisir, selon les besoins des maîtres du moment.
[…] Dès lors une question se pose : « Quelle forme l’intervention doit-elle prendre? ». La réponse, qui utilise le vieux langage impérialiste, est la suivante : « La plus logique pour traiter le chaos, et une des plus employées dans le passé fut la colonisation » […] « Mais la colonisation, poursuit Robert Cooper, est inacceptable pour les États postmodernes (et ainsi que cela est le cas, pour quelques États modernes également) ». Suit un gros soupir : « C’est précisément parce que l’impérialisme est mort que nous voyons l’émergence du monde prémoderne. Empire et impérialisme sont devenus une forme d’injure [abuse] dans le monde postmoderne ». Suit une bouffée de nostalgie : « Aujourd’hui il n’y a pas de pouvoirs coloniaux prêts à accepter le travail, bien que les opportunités, peut-être même le besoin de colonisation soit toujours aussi grand qu’au XIXe siècle [souligné par RL] ». Notre éminent théoricien devrait être rassuré : des hommes comme George W. Bush et Tony Blair avant-hier en Afghanistan et en Irak, comme Nicolas Sarkozy et David Cameron en Libye, et comme François Hollande aujourd’hui en au Mali, ont bien senti « le besoin de colonisation » au sens où il entend ; ils ont parfaitement fait preuve de courage pour « faire le travail », et de la manière qu’il préconise !
En effet : « Ce dont nous avons besoin, c’est une nouvelle sorte d’impérialisme, qui soit acceptable par le monde des droits de l’homme et des valeurs cosmopolites. Nous pouvons déjà en discerner les contours : il s’agit d’un impérialisme qui, comme tout impérialisme, vise à apporter ordre et organisation mais repose désormais sur le principe du volontariat ».
Cela dit, […] « le monde postmoderne doit être prêt à faire usage du deux poids deux mesures. Entre nous, nous agissons sur la base des lois et de la sécurité coopérative. Mais, quand il s’agit des États vieux-style hors du continent européen postmoderne, nous devons en revenir aux méthodes plus brutales de l’ancienne époque, avec usage de la force, attaques préventives, duperie, bref tout ce qui est nécessaire pour affronter ceux qui vivent encore dans le monde du XIXe siècle, celui du chaque État pour soi. Entre nous, nous respectons la loi, mais quand nous opérons dans la jungle, nous devons aussi appliquer les lois de la jungle. La longue période de paix en Europe a créé la dangereuse tentation de négliger nos défenses, tant physiques que psychologiques »[4].
Voilà qui devrait déciller ceux qui se leurrent sur le présent en pensant que la page de l’impérialisme est définitivement tournée et qui repoussent même l’usage des termes d’impérialisme et de néocolonialisme comme obsolètes et servant de drapeau à des combats vieux-jeu, carrément dépassés. […]
[1] Cooper, Robert, « Why we still need empires », The Observer, 07/04/2002. Traduction RL.
[2] Cooper, Robert, même article.
[3] Les citations qui suivent sont tirées d’un autre article du même auteur, contemporain du premier et parallèle à lui, intitulé « The New Liberal Imperialism », The Guardian du 07/04/2002. Traduction RL.
[4] Ces phrases sans équivoque ont paru dans Cooper, Robert, « Why we still need Empire », The Observer du 07/04/2002. Traduction RL.