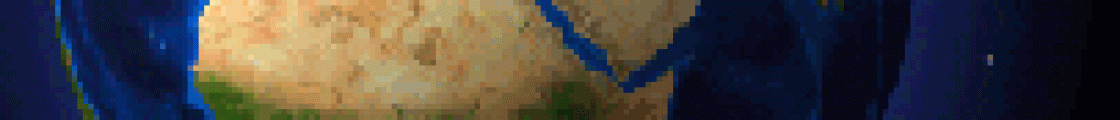Pour Stephen Zunes, professeur de sciences politiques à l’Université de San Francisco, la reconnaissance par le président Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël ne constitue pas un facteur de nature à favoriser la paix dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord comme prétendu mais une nouvelle cause susceptible engendrer de nouveaux conflits. C’est ce qu’il a démontré dans une analyse publiée par le Washington Post.
La semaine dernière, le président Trump a officiellement reconnu l’annexion du Sahara occidental par le Maroc, dans le cadre d’un accord visant à normaliser les relations entre le Maroc et Israël. Or, la revendication marocaine sur le Sahara occidental est rejetée par les Nations Unies, la Cour internationale de Justice, l’Union africaine et un large consensus de juristes internationaux qui considèrent la région comme un territoire non autonome nécessitant un processus d’autodétermination. C’est pourquoi aucun pays n’avait formellement reconnu l’annexion par le Maroc jusqu’à présent.
Lors de l’annexion de l’ancienne colonie espagnole par le Maroc en 1975, le Conseil de sécurité de l’ONU avait unanimement enjoint les forces marocaines de se retirer immédiatement du territoire et de permettre au peuple du Sahara occidental de décider de son propre avenir. Cependant, la France et les États-Unis ont empêché le Conseil de sécurité de faire appliquer ce mandat.
Le gouvernement marocain insiste sur le fait que le territoire fait partie intégrante du Maroc et que l’indépendance ne saurait être envisagée pour la population autochtone, les Sahraouis, qui possèdent une histoire, un dialecte et une culture distincts. Donald Trump s’est joint à la monarchie marocaine pour affirmer qu’une autonomie limitée sous souveraineté marocaine est la seule voie réaliste à suivre.
Human Rights Watch, Amnesty International et d’autres organisations de défense des droits humains reconnues ont documenté la répression généralisée des militants indépendantistes pacifiques par les forces d’occupation marocaines, notamment la torture, les passages à tabac, les détentions arbitraires et les exécutions extrajudiciaires. Freedom House classe le Sahara occidental occupé par le Maroc parmi les pires pays en matière de répression des droits politiques et des libertés civiles. Les journalistes étrangers et les délégations internationales en visite se voient régulièrement refuser l’entrée ou sont placés sous étroite surveillance.
De ce fait, le plan du Maroc est loin de répondre à la définition juridique de l’autonomie, et la répression en cours soulève de sérieuses questions quant à sa mise en œuvre concrète.
L’incorporation au Maroc par les Sahraouis, lors d’un référendum supervisé par la communauté internationale, ne poserait aucun problème. Cependant, en tant que territoire non autonome, ils doivent également avoir la possibilité d’accéder à l’indépendance, une option que le Maroc et désormais les États-Unis ont catégoriquement exclue.
Le Front Polisario, principal mouvement nationaliste issu de la lutte anticoloniale contre l’Espagne, a mené une lutte armée contre les forces d’occupation marocaines jusqu’à l’accord d’un cessez-le-feu en 1991, en échange d’un référendum sur l’indépendance. Cependant, le Maroc n’a jamais respecté cet engagement. Après 29 ans de promesses non tenues, d’occupation continue et de violations répétées du cessez-le-feu par le Maroc, le Polisario a récemment repris les hostilités. Depuis la proclamation par le Polisario de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en 1976, 84 pays ont reconnu le Sahara occidental comme un État indépendant (bien que certains aient depuis retiré leur reconnaissance). La RASD demeure membre à part entière de l’Union africaine, dont la charte interdit toute modification unilatérale des frontières coloniales. La RASD gouverne actuellement environ un quart du territoire saharien occidental et près de 40 % de la population, principalement dans des camps de réfugiés administrés par le Polisario dans l’ouest de l’Algérie. Ce qu’a donc fait Trump, c’est reconnaître la prise de contrôle d’un État africain légalement reconnu par un autre, ce qui non seulement nuit gravement à la réputation des États-Unis sur le continent, mais encourage même d’autres pays à croire qu’ils pourraient eux aussi s’en tirer en procédant à une expansion territoriale.
Lorsque Saddam Hussein a envahi le Koweït en 1990, s’appuyant sur des prétextes tout aussi douteux selon lesquels ce pays voisin du sud faisait historiquement partie de l’Irak, la communauté internationale s’est unie pour condamner cette violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Malgré les divergences d’opinions quant à l’opportunité d’utiliser la guerre pour contrer l’annexion irakienne, les États-Unis ont mené la communauté internationale dans sa détermination à ce qu’une telle agression soit inacceptable.
Aujourd’hui, sous la présidence de Trump, les États-Unis ont adopté une position diamétralement opposée.
Cette situation place le président élu Joe Biden face à un dilemme lors de sa prise de fonctions le mois prochain. S’il peut d’un simple trait de plume révoquer la reconnaissance américaine de l’annexion marocaine, le Maroc pourrait alors renoncer à sa reconnaissance d’Israël. Biden pourrait donc se trouver soumis à une forte pression pour ne pas compromettre ce que beaucoup considèrent comme une avancée majeure.
Mais même des membres du Congrès farouchement pro-israéliens ont exprimé leurs inquiétudes. Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Eliot L. Engel (démocrate de New York), tout en saluant la reconnaissance d’Israël par le Maroc, a souligné que la reconnaissance par les États-Unis de l’expansion territoriale marocaine « perturbe un processus onusien crédible et internationalement soutenu… que les administrations successives des deux partis ont appuyé ». De même, le sénateur Jim Inhofe (républicain de l’Oklahoma), président de la commission des forces armées du Sénat, a également salué la normalisation des relations, mais s’est dit « attristé que les droits des populations du Sahara occidental aient été bafoués », qualifiant cette décision de « choquante et profondément décevante ».
L’inadmissibilité de toute expansion territoriale par la force est un principe fondamental du droit international. Si la normalisation des relations entre Israël et les États à majorité arabe est un objectif louable, elle ne saurait se faire au détriment d’un principe juridique international aussi fondamental.
Stephen Zunes est professeur de sciences politiques à l’Université de San Francisco et co-auteur, avec Jacob Mundy, de « Western Sahara: War, Nationalism, and Conflict Irresolution ».
Source : The Washington Post, 15 décembre 2020