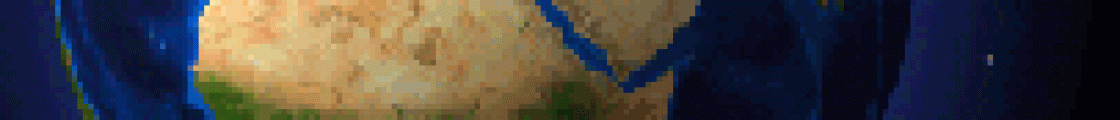Depuis le début des années 1990, les experts de la Banque mondiale, les professionnels des ONG du Nord, les chercheurs en Sciences sociales se sont penchés avec beaucoup d’attention sur la question de la contribution des ONG locales à la gouvernance dans leur pays. Si deux rhétoriques se sont alors développées sur le rôle des ONG locales dans la mise en œuvre d’une « bonne gouvernance » et d’un processus de démocratisation de la société des pays en développement, elles ont aussi fait l’objet de nombreuses critiques. Cependant, les trois approches issues de ce débat restent beaucoup trop a-historiques. En effet, dans ce débat contradictoire, les ONG sont considérées comme un bloc monolithique. En réalité, l’appellation générique, celle d’ONG locales, masque une grande diversité d’organisations, à l’histoire, aux légitimités et aux finalités des plus variées. De même, la représentativité des aspirations de la « société civile » par les ONG locales peut être aussi discutée.
En nous appuyant sur des exemples latino-américains et africains, nous montrerons la diversité que recouvre le terme générique d’ONG locales et les deux conditions qui nous semblent nécessaires pour que les ONG locales puissent jouer un rôle dans la gouvernance. Ce constat amène alors à s’interroger sur l’opportunité de faire des ONG locales un pilier de la « bonne gouvernance » comme le suggère la Banque mondiale.
Les rhétoriques sur le rôle des ONG locales pour une « bonne gouvernance »
Deux rhétoriques, celle de la Banque mondiale et des bailleurs de fonds en général, et celle des ONG du Nord cherchent à démontrer les rôles positifs des « sociétés civiles » dans la mise en œuvre d’une « bonne gouvernance ». L’interprétation du rôle des ONG locales diffère évidemment entre ces deux rhétoriques, mais elles ont en commun de restreindre les « sociétés civiles » aux seules ONG locales. Ces dernières sont considérées comme les acteurs clés pour une « bonne gouvernance ». Ainsi, deux modèles se disputent aujourd’hui l’hégémonie : celui de la Banque mondiale que partage le PNUD avec cependant des nuances importantes ; et celui, plus récent, résultant des efforts croisés de chercheurs, d’experts de la coopération et surtout d’ONG du Nord.
Cependant, des voix s’élèvent de plus en plus pour montrer les limites intrinsèques des ONG locales et de leurs actions dans la mise en œuvre d’une « bonne gouvernance », allant jusqu’à démontrer l’incapacité des ONG à participer à la démocratisation de leur société.
La rhétorique de la Banque mondiale
Inaugurée dans un rapport de la Banque mondiale sur l’Afrique en 1989, la notion de « bonne gouvernance » évoque un régime politique qui respecte les droits civiques et les droits de l’Homme, et qui peut compter sur une administration efficace, compétente, responsable et non corrompue. « Elle recèle à la fois un contenu technique (dans le sens d’une meilleure gestion publique) et des éléments éminemment politiques, au vu des liens étroits établis entre développement économique et instauration d’un État de droit calqué sur le modèle des démocraties occidentales. » (Blundo, 2000, p.17). Par opposition au ton plutôt provocateur et militant des donateurs bilatéraux qui cherchent à instaurer une conditionnalité politique pour favoriser la « démocratisation », notamment des systèmes relevant du multipartisme et la défense des libertés civiles qui sont vus comme des éléments indispensables au « bon gouvernement », la position de la Banque mondiale concernant la gouvernance est beaucoup plus modeste, mesurée et évite le piège de préconiser telle ou telle forme de gouvernement comme préalable à la « bonne gouvernance » (Campbell, 1997).
La définition du concept de gouvernance faite par la Banque mondiale dans son rapport « Governance and development » (Banque mondiale, 1992) est donc très large : la manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays. Elle fait une distinction entre trois aspects de la gouvernance : la forme d’un régime politique ; les processus par lesquels l’autorité est exercée dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays ; la capacité d’un gouvernement de concevoir, de formuler et de mettre en œuvre des politiques et la façon générale de mener les fonctions du gouvernement. Conformément à son rôle premier de banque, elle conçoit son mandat en ce qui concerne la gouvernance comme résidant essentiellement dans des domaines qui touchent directement la gestion économique et les politiques économiques. Ainsi, elle se situe dans une tradition très précise : celle d’une position minimaliste et même de méfiance concernant l’intervention de l’État (Castel, 2002, p.129).
Dans cette vision des choses, la Banque mondiale met en œuvre une « stratégie de l’offre » qui visent la construction de la démocratie « du sommet à la base », par la réforme des institutions de l’État afin de les rendre plus représentatives, plus responsables et plus transparentes (Denoeux, 2004). Dans cette stratégie, l’assistance internationale à la « bonne gouvernance » est fondée sur trois piliers : les élections et les partis politiques ; les institutions de l’État ; la société civile. Le renforcement de la société civile est donc l’un des piliers des interventions de la Banque mondiale, notamment par le recours aux ONG locales qui dans les approches théoriques de la Banque sont dotées d’un certain nombre de vertus.
En effet dans ses développements théoriques portant sur le rôle des ONG locales, la Banque mondiale identifie les forces principales de celles-ci dans leur capacité à atteindre les communautés les plus défavorisées et les marges géographiques ; dans leur fonction d’innovation et d’adaptation des modèles de programme standard aux besoins locaux ; dans leur rôle de médiateur pour transférer les technologies développées ailleurs ; enfin dans leur vocation à promouvoir la participation locale dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes publics (Chiffoleau, 2004). Ainsi, l’aide de la banque mondiale va s’articuler avec les années autour de deux axes majeurs : l’assistance matérielle et technique aux ONG locales, et la promotion du cadre législatif et social nécessaire à leur développement. « Une politique du donnant-donnant va alors se jouer, une forme de troc entre les agences de la Banque mondiale et les membres des gouvernements » (Duault-Atlani, 2003). L’aide de la Banque sera ainsi conditionnée à la promotion d’un cadre législatif et social favorable à la création d’ONG locales qui est relayée par une aide matérielle et technique directe en faveur des ONG. Le but affiché est de permettre « l’éclosion de la société civile », que la Banque mondiale limite à l’existence d’ONG locales en refusant d’y intégrer les mouvements sociaux, les syndicats, les partis politiques…
Dans cette approche, les ONG locales sont supposées garantes de la « bonne gouvernance ».
En effet, pour la Banque mondiale, les ONG locales sont considérées comme faisant l’affaire pour « l’éclosion de la société civile », parce qu’elles ont pris l’habitude de parler au nom de regroupement d’individus partageant une vision commune de certains problèmes. Elles feront d’autant mieux l’affaire qu’elles sont en mal de reconnaissance. Il y a là un processus de légitimation croisée qui arrange tout le monde. Les ONG locales sont alors requises pour pallier deux risques (Roca, 2004). En premier lieu, elles sont censées apporter à la « bonne gouvernance » une certaine forme de subsidiarité : leur proximité supposée par rapport aux acteurs de terrain, leur démultiplication territoriale et leur désintéressement devraient être les gages d’un fonctionnement subsidiaire. En second lieu, on s’accorde souvent à penser qu’elles sont les championnes du partenariat et que ce principe signifie participation de tous à la décision avec un niveau d’information équivalent pour chacun. Leur vie interne est aussi l’occasion d’éduquer des milliers de citoyens à la démocratie. Elles sont donc « pour la Banque mondiale qualifiées pour être, en quelque sorte, l’infrastructure de la démocratie » (Al-Ghaffar Shukr, 2004). Il suffit alors pour la Banque mondiale d’entreprendre différentes réformes techniques pour que les ONG locales se trouvent dans une position qui les rendrait capables d’apporter une contribution efficace à la « bonne gouvernance ». Ces réformes devraient viser leur transparence, leur responsabilité, leur force organisationnelle et leur efficacité.
En accord avec cette position « technique » (Pratt, 2004, Saldomando, 2001), la Banque mondiale a intégré la notion de « bonne gouvernance » dans notamment les documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP) qui doivent être rédigés non plus par les experts du FMI et de la Banque mondiale, mais par les gouvernements des pays pauvres en collaboration avec leur « société civile », à charge pour les experts de Washington d’ensuite de donner leur aval. Mais l’objectif initial de participation démocratique a fait place « sans que cela pose de problème, ni aux institutions ni aux ONG elles-mêmes, à l’idée de consultation d’expertise » (Darmon, 2002). Autrement dit, les ONG locales ne sont pas mobilisées comme des canaux d’expressions citoyennes, mais comme des canaux d’informations qui viennent pallier les lacunes des institutions.
En fin de compte, cette prise de position en faveur des ONG locales comme garantes de la « bonne gouvernance » est désormais défendue par la banque mondiale comme relevant de ce qu’elle considère être une « nouvelle éthique du développement » (Duault-Atlani, 2003). En fait, il s’agit davantage d’améliorer l’information circulant sur le marché et la coordination des agents, de telle sorte que leurs anticipations soient les plus rationnelles possibles (Harribey, 2002).
Invitées dans les grandes arènes internationales, les ONG du Nord ont tôt fait de s’emparer du concept de « bonne gouvernance » pour le reprendre à leur compte.
La rhétorique des ONG du Nord
Dés les années 1990, les ONG du Nord, notamment celles qui ont obtenu une accréditation auprès des organisations onusiennes, mais aussi des ONG de développement telles que CARE, Human Assistance and Develpment International, Oxfam, VSF-CICDA, le GRET…, vont se saisir de la notion de « bonne gouvernance » (Cubillos et al, 2004 ; Planche, 2004). Pour elles, cette notion repose sur un certain nombre de principes : participation, primauté du droit, capacité d’ajustement, orientation du consensus, équité, responsabilité et vision stratégique. Dans cette interprétation, la « bonne gouvernance » doit permettre de conjuguer être et avoir, droits et devoirs d’une communauté d’intérêts communs. L’accent est alors mis sur la participation : tous les hommes et toutes les femmes devraient avoir voix au chapitre en matière de prise de décisions, directement ou par l’intermédiaire d’institutions légitimes qui représentent leurs intérêts. Les ONG locales sont censées remplir ce rôle, car elles possèderaient une multitude d’attributs positifs : leurs petites tailles, leur proximité avec les populations pauvres et leur capacité à créer une sphère publique qui permettrait la participation de tous les individus. « Les ONG locales ont alors pour mission globale d’établir un lien entre les individus et l’État, en renforçant la participation et les moyens d’influence des populations sur la politique et en permettant un meilleur accès aux ressources publiques. L’objectif essentiel réside dans l’acquisition d’un « capital social » ou d’un plus grand potentiel de relations sociales » (Debuyst, 2003).
Dans cette vision, l’approche des ONG du Nord pour une « bonne gouvernance » réside dans le traitement du conflit qui est considéré comme l’un des aspects fondamentaux de l’ordre social. La régulation des conflits prend en compte l’existence d’intérêts divergeant dans la société. En ce sens, elle constate la pluralité et la diversité des alternatives exprimées par le conflit. Surtout, elle reconnaît que la construction d’arrangements sociaux fondateurs de normes et de la régulation est un fait politique né des expériences concrètes de conflits et de négociations qui se produisent dans chaque société. Ainsi, les ONG du Nord cherchent à promouvoir le dialogue et la construction d’espaces de négociation et de consensus. Pour ces ONG, les réformes nécessaires à la construction de ces espaces se mesurent toujours à leur impact en faveur d’un développement soutenable dans des conditions démocratiques. De ce point de vu, l’état de la gouvernance résulte de la situation dans laquelle se trouvent les formes de régulation développées par chaque société (A. Saldomando, 2001).
En conséquence à l’inverse de la Banque mondiale, les ONG du Nord souhaitent la mise en œuvre de « stratégies de la demande » qui permettent la construction de la démocratie « de la base au sommet ». Ces stratégies axées sur la demande visent à renforcer la « société civile » dans sa relation avec l’État et à accroître sa capacité à mettre en forme ses revendications en matière de démocratie et de gouvernance. L’élément central de ces stratégies d’assistance est le soutient apporté aux ONG locales, et les arguments avancés pour le justifier s’appuient en règle générale sur 4 affirmations qui constituent ce que Denoeux (2004) appelle le « paradigme de l’action par la demande » :
La participation à des associations de bénévoles renforce les valeurs, les attitudes et les compétences favorables à la mise en place d’un système de gouvernance démocratique. On suppose qu’une relation étroite existe entre la propension des individus à participer à la vie associative et leur aptitude à s’engager dans la vie publique en général.
Plus le réseau d’associations bénévoles dans lequel s’insèrent les individus est dense et actif, plus ce réseau peut faire office de contrepoids face à l’État.
Les associations militantes actives jouent un rôle essentiel en exerçant sur les gouvernements le type approprié de pression pour raffermir leur volonté politique de réformes et les obliger à être davantage à l’écoute des revendications des citoyens.
Les ONG locales offrent aux citoyens généralement déçus par les partis politiques traditionnels des possibilités d’accéder à l’espace public, de formuler clairement leurs revendications et de diriger l’attention du public vers les problèmes-clés auxquels fait face le pays.
Puisque les ONG locales sont plus ou moins confondues avec la « société civile », cette stratégie se traduit par un plaidoyer en faveur du renforcement des ONG locales et d’une augmentation de leur nombre. C’est une approche « optimiste » (Pratt, 2004) des possibilités d’actions des ONG locales pour une « bonne gouvernance ».
En fin de compte pour les ONG du Nord, les ONG locales sont portées aux nues. Elles seraient les garantes du « post-développement » (Duault-Atlani, 2003).
Et si les ONG locales participaient aussi à la mise en œuvre d’une « mauvaise gouvernance »
Vers la fin des années 1990, les ONG locales commencèrent à subir le contrecoup de l’enthousiasme né des rhétoriques. Des travaux ont alors décrit les ONG locales comme des organisations élitistes, corrompues et dépourvues de structure de responsabilité, qui dépendent du financement occidental et qui promeuvent des programmes occidentaux. Au mieux, on considère qu’elles sont inefficaces et incapables de mener à bien la tâche immense qu’on leur avait originellement assignée (Pratt, 2004) ; au pire, on montre qu’elles peuvent aussi participer à des processus instaurant des régimes autoritaires et dictatoriaux (Denoeux, 2004).
Cinq questions fondamentales ont été en effet soulevées :
Est-ce que les ONG locales contribuent à la démocratisation des systèmes politiques connus pour leur déficit en terme de démocratie, en constituant des espaces d’expérimentation de la participation citoyenne et/ou de nouveaux lieux alternatifs participant à la définition et à la promotion du « bien public » ?
Est-ce que les ONG locales contribuent à construire et à animer des sociétés civiles dignes de ce nom, c’est-à-dire capables de servir de contrepoids, de tampon, de médiateur entre des sociétés en pleine transformation et des pouvoirs publics crispés sur leurs vieilles habitudes autoritaires ?
Est-ce que les ONG locales sont des entités positives pour leur société ou est-ce que leur contribution au développement et à la démocratisation n’est pas surévaluée ?
N’y a-t-il pas confusion entre subsidiarité et citoyenneté ? L’appel à la participation des ONG locales fonctionne bien selon le principe de la subsidiarité, mais rien ne dit qu’elles sont représentatives des opinions de l’ensemble des citoyens. Quelles sont les bases sociales des ONG locales ? Quels intérêts représentent-elles ? Quels modes de régulation ont-elles inventés pour ne pas glisser du « prendre la parole au nom de … » à « prendre la parole à la place de … » ?
Quelle cohérence existe-t-il entre ce que prônent les ONG locales dans leurs discours (une vie sociale plus démocratique) et la façon dont elles fonctionnent ? Quels mandats ont reçu leurs représentants ? Qui les contrôlent ? La proximité du terrain ne sert-il pas de rideau de fumée à la question de la citoyenneté ? …
Pour tenter d’apporter des réponses à ces questions, il faut d’abord regarder de façon concrète comment la gouvernance est exercée, ensuite s’intéresser aux caractéristiques propres des ONG locales, enfin à leur rôle dans la gouvernance.
D’abord, que la banque mondiale et les gouvernements des pays décident de faire une place aux ONG locales dans la gouvernance est une chose, qu’ils choisissent quelles sont les ONG qui doivent participer en est une autre. La facilité dicte de choisir, comme interlocutrices privilégiées, celles qui se sont déjà fait reconnaître dans le champ concerné. Priment alors deux critères : la taille et la pérennité. Les plus grosses ONG locales ont la faveur des organisations internationales parce qu’elles absorbent vite et bien les montants alloués, et parce qu’elles sont préférables à une myriade de petites (Roca, 2004). Ainsi, les ONG locales sélectionnées révèlent un profil particulier représentatif d’une petite minorité d’ONG. Il s’agit pour la plupart d’associations importantes, généralement basées dans la capitale et déjà largement professionnalisées. Le caractère étroit du bassin de recrutement des ONG locales effectivement aptes à mener des programmes de développement d’envergure et à utiliser rationnellement, selon les critères des bailleurs de fonds, les aides financières octroyées, est largement confirmé. En effet, bien peu d’ONG locales sont effectivement actives, entreprenantes. La majorité des associations, à fortiori les plus proches du terrain et donc les plus éloignées géographiquement des centres de décision, ne connaissent pas les procédures nécessaires pour toucher les fonds de la part des donneurs. Il existe donc un fossé important entre les discours dominants qui mettent en valeur l’action des ONG locales, leur participation aux processus de décision et aux modalités de l’action sociale, et la réalité du champ des ONG très peu nombreuses à jouer un tel rôle. Le partenariat regroupant l’État, les organismes internationaux (Banque mondiale et ONG du Nord) et les ONG locales, tant vanté comme principe essentiel de la gouvernance est en fait bien peu actif (Chiffoleau, 2004). En conséquence, les ONG locales ne participent pas à la réalisation des consensus politiques, comme la constitution, les lois organisant les élections ou réglementant l’activité des partis politiques, des associations et de la presse qui déterminent pourtant leurs possibilités d’intervention ainsi que les contraintes auxquelles leurs actions seront soumises (Denoeux, 2004). De même, si les systèmes d’allègement de la pauvreté de la Banque mondiale fournissent une voie de participation, la reconnaissance juridique des associations et du rôle actif des ONG locales, et qu’ils représentent la principale source de soutien financier ; ils imposent aussi un cadre conventionnel et restrictif qui a, dans une certaine mesure, confisqué aux voix dissonantes la capacité de formuler leur propre vision de la pauvreté et de ses solutions. Ils ont réduit la lutte contre la pauvreté à une seule et unique version à prétention universelle. Dans le contexte d’une concurrence féroce pour obtenir des fonds, les ONG locales sont amenées à substituer leur principal objectif d’un développement et d’un changement social véritables à la préoccupation de leur propre survie et de leur soumission aux visions et méthodes implicites et explicites de leurs bailleurs de fonds. Les ONG locales se retrouvent avec un simple rôle de « sous-traitance ». Elles sont ainsi incitées à la déférence face aux donateurs, à ce faire concurrence entre elles et à adopter une attitude de rentier, plutôt que de s’employer d’abord et avant tout à promouvoir leurs valeurs et à répondre aux besoins et demandes de leurs membres (Destreneau, 2004).
Ensuite, les ONG locales peuvent être des organisations élitistes dominées par un cercle restreint de dirigeants qui ne permettraient pas aux membres de participer réellement à la définition des objectifs et des priorités de leurs activités ou d’en contrôler et d’en évaluer la performance (Al-Ghaffar Shukr, 2004). Les ONG locales ne représenteraient pas ipso facto les organisations populaires et ne seraient pas comme telles les porte-parole d’un mouvement associatif ou revendicatif de base. Elles peuvent l’être, mais elles seraient aussi le réservoir d’une petite bourgeoisie « éclairée » soucieuse de maintenir leur emploi : qu’elles soient soumises ou non aux impératifs d’une politique dominante, elles formeraient un écran ou un canal souvent obligé des groupes de base. Elles acquerraient donc un pouvoir propre dont elles profiteraient dans leurs contacts avec les bailleurs de fonds et les ONG du Nord (Debuyst, 2003). Ainsi, l’objectif initial de participation démocratique a souvent fait place à la gestion de projets amplement financés à ce titre par les bailleurs de fonds et les ONG du Nord (Rydberg, 2003). Par-là même, le bilan des ONG locales, quant à leur impact sur la question démocratique, semblerait assez mitigé ou en tout cas insuffisant par rapport à l’espoir mis dans les vertus « magiques » des ONG locales (Ben Néfissa, 2004).
Enfin, les ONG locales peuvent jouer des rôles différents dans la gouvernance. Leurs actions peuvent aller vers un processus de démocratisation, mais elles peuvent aussi participer à la prise du pouvoir par des régimes antidémocratiques. Pour les dirigeants politiques locaux, l’existence d’ONG favorise une certaine reconnaissance internationale sur le plan de la démocratie, sans courir le risque d’autoriser des organisations politiques comme les partis politiques qui visent directement le pouvoir. Ainsi, toutes les ONG locales ne sont pas des organisations aussi civiles, représentatives, apolitiques et non gouvernementales qu’elles le prétendent. Elles peuvent être de simples relais des pouvoirs publics. Considérées comme des « agents de la démocratisation », elles agissent alors parfois dans le sens inverse (Santiso, 2001). Par exemple, dans un article à la fois sérieux, documenté et provoquant Berman (1997) met en lumière comment une « société civile » rigoureuse, composée d’associations de bénévoles, a puissamment contribué en Allemagne à l’écroulement de la République de Weimar et à l’arrivée des nazis au pouvoir. Berman montre qu’au cours des années 1920 et au début des années 1930, l’Allemagne a connu une vie associative exceptionnellement riche. Il démontre que c’est précisément cette « société civile » qui a été mobilisée par le parti nazi lors de son ascension vers le pouvoir. En s’appuyant sur le cas allemand, il suggère que la « société civile » ne renforce pas toujours les valeurs démocratiques, elle peut au contraire les ébranler ou servir ceux qui les combattent ; que la « société civile » amène effectivement les citoyens à participer à la vie politique, mais que cette participation peut être dirigée contre le système démocratique en place. En bref, comme le signale aussi Denoeux (2004), le dynamisme associatif peut se trouver en relation inverse avec les perspectives d’une « bonne gouvernance ».
En conclusion, on ne peut pas, comme le fait la Banque mondiale et dans une moindre mesure les ONG du Nord, affirmer que l’existence d’ONG locales assure automatiquement la mise en œuvre d’une « bonne gouvernance » et la démocratisation de la société, car le terme générique d’ONG locales englobe une très grande diversité d’organisations. De plus, à côté des ONG locales, les mouvements sociaux, les syndicats, les partis politiques ont aussi un rôle fondamental dans la gouvernance ; leur imbrication forme les « sociétés civiles » locales.
Les « sociétés civiles » locales dans la gouvernance
Les ONG locales ne forment pas un bloc monolithique comme le présupposent les approches de la Banque mondiale, des ONG du Nord et de leurs critiques. En effet, on peut au moins distinguer deux types d’ONG locales : les ONG militantes et les ONG de services.
Les ONG de services cherchent à assister et à rendre des services aux populations. Elles s’imposent sur le terrain économique, social et sanitaire, et environnemental par la mise en œuvre de projets de développement pour la prise en charge soit des classes moyennes urbaines paupérisées, soit des populations pauvres des campagnes.
Les ONG militantes recherchent la mobilisation sociale sur des thèmes et visent à modifier l’ordre des choses, en se positionnant comme des instances critiques d’impulsion et de proposition. Leurs domaines privilégiés sont la défense des droits de l’Homme, des droits sociaux et économiques et la défense de l’environnement naturel.
De part leurs fonctions, ces deux types d’ONG ne peuvent pas avoir le même impact sur la gouvernance.
De plus, la Banque mondiale, les ONG du Nord et leurs critiques ont une fâcheuse tendance à restreindre la « société civile » à ces seules ONG locales, alors qu’elle est aussi constituée par les mouvements sociaux et syndicaux entendus comme une action collective entreprise par des populations qui ont une cause spécifique à défendre et des objectifs concrets, limités dans le temps et dans l’espace, avec des stratégies, des règles de fonctionnement, des plans d’actions et des structures appropriées. Pourtant l’imbrication étroite entre les ONG locales et les mouvements sociaux et syndicaux est un élément clé de la participation des ONG locales à la gouvernance. Des exemples tirés des expériences latino-américaines, notamment brésiliennes et des expériences africaines, notamment d’Afrique de l’Ouest, le montrent bien.
La dynamique latino-américaine
L’histoire politique de l’Amérique latine est très liée au développement des organisations de la « société civile » latino-américaine. Sous les dictatures des années 1970, la vie associative était le refuge de militants qui trouvait dans l’espace social une possibilité de s’investir en construisant patiemment les éléments d’un contre modèle économique et social au libéralisme débridé qui démantèle peu à peu l’essentiel des services sociaux. Elle a été aussi le point d’appui d’une transition démocratique.
Deux facteurs ont particulièrement contribués à ce phénomène. D’une part, le rôle de l’Église catholique au sein de laquelle la Théologie de la libération a permis une forme d’expression de la « société civile » par ses innombrables prolongements sociaux et culturels, y compris durant les années de plomb. D’autre part, l’Amérique Latine a suscité très tôt, dés la fin de la deuxième guerre mondiale, la compassion des chrétiens nord-américains. D’où la multiplication de programmes d’aide qui ont été portés d’abord par des ONG nord-américaines, puis ont suscité la constitution de nombreuses associations locales. Ce faisant, l’idée que les populations devaient elles-mêmes s’organiser pour prendre leur destin en main, sans attendre nécessairement que l’État, même « révolutionnaire », le fasse, faisait son chemin. Ainsi, les ONG locales se sont multipliées, elles se sont progressivement orientées vers la gestion de projets de développement. En conséquence, il existe aujourd’hui en Amérique Latine deux sortes d’ONG locales de services : les organisations de base et les organisations intermédiaires (ou association d’appui aux associations de base).
Les organisations de base sont notamment les associations communautaires, de quartier, les groupements paysans ou les associations de femmes qui reposent sur la socialisation des moyens de production. Elles répondent aux besoins fondamentaux des populations, jouent un rôle clé dans leur formation et dans leur participation au processus de développement. Elles servent de catalyseur, de mobilisateur, de négociateur. Elles proposent d’être un interlocuteur, de revendiquer, de défendre des droits, d’assurer une vigilance civile.
Les organisations intermédiaires sont une catégorie très hétérogène. Elles jouent un rôle de pionnier dans la mise en place de programmes de développement, mais aussi un rôle de service et d’intermédiaires. Elles sont de plus en plus appelées par les États à participer à la mise en place de programmes sociaux. Certaines ont acquis une telle importance qu’elles sont devenues les interlocutrices du gouvernement pour la mise en place de politiques sociales et sont reconnues pour leur capacité d’influence sur lui. C’est notamment le cas de Caritas au Brésil.
Il s’est développé aussi en Amérique Latine des ONG militantes s’inscrivant en réaction à la pratique des emprisonnements arbitraires durant les dictatures, comme « Les mères de la place de mai » en Argentine, créée en 1977 un an juste après le coup d’État pour savoir ce qu’étaient devenus les disparus.
Parallèlement au développement des ONG de services et militantes, les mouvements sociaux sont nés du constat de l’incapacité de certains acteurs sociaux traditionnels (syndicats) à négocier et à agir, ou de celui de la carence des institutions publiques vis-à-vis des besoins de catégories importantes de la population. Ils se sont progressivement affirmés comme porteurs de propositions globales sur un choix d’évolution pour les sociétés, s’inscrivant ainsi dans la sphère politique. Parmi les plus importants, il faut citer les mouvements de paysans, les mouvements de défense des peuples indigènes et les mouvements civiques. Le Mouvement des Sans Terre (MST) au Brésil est la figure emblématique des mouvements paysans. Mais il faut aussi citer l’Union Nationale des Organisations Régionales Paysannes et « El Barzon » au Mexique, les « Rondas » au Pérou, les Comités unité paysanne au Guatemala. Ils sont tous nés dans les années 1970. Pour les mouvements de défense des peuples indigènes, la Confédération nationale des nationalités indiennes d’Équateur qui participe à toutes les négociations pour les réformes agraires ainsi qu’au débat législatif sur la pluri- nationalité est le plus grand mouvement indien d’Amérique Latine. Un homologue existe au Mexique, le Congrès national indigène, mais dont l’effort fédératif est limité par de profondes divergences entre organisations membres, certaines comme le mouvement « Zappatiste » ayant choisi la voie de l’affrontement avec les pouvoirs publics. Pour les mouvements civiques, par exemple au Mexique, il y a le Mouvement des citoyens, créé en réaction active aux trucages des élections auxquels était soupçonné de se livrer le Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI). Cette organisation a initialement mis en place des observateurs pour les élections, mais a élargi son propos à une revendication générale en faveur de la démocratie. De là est née l’Alliance civique.
Enfin, les mouvements syndicaux n’ont pas immédiatement compris la nouvelle dynamique impulsée par les autres organisations de la « société civile ». Ils se sont attachés à leur rôle d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics qu’ils avaient hérités de la période des régimes populistes et clientélistes. Puis, ils ont commencé à voir les choses autrement.
La « société civile » latino-américaine composée d’ONG de services, d’ONG militantes, de mouvements sociaux variés et de mouvements syndicaux est très active. Notamment, les ONG de services (organisations de base et intermédiaires) sont à la base du développement d’une économie populaire solidaire composée de pratiques économiques fondées sur la libre association des travailleurs. En particulier au Brésil, la nouvelle solidarité populaire s’exprime dans les idées et pratiques d’un nombre croissant d’initiatives économiques prises par des travailleurs motivés par l’absence d’alternatives pour subsister ou par la force de leurs convictions. Dans un cadre réellement polymorphe, ces initiatives s’organisent de différentes manières : en associations informelles ou en communautés de production, en coopératives ou en PME. Au premier rang, on trouve des entreprises industrielles en autogestion et des coopératives de production soutenues par de nombreuses ONG intermédiaires, et des centaines d’associations et de coopératives agricoles et d’élevage implantées dans les assentamentos[1]de la réforme agraire sous la direction du MST et avec l’appui d’ONG (Gaiger, 2003). Aussi, les ONG intermédiaires développent-elles des modes d’actions et d’interventions qui leur permettent une plus grande proximité avec les populations cibles de leurs services : structures décentralisées, flexibilité, facilité d’accès, bénévolat et relations de confiance et de coopération.
Simultanément, les dirigeants des ONG militantes et des mouvements sociaux et syndicaux, en raison de leur expérience politique, protègent rigoureusement leur autonomie à l’égard des partis politiques et s’opposent à l’instrumentalisation politique de l’organisation. C’est, par exemple, le cas pour le MST vis-à-vis du Parti des Travailleurs (PT) au pouvoir actuellement au Brésil, même si le MST a largement participé à la victoire du PT.
On trouve donc essentiellement en Amérique Latine, des ONG et des mouvements « sans les centres » pour reprendre l’expression de Roca (2004), c’est-à-dire des organisations ou des mouvements qui adoptent la stratégie suivante par rapport au pouvoir central : ils se détournent du pouvoir central que pour mieux revenir le concurrencer sur sa propre zone d’influence. Cette stratégie révèle trois formes :
- la première consiste à investir le terrain de l’innovation et de l’expérimentation, du point de vue social et économique (coopératives de recycleurs, assentamentos, entreprises en autogestion …) ;
- la deuxième est le contournement de la logique de fonctionnement des centres qui caractérise des organisations qui s’affranchissent du contrôle national en étant « branchées » au-delà de la frontière nationale au sein de partenariats internationaux avec des organisations étrangères du Nord comme du Sud (Caristas au Brésil ou Via campesina mouvement paysan revendiquant plus de 50 millions de membres dans une soixantaine de pays, dirigé depuis le Honduras) ;
- la troisième est la contestation qui vise à faire changer le centre ou/et sa loi et/ou son fonctionnement, la logique de fonctionnement correspond plus ici à celle des mouvements sociaux comme le MST, ou le mouvement « Zapatiste »
Ces trois formes innovation, contournement et contestation bousculent chacune à sa façon les pouvoirs centraux. Elles remettent en cause la gouvernance traditionnelle des centres (politique et économique) et veulent imposer de nouvelles modalités de gouvernance. Les pratiques de budget participatif dans de nombreuses municipalités brésiliennes en est l’exemple type. Ainsi, les organisations de la « société civile » latino-américaine promeuvent de nouvelles formes de démocratie, au-delà du modèle d’intégration de la démocratie libérale occidentale. Elles sont à même d’avancer des modèles alternatifs d’organisation étatique et sociétale puisqu’elles incorporent des éléments qui luttent pour l’établissement de modèle démocratique de substitution à la démocratie représentative. Elles militent largement pour la réalisation d’une démocratie participative.
C’est ainsi que le placement d’espoir dans la capacité de la « société civile » à contribuer au développement démocratique et à une gestion efficace et transparente des affaires publiques s’explique par le rôle déterminant que la « société civile » latino-américaine a effectivement joué, depuis les années 1980, dans la mobilisation des oppositions aux régimes autoritaires et qu’elle joue actuellement comme force de propositions. Ces événements d’une importance capitale ont conduit certains observateurs à supposer de façon précipitée que l’on pouvait espérer voir la « société civile » remplir une fonction similaire de démocratisation dans des contextes très différents comme l’Afrique.
Le leadership africain
Le cas africain est restreint à l’étude de la situation en Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, pour avoir un cadre homogène, car d’une part l’Afrique du Sud a connu un développement particulier de sa « société civile » du fait de l’importance que les associations ont joué, sous le régime de l’apartheid, pour permettre à la communauté noire de s’organiser dans une résistance politique et sociale active préparant sa prise de pouvoir non-violente ; d’autre part la problématique du développement de la « société civile » de l’Afrique du Nord relève plus de celle des pays arabes (Ben Néfissa et al., 2004). Les exemples sont principalement tirés des expériences d’Afrique de l’Ouest.
Dès les premières années d’Indépendance (et même parfois avant, surtout sous l’impulsion des Églises) ; mais de manière plus importante depuis les années 1970, des ONG du Nord ont travaillé aux côtés des populations dans des zones « à l’écart » et sur des thèmes délaissés par les pouvoirs publics : maraîchage, crédit rural… Ce travail s’est accompagné en général de la création d’organisations à l’échelle villageoise chargées de gérer les activités mises en place. Un grand nombre d’organisations de base, notamment dans le monde rural, se sont ainsi créées (Diagne et al, 1995). Par conséquent, dans tous les pays d’Afrique de l’Ouest, on observe une génération d’organisations de base souvent relativement anciennes. Elles ont été créées par une impulsion extérieure au milieu pour être des courroies de transmission de l’action publique, ou des interlocuteurs des intervenants du développement. Très peu parmi elles sont issues de dynamiques réellement endogènes. Ces organisations de base créées dans les années 1970-1980 ont connu depuis des évolutions différenciées (Wampfler, 2000) : certaines d’entre elles se sont dissoutes dés que l’impulsion extérieure a cessé, d’autres survivent avec une activité réduite, d’autres encore ont valorisé des opportunités qui s’offraient à elles pour se renforcer et se restructurer. Ainsi, depuis le début des années 1990, on observe une restructuration et des tentatives d’assainissement d’organisations de base anciennes, mais aussi l’émergence d’organisations nouvelles qui semblent d’avantage issues de dynamiques endogènes, même si elles aussi restent fortement appuyées par l’extérieur.
En effet, il faut attendre les années 1990 pour assister à une véritable explosion associative dans un grand nombre de pays africains. Plusieurs facteurs se sont combinés pour cela :
des phénomènes objectifs et structurels : urbanisation, l’apparition d’une élite lettrée, etc ;
la reconnaissance de la faillite des États dans leurs rôles social, éducatif, économique accentuée par les effets des plans d’ajustement structurel, les bailleurs de fonds ont préféré subventionner directement des projets privés plutôt que de passer par les gouvernements ;une poussée convergente des ONG du Nord soucieuses de clarifier leurs relations avec leurs partenaires africains et de voir des associations africaines prendre peu à peu le relais des ONG étrangères œuvrant pour le développement ;les collectifs de migrants qui, depuis l’Europe, envoyaient des fonds dont l’utilisation n’était pas toujours satisfaisante, ont poussé leurs familles ou villages d’origine à se constituer en association ;le retour au pays de jeunes formés dans les universités étrangères, pas assez riches pour réunir le capital nécessaire à la création de sociétés, qui choisissent la forme associative pour créer leur activité ;les contraintes législatives entourant la création de partis politiques dans les pays où les régimes ne se convertissent que formellement au multipartisme, ce qui pousse à l’utilisation de la forme associative pour leur échapper.
Cette explosion associative a donné naissance à de nouvelles organisations spontanées quand les populations prennent l’initiative de s’organiser, de s’unir pour trouver une solution à leurs difficultés et mettre fin à leur situation d’exclusion, mais aussi et comme par le passé à des ONG suscitées, c’est-à-dire sous l’impulsion d’une intervention extérieure, notamment d’une ONG étrangère. Dans ce dernier cas, ce ne sont pas les populations qui cherchent par elles-mêmes à modifier leur situation d’exclusion, mais c’est plutôt l’intervention extérieure qui amorce le processus (Abalain, 2004, p.65-68). Ainsi, en Afrique subsaharienne, si quelques fois les ONG de base sont spontanées, la plupart d’entre elles et des ONG intermédiaires ont été suscitées de l’extérieur. En conséquence, notamment dans les ONG de services, elles comptent plus sur leurs salariés rémunérés grâce aux bailleurs de fonds que sur les bénévoles. Le pouvoir décisionnel est alors restreint à une ou deux personnes sans une véritable démocratie participative au sein de l’ONG. En effet, « les ONG en Afrique sont caractérisées par leur intervention par le bas, leur engagement citoyen et leur rôle de laboratoire, mais leur légitimité a été acquise pour l’essentiel au dehors et elles restent dépendantes des financements extérieurs » (Fall et Guèye, 2003).
De même, des ONG militantes sont apparues. Dans les pays où ont été rédigées de nouvelles constitutions, les associations ont lancé des campagnes visant à informer les citoyens de leurs nouveaux droits. Les ONG intervenant plus particulièrement dans le domaine des droits de la Femme sont également une nouvelle donnée. Mais les ONG militantes forment encore un secteur associatif « spécialisé ». Elles recrutent la quasi-totalité de leurs membres au sein d’une population de jeunes intellectuels et de cadres urbains, pour lesquels l’Occident demeure une référence majeure. Elles tendent à être surtout actives dans les capitales et les grandes villes et à faire porter leurs efforts essentiellement sur le gouvernement central.
Par ailleurs, l’émergence de mouvements sociaux en Afrique subsaharienne est très récente. Ils se développent essentiellement dans le monde rural par une dynamique fédérative ascendante résultant d’union et de regroupement d’organisations de base qui débouchent dans des délais relativement brefs sur des coordinations nationales : le groupement Naam au Burkina Faso, la Fédération des ONG sénégalaises (FONGS) ; puis sur des coordinations sous régionales : le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Créé en l’an 2000 à Cotonou, le ROPPA est une initiative propre d’organisations de base de 10 pays d’Afrique de l’Ouest. Ses axes stratégiques sont le renforcement des capacités de ses membres à comprendre la situation des organisations de base et à agir par eux-mêmes et avec les autres pour améliorer durablement les conditions de vie dans les exploitations familiales rurales ; et l’élaboration de propositions à soumettre aux décideurs et aux partenaires quant aux orientations, priorités, programmes et actions qui permettent à l’agriculture ouest africain de relever les défis de la sécurité alimentaire durable. Le ROPPA se veut avant tout une force de proposition (www.roppa-ao.org).
Si les choses sont entrain d’évoluer en Afrique de l’Ouest, pour l’instant on observe encore une incomplétude de la « société civile » liée au faible nombre d’ONG spontanées et au développement très très récent des mouvements sociaux.
Plusieurs éléments expliquent cette incomplétude : l’absence de culture d’action bénévole et le manque de compétence. « La culture de l’action bénévole constitue sans aucun doute la ligne de démarcation entre l’autonomie de la « société civile » et sa dépendance, voire entre son existence et sa non-existence » (Al-Sayyid, 2004). Or cette culture ne s’est pas beaucoup cristallisée dans le domaine de la vie civile des pays d’Afrique subsaharienne en comparaison de leur vie « communautaire ». Cette dernière se distingue par le fait qu’elle est étroitement liée aux allégeances primaires : le clan, la tribu, la famille, le quartier. Le citoyen africain offre volontairement et gratuitement ses services et ses biens à son clan ou à sa tribu, mais plus rarement aux ONG qui œuvrent pour atteindre des objectifs et des intérêts plus généraux. De plus, en Afrique subsaharienne, la « société civile » souffre du manque de compétence dans la gestion administrative. Cette carence professionnelle s’explique d’abord par le taux d’analphabétisme qui handicape les organisations qui sont souvent très dépendantes alors des ONG d’appui du Nord assurant leurs supports professionnels. Ensuite, les membres n’osent pas s’investir dans l’ONG par peur de ne pas être à la hauteur du fait de leur faible formation. Ils sont encore trop peu nombreux à être en mesure d’élaborer des rapports d’activités ou financiers pour rendre compte aux bailleurs de fonds. Souvent, ce sont alors les animateurs des ONG étrangères qui effectuent ces tâches (Abalain, 2004, p.56). Ainsi, un tel problème ne se situe pas uniquement au niveau du personnel administratif, mais aussi au niveau des éléments capables de construire des institutions, d’en développer la performance et de surmonter les difficultés. La plupart des ONG s’appuient de fait sur une seule personne dont dépend aussi bien son développement que sa disparition lorsque cette personne se retire. En conséquence, le pouvoir est souvent concentré dans les ONG africaines entre les mains d’un nombre très restreint d’individus influents qui conduit à la règle de la personnalisation du pouvoir de décision.
C’est la raison pour laquelle on trouve surtout en Afrique subsaharienne deux types d’ONG : les ONG « para-administratives » et les ONG « loin du centre » pour reprendre là aussi l’expression de Roca (2004). Les ONG sont souvent des organisations « para-administratives », en raison des liens étroits qu’elles entretiennent avec les pouvoirs publics tant nationaux que locaux. « Elles constituent dans ce cas soit des instruments de l’intervention publique, soit des espaces privilégiés d’intermédiation entre l’ordre social et l’ordre étatique » (Ben Néfissa, 2004). En général, ces ONG disposent de réseaux clientélistes multiples propres aux leaders. Ce qui pose problème, c’est le fort niveau d’institutionnalisation de ces ONG. En effet, la reconnaissance publique acquise s’accompagne de tentatives d’instrumentation qui affectent directement leur niveau d’autonomie et modifie le sens même du projet associatif. De ce point de vue, la tendance à l’incorporation d’ONG dans les programmes publics de lutte contre la pauvreté sous la forme de politique d’appui à la « société civile » a provoqué le « formatage » d’un certain nombre d’ONG africaines selon la logique de la Banque mondiale. En réaction, de nombreuses ONG en Afrique subsaharienne sont des ONG « loin des centres » qui désertent volontairement le terrain politique. Leurs leaders adoptent ce comportement suite au dépit de ne pas avoir été reconnus par le pouvoir central comme acteurs politiques ou suite à des actions politiques avortées. Faute d’avoir réussi à prendre le contrôle du pouvoir, les leaders en question s’investissent dans le social, dans l’effectivité technique ou dans le lobbying à visée universaliste. Ce retrait déclaré du politique est traduit par les tenants du pouvoir comme une position de non-agression. Ces leaders ne créent donc pas d’ONG ni par appât du gain ou par arrivisme, ni parce que de cette façon ils garderaient les rênes du pouvoir, comme c’est le cas pour les ONG « para-administratives ». Ils prennent le risque d’innover tout en restant dans la ligne politique tracée par le pouvoir, et s’assurent ainsi non seulement la survie de leur position dans un système politique en mutation, mais aussi la reconnaissance par les bailleurs de fonds qui leur permet d’accéder à des responsabilités importantes dans le dispositif de l’aide au développement. Ce phénomène est confirmé par l’enquête de Abalain (2004, p.58) où les dirigeants des ONG n’évoquent jamais que leur motivation est d’ordre politique pour faire pression sur les pouvoirs publics. La position de ces leaders par rapport aux pouvoirs centraux et locaux est d’informer les autorités « pour éviter les problèmes ». De plus le caractère autoritaire de nombreux gouvernements africains décourage les démarches politiques des ONG locales dans la défense des intérêts de leurs membres au risque de voir l’ONG disparaître.
Ainsi, les organisations de la « société civile » subsaharienne, malgré leurs initiatives, participent peu à la gouvernance. Leur apport concernant la démocratisation de leurs sociétés est plus que mitigé, car soit elles « collent » aux pouvoirs publics, soit elles refusent de mener des actions politiques, mais les choses pourraient évoluer avec l’émergence très récente des mouvements sociaux.
Les conditions de participation des ONG à la gouvernance
Les exemples latino-américains et africains montrent que les ONG locales prises isolément ne peuvent pas être l’un des piliers de la « bonne gouvernance » comme le suggère la Banque mondiale. Deux conditions apparaissent nécessaires pour que les ONG participent à la gouvernance : qu’elles soient connectées aux autres acteurs de la société ; qu’elles soient portées par la dynamique des mouvements sociaux.
1) Les ONG locales pour participer réellement à la gouvernance ne doivent pas être déconnectées du reste de la société. C’est notamment l’enseignement que l’on peut tirer des expériences africaines. Dans beaucoup d’ONG subsahariennes, le pouvoir est concentré entre les mains d’un nombre restreint d’individus. La conséquence est l’absence de communications horizontales entre ces ONG puisqu’elles ne sont intéressées que par les contacts verticaux avec l’administration, le gouvernement, les bailleurs de fonds ou les ONG étrangères. De plus l’isolement des ONG rurales est extrême. « L’enclavement des villages ne facilite pas les communications horizontales, les ONG rurales agissent souvent en vase clos sans aucune ou peu de relations entre elles même lorsque leurs zones d’intervention se chevauchent » (Abalain, 2004, p.57). Le manque de communications horizontales a pour effet de diminuer considérablement la capacité de mobilisation dans l’espace public autour de préoccupation d’intérêt général.
Parallèlement, en Afrique subsaharienne, la ligne de partage entre les ONG militantes et les ONG de services est très forte. Du fait de leur importante dépendance financière vis-à-vis de leurs partenaires du Nord et des bailleurs de fonds internationaux, les ONG de services sont dans l’impossibilité de mener des actions militantes qui pourraient détourner les fonds. Réciproquement, les cadres urbains, proche du pouvoir, membres des ONG militantes ne souhaitent pas ou ne veulent pas s’investir dans des actions concrètes, car leur objectif personnel est d’intégrer la sphère politique. Cette ligne de partage est renforcée, par des syndicats confinés dans des rôles préétablis. Leurs liens avec d’autres acteurs de la « société civile » restent timides. La construction d’alliance au sein de la « société civile » est compromise par le manque de vision commune et de projets de société partagés.
Au total, on observe en Afrique subsaharienne une diversité des sphères et des acteurs, mais aussi leur cloisonnement et leur peu de reconnaissance mutuelle qui rendent leur mise en réseau difficile. Dans différents pays africains, les fédérations se font et se défont au gré des logiques fractionnelles, reflet des stratégies individuelles ou de petits groupes visant à se positionner de manière singulière dans le champ d’intervention pour le développement. Cette situation est entretenue par le brouillage introduit par les bailleurs de fonds dont les grilles d’analyse et les définitions politiques de soutien sont parasitées par l’affichage de normes qui visent manifestement à assoire leur contrôle sur les acteurs organisés. « Dans un tel contexte, les dynamiques collectives impulsées par la mise en réseau ne procèdent pas de la solidarité de groupes de paires. Elles instrumentalisent les espaces solidaires à des fins de reproduction de groupes sectaires, donc de clubs fermés » (Fall et Guèye, 2003). Ainsi, lorsque des réseaux d’ONG se développent en Afrique subsaharienne, ils ne fonctionnent pas de manière optimale. Leur émergence reste étroitement liée aux enjeux projetés par les intervenants externes qui, par l’allocation des ressources, ont une influence sur la configuration du mouvement associatif. Mais la nouvelle dynamique fédératrice pourra peut être faire évoluer cet état de faits.
2) Les ONG locales pour pouvoir réellement participer à la gouvernance doivent être portées par la dynamique des mouvements sociaux et s’incorporaient à ceux-ci. C’est notamment les enseignements que l’on peut tirer des expériences latino-américaines, notamment brésiliennes. La ligne de partage entre les ONG de services et les ONG militantes est devenue floue, il existe de plus en plus une « nouvelle génération d’ONG » qui emprunte aux deux modèles. Des ONG créées à l’origine pour s’occuper de problèmes concrets et urgents, ont aussi pris part à des actions militantes, allant des campagnes de sensibilisation jusqu’aux pressions sur les autorités municipales et sur les élus. Réciproquement, des groupes de militants mettent en œuvre des initiatives concrètes. Un autre fait remarquable est le renouveau du coopératisme impulsé par les syndicats. Des pans importants du syndicalisme se sont engagés dans ce mouvement, qui formule des propositions, encourage la formation de coopératives authentiques et lutte pour la reconquête ou l’amendement des coopératives dénaturées (créées par les gouvernements durant la période populiste) ou mises en place de façon frauduleuse. « Ce virage du syndicalisme marque, dans une certaine mesure, une orientation nouvelle de la pensée socialiste, tout en réaffirmant dans un langage nouveau, les valeurs historiques du mouvement ouvrier » (Gaiger, 2003).
De plus, l’effondrement du modèle socialiste de référence pour les pays latino-américains a remis les mouvements sociaux face à eux-mêmes et, du coup les a amenés à ré interroger les fondements du développement de leur société et les modes d’organisation de la démocratie. Dés lors de nouveaux thèmes sont apparus comme des composantes nécessaires d’une nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté : le rôle des gouvernements locaux ; la création de partenariats entre les ONG, les municipalités, les coopératives, les syndicats ; le développement durable des territoires ; la mise sur pied d’organisation d’économie populaire et d’entreprises à finalité sociale. Tout cela a été accompagné d’une batterie de nouveaux créneaux et dispositifs tels que les finances solidaires, le commerce équitable Sud-Sud, les conseils de quartier, etc. (Favreau et al., 2004). La convergence de ces différents acteurs et leurs interactions prédisposent au renforcement des pratiques de collaboration et forgent ainsi, peu à peu une culture du partenariat. Des réseaux de formation, des fédérations de coopératives, des systèmes d’échanges et des unions diverses se structurent à l’échelle locale, nationale, internationale sur l’ensemble du continent latino-américain. Ce sont ces réseaux qui jouent un rôle crucial dans la gouvernance, c’est eux qui promeuvent de nouvelles formes de démocratie.
Conclusion
Si la Banque mondiale veut réellement renforcer les « sociétés civiles » dans les pays du Sud pour la mise en œuvre d’une « bonne gouvernance », son action ne doit pas se limiter à un appui aux ONG locales. Elle devra mettre en œuvre une stratégie beaucoup plus ambitieuse permettant la densification des ONG locales, l’éclosion et le développement des mouvements sociaux, le renouveau du syndicalisme, l’assurance du multipartisme et la mise en réseau de ces différents acteurs, sans que cela puisse présumer de la réalisation d’une « bonne gouvernance », mais uniquement d’une participation de la « société civile » à la gouvernance.
Si les « sociétés civiles » sont composées des ONG locales et des mouvements sociaux et syndicaux, on ne peut pas ignorer, comme nous l’avons fait dans ce texte, qu’elles incorporent aussi les mouvements religieux. En Amérique Latine, le développement des sectes protestantes ne fait aucun doute. Quel sera leur rôle dans la gouvernance ? Viendront-elles renforcer ou avorteront-elles l’embryon de la démocratie participative ? En Afrique, la montée en puissance des mouvements chrétiens, mais surtout musulmans est une réalité. La mobilisation populaire dont ils sont porteurs, ira-t-elle dans le sens d’une démocratisation des sociétés ? Ou les enfermera-t-elle dans un fondamentalisme religieux ?
Seul les peuples devraient écrire leur Histoire, vouloir imposer de l’extérieur et par le haut la voix à suivre : la « bonne gouvernance », risque de donner des résultats inverses de ceux attendus, d’autant que la méthode est par essence antidémocratique.
Bibliographie
Abalain A.-S., (2004), Le renforcement des capacités des acteurs de l’économie solidaire dans le contexte togolais, DESS : Évaluation de projets, Faculté des Sciences Économiques, Université de Rennes 1, 150p.
Al-Ghaffar Shukr A., (2004), Les ONG islamiques et la démocratie en Égypte, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi S., Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, pp. 197-211.
Al-Sayyid M., (2004), Culture de la relation entre le civil et le politique dans les ONG, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi S., Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, pp. 65-79.
Banque mondiale (1992), Governance and development, Washington, Word Banque publications,.
Ben Néfissa S., (2004), ONG et gouvernance dans le monde arabe : l’enjeu démocratique, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi N., Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, pp. 11-25.
Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi S., Milani C., (2004), ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, 424p.
Berman S., (1997), « Civil society and the collapse of Weimar Républic », World Politics, 49, Avril.
Blundo G., (2000), Monnayer les pouvoirs : espaces, mécanismes et représentations de la corruption, PUF, 347p.
Campbell B., (1997), Débats actuels sur la reconceptualisation de l’État par les organismes de financement multilatéraux et l’USAID in GEMDEV, Les avatars de l’État en Afrique, Paris, Karthala, pp. 79-93.
Castel O., (2002), Le Sud dans la mondialisation : quelles alternatives ?, Paris, La Découverte, 212p.
Chiffoleau S., (2004), La place des ONG dans la réforme du système de santé en Égypte: réalité ou utopie de la gouvernance ?, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi S., Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, pp. 271-283.
Cubillos C., Apollin F., (2004), « Renforcement de la société civile, politique d’alliances et partenariat », Traverses, n°14, 32p.
Darmon I., (2002), « Dialogue civil, gouvernance et société civile », La revue nouvelle, n° mars-avril, pp. 69-81.
Debuyst F., (2003), « Outil alibi ou contre pouvoir ? », GRESEA Échos, n°39, pp. 16-18.
Denoeux G., (2004), Promouvoir la démocratie et la gouvernance dans les pays arabes : les options stratégiques des bailleurs de fonds, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi S. Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, pp. 81-112.
Destreneau B., (2004), Le système d’allégement de la pauvreté et le rôle des associations au Yémen, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi N., Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, pp. 369-399.
Diagne D., Pesche D., (1995), Les organisations paysannes et rurales : des acteurs du développement en Afrique sub-saharienne, Réseau GAO, 84p.
Doucin M., (2000), Guide de la liberté associative dans le monde, Paris, La documentation française , 572 p.
Duault-Atlani L., (2003), « La « bonne gouvernance », nouvelle éthique du développement ? L’expérience des pays d’Asie centrale et de transcaucasie post-sociétique », Autrepart, IRD, n°28, pp. 165-179.
Fall A. S., Guèye C., (2003), « Les ressorts de l’économie sociale et solidaire en Afrique de l’ouest », La revue MAUSS, n°21, pp. 97-112.
Favreau L., Larose G., Fall A. S., (2004), Altermondialisation, développement et démocratie : la contribution des organisations de coopération internationales, in Favreau L., Larose G.; Fall A. S., Altermondialisation, économie et coopération internationale, Presse de l’Université du Québec, Québec, Paris, Karthala, pp. 346-384.
Gaiger I., (2003), « L’économie solidaire au Brésil : l’exemple du Sud », La Revue MAUSS, n°21, pp. 80-96.
Harribey j.-M., (2002), « La « bonne gouvernance » ou l’allocation des ressources par le marché, c’est le non-développement assuré« , Forum Social européen, Financement du développement, Florence, 9p.
Lebeau F., (2004), « Un partenariat en appui à l’agriculture familiale au Brésil », DESS : Évaluation de projets, Faculté des Sciences Économiques, Université de Rennes 1, 103p.
Melo Lisboa (de)A., (2000), Os desafios da economia popular solidária, Groupe de recherches sur l’économie solidaire au Brésil, www.ecosol.org.br, 12 pages.
Planche J., (2004), « Accompagner l’émergence et le renforcement des sociétés civiles », Coopérer aujourd’hui, n°38, 51p.
Pratt N., (2004), Hégémonie et contre-hégémonie en Égypte : les ONG militantes, la société civile et l’État, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi S., Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe, Paris, Karthala, pp. 167-196.
Roca P.-J., (2004), A la fois « dedans » et « dehors » : les ONG dans les relations internationales, in Ben Néfissa S., Abd al-Fattah N., Hamafi S. Milani C., ONG et gouvernance dans le monde arabe », Paris, Karthala pp. 49-63.
Rydberg E., (2003), « Instituer la société civile », GRESEA Échos, n°39, pp. 15.
Saldomando A., (2001), Quelques interrogations sur la gouvernance, in Haut Commissariat à la Coopération Internationale, « Les non-dits de la bonne gouvernance », Paris, Karthala, pp. 95-117.
Santiso C., (2001), Renforcer la démocratie et la bonne gouvernance : vers une nouvelle coopération politique au développement, in Haut Commissariat à la Coopération Internationale, « Les non-dits de la bonne gouvernance », Paris, Karthala, , pp. 79-94.
Teegen H., Doh J.P., Vachani S., (2004), « The importance of nongovernmental organizations in global gobernance and value creation : an international business research agenda », Journal of International Business Studies, n°35, pp. 463-483.
Wampfler B., (2000), Contribution des organisations paysannes au financement de l’agriculture : un éclairage à partir de l’exemple de l’Afrique de l’Ouest, Document de travail, CIRAD-TERA, 30p.
[1] L’assentamentos est l’entité économique et sociale formée par l’installation des paysans sur une étendue qui est partagée selon le nombre de famille et le système choisi d’exploitation de la terre.