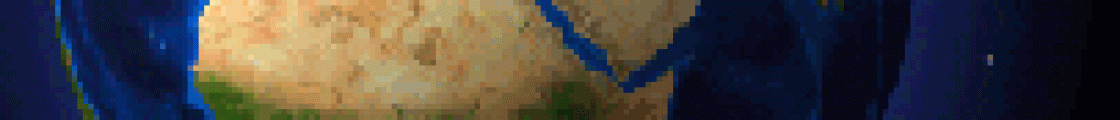Depuis 2001, l’opposition d’extrême droite soutenue par les États-Unis tente de renverser la révolution bolivarienne. Les États-Unis n’avaient aucun problème avec le Venezuela en tant que tel, ni avec le pays lui-même, ni avec son ancienne oligarchie. Le problème que rencontrent le gouvernement américain et les grandes entreprises réside dans le processus initié par le premier gouvernement du président Hugo Chávez.
En 2001, le processus bolivarien de Chavez a adopté une loi appelée loi sur les hydrocarbures organiques, qui affirmait la propriété de l’État sur toutes les réserves de pétrole et de gaz, réservait les activités en amont d’exploration et d’extraction aux entreprises contrôlées par l’État, mais autorisait les entreprises privées – y compris les entreprises étrangères – à participer aux activités en aval (telles que le raffinage et la vente).
Le Venezuela, qui possède les plus importantes réserves de pétrole au monde, avait déjà nationalisé son pétrole par des lois en 1943, puis de nouveau en 1975. Cependant, dans les années 1990, dans le cadre des réformes néolibérales impulsées par le Fonds monétaire international (FMI) et par les grandes compagnies pétrolières américaines, l’industrie pétrolière a été largement privatisée.
Lorsque Chavez a promulgué cette nouvelle loi, l’État a repris le contrôle de l’industrie pétrolière (dont les exportations représentaient 80 % des recettes extérieures du pays). Cette mesure a provoqué la colère des compagnies pétrolières américaines, notamment ExxonMobil et Chevron, qui ont fait pression sur le gouvernement du président américain George W. Bush pour qu’il prenne des mesures contre Chavez.
En 2002, les États-Unis ont tenté d’orchestrer un coup d’État pour destituer Chavez. Cette tentative, qui a duré quelques jours, a ensuite poussé la direction corrompue de la compagnie pétrolière vénézuélienne à déclencher une grève afin de paralyser l’économie du pays (ce sont finalement les travailleurs qui ont défendu l’entreprise et l’ont reprise en main). Chavez a résisté à la fois à la tentative de coup d’État et à la grève grâce au large soutien populaire dont il bénéficiait.
Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix en 2005, a fondé le groupe Sumate (« Unissons-nous »), qui a organisé un référendum révocatoire. Environ 70 % des électeurs inscrits se sont rendus aux urnes en 2004, et une large majorité (59 %) a voté pour le maintien de Chavez à la présidence. Mais ni Machado ni ses soutiens américains (dont les compagnies pétrolières) n’étaient rassurés.
De 2001 à nos jours, ils ont tenté de renverser le processus bolivarien, afin de rétablir de fait les compagnies pétrolières américaines au pouvoir. La question vénézuélienne ne se résume donc pas à la « démocratie » (un terme galvaudé, vidé de son sens), mais à la lutte des classes internationale entre le droit du peuple vénézuélien à contrôler librement son pétrole et son gaz et celui des compagnies pétrolières américaines à dominer les ressources naturelles du Venezuela.
Le processus bolivarien
Lorsque Hugo Chávez fit son apparition sur la scène politique dans les années 1990, il captiva l’imagination de la plupart des Vénézuéliens, notamment de la classe ouvrière et des paysans. Cette décennie fut marquée par les trahisons retentissantes de présidents qui avaient promis de protéger ce pays riche en pétrole des mesures d’austérité imposées par le FMI, avant d’adopter ces mêmes propositions.
Peu importait qu’ils soient sociaux-démocrates (comme Carlos Andres Perez d’Action démocratique, président de 1989 à 1993) ou conservateurs (comme Rafael Caldera des Démocrates-chrétiens, président de 1994 à 1999).
L’hypocrisie et la trahison caractérisaient le monde politique, tandis que de profondes inégalités (avec un indice de Gini vertigineux de 48,0) gangrenaient la société. Le mandat de Chavez (qui remporta l’élection avec 56 % des voix contre 39 % pour le candidat des partis traditionnels) était un rejet de cette hypocrisie et de cette trahison.
Le maintien de prix élevés du pétrole de 1999 (date de son entrée en fonction) à 2013 (année de sa mort prématurée à 58 ans) a été un atout pour Chávez et le processus bolivarien. S’étant approprié les revenus pétroliers, il les a réinvestis dans des actions sociales d’une ampleur considérable.
Tout d’abord, il a développé un ensemble de programmes sociaux de masse (misiones) qui ont réorienté les revenus pétroliers pour répondre aux besoins humains fondamentaux tels que les soins de santé primaires (Mision Barrio Adentro), l’alphabétisation et l’enseignement secondaire pour la classe ouvrière et la paysannerie (Mision Robinson, Mision Ribas et Mision Sucre), la souveraineté alimentaire (Mision Mercal puis PDVAL) et le logement (Gran Mision Vivienda).
L’État a été repensé comme un vecteur de justice sociale et non comme un instrument d’exclusion des classes ouvrières et paysannes des fruits du marché. À mesure que ces réformes progressaient, le gouvernement s’est efforcé de construire le pouvoir populaire par le biais d’instruments participatifs tels que les communes (comunas).
Ces communes sont apparues d’abord à partir d’assemblées consultatives populaires (consejos comunales) puis se sont développées en organes populaires pour contrôler les fonds publics, planifier le développement local, créer des banques communautaires et former des entreprises coopératives locales (empresas de produccion social).
Les communes représentent l’une des contributions les plus ambitieuses du processus bolivarien : un effort – inégal mais historiquement significatif – pour construire le pouvoir populaire comme une alternative durable au pouvoir oligarchique.
La guerre hybride imposée par les États-Unis au Venezuela
Deux événements survenus en 2013-2014 ont profondément menacé le processus bolivarien : d’abord, la mort prématurée d’Hugo Chavez, sans aucun doute le moteur de l’énergie révolutionnaire, et ensuite, l’effondrement lent puis constant des revenus pétroliers.
Chavez a été remplacé à la présidence par l’ancien ministre des Affaires étrangères et syndicaliste Nicolas Maduro, qui a tenté de redresser la situation, mais s’est heurté à un défi de taille : la chute brutale des prix du pétrole. Après avoir culminé à environ 108 dollars le baril en juin 2014, ces prix ont dégringolé en 2015 (sous la barre des 50 dollars), puis en janvier 2016 (sous la barre des 30 dollars). Pour le Venezuela, fortement dépendant des importations de pétrole brut, cette baisse a été catastrophique.
Le processus bolivarien n’a pas pu réviser la redistribution dépendante du pétrole (non seulement à l’intérieur du pays mais aussi dans la région, y compris par le biais de PetroCaribe) ; il est resté prisonnier de sa dépendance aux exportations de pétrole et donc des contradictions inhérentes à son statut d’État rentier.
De même, le processus bolivarien n’avait pas exproprié les richesses des classes dominantes, qui continuaient de peser lourdement sur l’économie et la société, empêchant ainsi une transition à grande échelle vers un projet socialiste.
Avant 2013, les États-Unis, leurs alliés européens et les forces oligarchiques d’Amérique latine avaient déjà préparé le terrain pour une guerre hybride contre le Venezuela. Après la première élection de Chavez en décembre 1998 et avant son entrée en fonction l’année suivante, le Venezuela a connu une fuite des capitaux accélérée, l’oligarchie vénézuélienne transférant sa fortune à Miami.
Durant la tentative de coup d’État et le blocus pétrolier, les fuites de capitaux se sont multipliées, fragilisant la stabilité monétaire du Venezuela. Le gouvernement américain a alors entrepris une stratégie diplomatique pour isoler le pays, présentant le gouvernement comme un problème et s’efforçant de constituer une coalition internationale contre le Venezuela.
Cela a conduit, dès 2006, à des restrictions d’accès aux marchés financiers internationaux pour le Venezuela. Les agences de notation, les banques d’investissement et les institutions multilatérales ont progressivement relevé les coûts d’emprunt, rendant le refinancement plus difficile bien avant que les États-Unis n’imposent des sanctions officielles au Venezuela.
Après la mort de Chavez et la baisse des prix du pétrole, les États-Unis ont lancé une guerre hybride ciblée contre le Venezuela. La guerre hybride désigne l’utilisation coordonnée de la coercition économique, de l’étranglement financier, de la guerre de l’information, de la manipulation juridique, de l’isolement diplomatique et de la violence sélective, déployée pour déstabiliser et faire échouer des projets politiques souverains sans avoir recours à une invasion à grande échelle.
Son objectif n’est pas la conquête territoriale, mais la soumission politique : la mise au pas des États qui tentent de redistribuer leurs territoires, de nationaliser leurs frontières ou de mener une politique étrangère indépendante. La guerre hybride opère par l’instrumentalisation de la vie quotidienne.
Les attaques monétaires, les sanctions, les pénuries, la manipulation médiatique, les pressions des ONG, le harcèlement judiciaire (instrumentalisation du droit) et les crises de légitimité orchestrées visent à affaiblir l’État, à épuiser le soutien populaire et à briser la cohésion sociale. Les souffrances qui en résultent sont ensuite présentées comme la preuve d’une défaillance interne, masquant ainsi l’architecture externe de la coercition.
C’est précisément ce à quoi le Venezuela a été confronté depuis que les États-Unis lui ont imposé illégalement des sanctions financières en août 2017, les ont alourdies de sanctions secondaires en 2018, ont perturbé tous les systèmes de paiement et les circuits commerciaux et ont contraint le pays à une conformité excessive avec la réglementation américaine. Les médias occidentaux ont systématiquement minimisé l’impact des sanctions, tout en présentant l’inflation, les pénuries et les migrations comme des phénomènes purement internes, renforçant ainsi le discours sur un changement de régime. L’effondrement du niveau de vie au Venezuela entre 2014 et 2017 est indissociable de cette stratégie d’asphyxie économique à plusieurs niveaux.
Attaques de mercenaires, sabotage du réseau électrique, création d’un conflit orchestré au profit d’ExxonMobil entre le Guyana et le Venezuela, invention d’un président paria (Juan Guaido), attribution du prix Nobel de la paix à une personne appelant à la guerre contre son propre pays (Machado), tentative d’assassinat du président, bombardements de bateaux de pêche au large des côtes vénézuéliennes, saisie de pétroliers quittant le Venezuela, constitution d’une armada au large des côtes du pays : chacun de ces éléments vise à créer une tension neurologique au sein du Venezuela, conduisant à l’abandon du processus bolivarien au profit d’un retour à 1998, puis à l’annulation de toute loi sur les hydrocarbures garantissant la souveraineté du pays.
Si le pays revenait à la situation de 1998, comme le promet Maria Corina Machado, tous les acquis démocratiques obtenus grâce aux missions et aux communes, ainsi que grâce à la Constitution de 1999, seraient anéantis. Machado a même déclaré qu’un bombardement américain de ses compatriotes vénézuéliens serait « un acte d’amour ». Le slogan de ceux qui veulent renverser le gouvernement est « Retour au passé ».
En octobre 2025, Maduro s’adressait à un auditoire à Caracas en anglais : « Écoutez-moi, non à la guerre, oui à la paix, peuple des États-Unis ! » Le soir même, lors d’une allocution radiophonique, il lançait un avertissement : « Non aux changements de régime, qui nous rappellent tant les guerres interminables et vouées à l’échec en Afghanistan, en Irak, en Libye, etc. Non aux coups d’État orchestrés par la CIA ! » Le slogan « Non à la guerre, oui à la paix » fut repris sur les réseaux sociaux et intégré à des chansons. Maduro est apparu à plusieurs reprises lors de rassemblements et de réunions, musique à fond, chantant « Non à la guerre, oui à la paix », et – au moins une fois – portant un chapeau arborant ce message.
L’auteur : Historien, éditeur et journaliste indien Vijay Prashad est le directeur du Tricontinental Institute for Social Research.