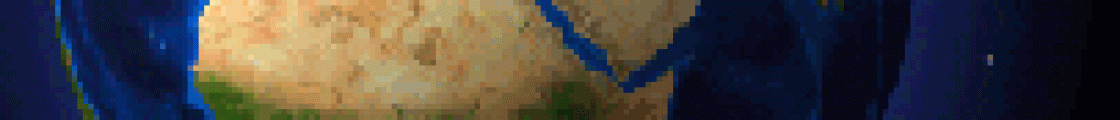Au début de la présente législature, lorsque le bureau de la commission des affaires étrangères définit le programme de travail de cette dernière, le choix d’une mission d’information consacrée à l’Algérie s’imposa tout naturellement.
Étonnamment, rares avaient été jusqu’alors les travaux de la commission consacrés à ce pays. Certes, il y avait eu des auditions de ministres ou de diplomates. Certes, il y avait eu l’examen de projets de loi autorisant la ratification de conventions. Certes il y avait eu des déplacements de délégations(2). Mais jamais la commission n’avait créé de mission chargée, sur le long terme, de se pencher sur l’Algérie.
À cet égard, 2012 constituait l’année idéale pour lancer une telle mission. C’était, bien évidemment, l’année du cinquantenaire de l’indépendance algérienne avec tout ce que cela pouvait impliquer des deux côtés de la Méditerranée. C’était aussi une année d’alternance politique en France qui avait très suivie en Algérie et qui devait se conclure par une visite d’État réussie du président Hollande, juste avant Noël. Sur le plan intérieur, l’Algérie, qui venait de réélire la chambre basse de son parlement, était à un peu moins de deux ans d’un scrutin capital et sa relative stabilité tranchait nettement avec les ressacs affectant ses voisins, dans le sillage des révolutions arabes.
L’année 2013 confirma l’intérêt de la mission. Dans les premiers jours de janvier, l’intervention française au Mali fit entrer la relation bilatérale dans une dimension nouvelle lorsque l’Algérie autorisa le survol de son territoire par nos appareils. Le 17 du même mois, le pays fut confronté à une attaque terroriste sans précédent contre un de ses centres gaziers. A cette occasion, il démontra au monde entier sa détermination à combattre ce fléau. Au cours des mois suivants, la vie politique algérienne connut divers soubresauts qui éclairèrent d’un jour nouveau les échéances électorales à venir.
Assurément, tout au long de ses huit mois de travaux, entre décembre 2012 et juillet 2013, la mission d’information se passionna pour l’Algérie. Elle procéda à de nombreuses auditions, elle tint plusieurs réunions de travail et cinq de ses membres se rendirent à Alger, du 24 au 27 mars. Ils purent y approfondir leurs analyses à l’occasion d’échanges et de rencontres avec des personnalités issues tant des mondes politique, économique, diplomatique qu’associatif.
Très vite, la mission a choisi d’organiser sa réflexion autour de deux axes.
Tout d’abord, il lui est apparu indispensable de faire le point sur la relation bilatérale. Il n’était pas question de refaire l’histoire ou de s’immiscer dans les polémiques surgies ces dernières années. La mission a tout simplement voulu dresser un état des lieux sincère du lien franco-algérien. Elle a alors pu se rendre compte du degré d’imbrication des destins des deux pays, un véritable espace commun s’étant progressivement construit, avec le temps. La mission a bien évidemment constaté le caractère parfois compliqué et chaotique de cette relation qui n’enlève cependant rien à l’obligation qu’ont désormais les deux États de coopérer sereinement et efficacement. À cet égard, la mission a souhaité mettre en valeur certains domaines qui lui tenaient à cœur, en particulier la dimension humaine de la relation et l’importance à accorder à la jeunesse.
Parallèlement à ce travail axé sur la relation bilatérale, la mission d’information s’est également penchée sur la situation intérieure de l’Algérie. Elle a d’abord voulu répondre à une question inévitable : pourquoi ce pays n’a-t-il pas connu le même sort que d’autres États de la région ? Pourquoi le « Printemps arabe » de 2011 ne l’a-t-il pas atteint de la même manière que ses voisins tunisiens, libyens, égyptiens voire marocains ? Essayer de répondre à cette question a tout naturellement conduit la mission à aborder plus en détails certains pans et aspects de la vie politique algérienne, de son organisation économique et sociale ou bien de ses positions diplomatiques. Au-delà, elle a aussi voulu souligner l’importance de l’année 2014 pour l’Algérie, année au cours de laquelle elle devrait avoir à se prononcer sur son avenir. Une question qui, comme l’a montré la densité des liens noués avec la France, ne saurait nous laisser indifférents.
I. LA FRANCE ET L’ALGÉRIE VERS UNE RELATION APAISÉE ?
A. LA FRANCE ET L’ALGÉRIE, DES DESTINS ENTREMÊLÉS
1. Une relation unique
La France a été présente en tout et pour tout 132 ans en Algérie, soit l’équivalent de cinq ou six générations. Cette longue présence française au cœur du Maghreb, conclue par une violente guerre d’indépendance, a généré un phénomène d’assimilation et d’hybridation culturelle qui n’a existé nulle part ailleurs, pas même en Tunisie ou au Maroc, rendant les rapports entre la France et l’Algérie à la fois complexes et uniques.
a. L’Algérie, un statut particulier dans l’empire colonial français
À la suite de la capitulation du dey d’Alger le 5 juillet 1830 et l’occupation militaire de l’Algérie, cette dernière fut progressivement rattachée puis intégrée à la France. L’Algérie fut dans un premier temps officiellement annexée par une ordonnance royale en date du 24 février 1834, faisant des Algériens des sujets – mais non pas des citoyens – français. Une ordonnance royale de 1845 divisa le territoire algérien en trois provinces – Alger, Oran et Constantine – comprenant chacune trois types de circonscriptions : territoire civil, territoire mixte et territoire militaire(3). L’ « appartenance » de l’Algérie au territoire national fut ensuite consacrée par la constitution républicaine de 1848(4), laquelle accorda à l’Algérie une représentation politique à l’Assemblée nationale. Dans la foulée, les territoires civils des trois provinces furent transformés en départements.
De 1852 à 1858, Napoléon III rétablit un régime militaire sur l’ensemble du territoire, supprima la représentation algérienne au Parlement, mais maintînt les trois départements d’Oran, d’Alger et de Constantine. Le régime civil fut rétabli à la suite de la défaite du Second Empire. L’année 1881 marqua l’assimilation totale du territoire algérien à la France sur le plan institutionnel. L’Algérie fut considérée comme faisant partie intégrante du territoire métropolitain et fut rattachée administrativement aux ministères métropolitains. Elle se vit conférer par les lois de 1898 et du 29 décembre 1900 une personnalité civile et fut dotée d’une assemblée coloniale élue, de délégations financières et d’un budget spécial(5).
Au-delà de l’assimilation territoriale et administrative, la France, pour conserver les vastes territoires progressivement acquis et s’y enraciner, vit dans la « colonisation », c’est à dire le remplacement des soldats par des colons, la meilleure façon de pérenniser la conquête(6). À partir de 1848 et, surtout, de 1850 une véritable politique de colonisation fut alors entreprise(7) couplée à de massives concessions gratuites de terres dans l’espoir de réaliser un peuplement rural français. Ainsi, entre 1871 et 1919, 870.000 hectares furent livrés aux colons. Les habitants musulmans perdirent quant à eux 7 millions et demi d’hectares sur cette même période. Près de 130.000 colons dont 65.000 Français (8) s’installèrent en Algérie entre 1871 et 1881. La population française en Algérie passa ensuite de 219.000 habitants en 1886 à 318.000 (dont 50.000 naturalisés) en 1896, puis 657.000 en 1926. Dès 1896, l’Algérie compta plus d’Européens nés sur son sol que d’Européens immigrés et ce taux ne cessa d’augmenter jusqu’à atteindre 79 % en 1954.
Entre 1870 et 1940, la politique d’assimilation s’appliqua pleinement aux Juifs algériens (décret Crémieux du 24 octobre 1870) et aux étrangers européens (loi du 26 juin 1889(9)) dont la naturalisation permit d’enrichir la population française d’Algérie de dizaines de milliers de nouveaux citoyens. Elle laissa en revanche à l’écart les musulmans algériens, que l’on appelait également les « sujets français musulmans non-naturalisés » ou les « Français musulmans de souche nord-africaine ». Ces derniers restèrent, dans leur très grande majorité, privés des droits et libertés démocratiques fondamentaux et soumis à de nombreuses dispositions répressives et discriminatoires. Il fallut attendre l’ordonnance du 7 mars 1944 pour que des droits politiques et civils soient accordés à des Algériens musulmans, à condition que ces derniers justifient de certains diplômes et titres. Ainsi, jamais les Algériens « indigènes » ne bénéficièrent, dans leur globalité, de l’égalité juridique et ne furent regardés comme des Français à part entière sauf, bien entendu, et avec force arguties, lorsque cela pouvait être dans l’intérêt de la puissance coloniale. Ainsi, « quand un Algérien se disait arabe, les juristes français lui répondaient : non, tu es français. Quand il réclamait les droits des Français, les mêmes juristes lui répondaient : non, tu es arabe ! » (10). Ce confinement des Algériens dans un statut juridique spécifique et inférieur ne fut pas étranger au caractère violent et dramatique de la fin de la présence coloniale française en Algérie.
b. La décolonisation violente de l’Algérie (1954-1962)
Contrairement à ses voisins tunisien et marocain qui acquirent leur indépendance dès 1956, l’Algérie n’accéda à la souveraineté qu’en 1962 après un conflit douloureux, – la « guerre d’Algérie » au nord de la Méditerranée, la guerre d’indépendance au sud – qui dura huit ans et eut des conséquences dramatiques dont le souvenir reste encore très présent aujourd’hui.
Les attentats de la « Toussaint sanglante », dans la nuit du 1er novembre 1954, marquèrent le début du soulèvement mené par le Front de libération nationale (FLN) contre la présence française en Algérie.
Si le conflit conduisit à l’implication totale de l’armée française dans des opérations décrites à l’époque comme relevant du « maintien de l’ordre », il eut également un impact politique et social majeur. La survie des institutions républicaines fut à plusieurs reprises menacée et celles-ci ne durent leur sauvegarde qu’à une profonde révision constitutionnelle qui modifia la nature du régime et provoqua, par conséquent, la fin de la IVème République, en 1958.
La guerre d’Algérie fut aussi singulière en ce qu’elle n’opposa pas seulement les Algériens d’une part et la population française d’Algérie et de métropole d’autre part, mais divisa les partis, les syndicats, les intellectuels et les familles tant en France que sur le sol algérien. Après plus d’un siècle de présence française, les liens entre les deux pays étaient plus denses qu’entre n’importe quelle autre colonie et sa métropole.
Le bilan définitif de la guerre d’Algérie n’a jamais été établi avec certitude et donne lieu à de profondes divergences de part et d’autre de la Méditerranée. Les travaux des historiens spécialistes de la question permettent d’estimer qu’« au-delà des considérations économiques et du coût qu’elle a représenté pour une économie qui achevait sa reconstruction et poursuivait sa modernisation, la guerre d’Algérie a fait environ 25.000 morts et 65.000 blessés dans les rangs de l’armée française, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de morts parmi les harkis. Dans le camp adverse, près de 150.000 membres du FLN et soldats de l’ALN ont été tués. Prise à partie par les deux belligérants, la population civile fut la première victime du conflit : bien qu’un chiffre exact soit difficile à fixer, les estimations les plus vraisemblables sont de 300.000 à 400.000 victimes algériennes et plusieurs milliers de civils français »(11). Quoi qu’il en soit, ce bilan fut, proportionnellement à la population totale du pays, plus meurtrier que la première guerre mondiale pour la France.
Outre les morts, la guerre d’Algérie s’est accompagnée d’un impressionnant cortège d’atrocités, tant du côté de combattants du FLN que de certains éléments des troupes françaises qui ont eu recours à la torture contre des militants nationalistes et leurs soutiens. De même, « le cœur de Paris fut le théâtre de manifestations réprimées dans le sang. Le 17 octobre 1961, 11.000 Algériens [furent] arrêtés par la police et plus d’une centaine tués, pour certains jetés dans la Seine. Le 8 février 1962, au métro Charonne, neuf manifestants [moururent] sous les coups des policiers »(12).
Les accords d’Évian, en mars 1962, qui conduisirent à la fin du conflit, constituèrent une étape importante dans l’histoire des deux pays sans pour autant marquer la fin des violences. Pour l’Algérie, l’année 1962 reste l’année de l’indépendance. Pour la France en revanche, elle est davantage associée aux exactions telles que la fusillade de la rue d’Isly qui, le 26 mars, fit plus d’une soixantaine de victimes civiles mais aussi aux massacres d’Oran du 5 juillet qui virent plusieurs centaines d’Européens assassinés, blessés ou enlevés. 1962, c’est aussi l’exode massif des pieds noirs vers la métropole et les représailles dont ont été victimes les harkis. Des centaines de milliers d’Européens partirent d’Algérie en l’espace de quelques mois : 68.000 entre janvier et avril, 83.000 en mai, 328.000 en juin, 61.000 en juillet et 40.000 en août(13). Au total, ce ne sont ainsi pas moins de 800.000 Européens qui ont fui l’Algérie cette année-là, emmenant avec eux, en France, les souvenirs de toute une vie mais aussi la mémoire d’une aventure unique dans l’histoire de France.
2. La constitution d’un espace commun de part et d’autre de la Méditerranée
a. Un lien démographique dense et dynamique
Comme votre rapporteur vient de le rappeler brièvement, en 132 ans d’histoire commune, l’Algérie et la France ont tissé un lien humain très dense qui s’est très tôt traduit par un flux significatif de population entre les deux rives de la Méditerranée mais n’a pas été rompu par l’indépendance, en 1962.
Si, comme on l’a vu, l’Algérie accueillit très tôt un nombre important de Français et de populations en provenance de plusieurs pays européens alentours, l’immigration algérienne en France est, elle aussi, ancienne : elle débuta très tôt dès la fin du XIXème siècle, principalement en provenance de Kabylie, une région particulièrement pauvre à l’époque(14). Ainsi, d’abord économique, notamment pour fournir une main d’œuvre aux mines du nord de la France puis, après-guerre, aux usines automobiles, l’immigration algérienne en France se poursuivit dans les années 70 et après, y compris à la suite de l’arrêt de l’immigration de travail, par l’intermédiaire de mesures de regroupement familial puis, lors de la décennie noire, par l’arrivée, sur notre sol, de cadres et d’intellectuels menacés dans leur pays.
Ces flux ont une aujourd’hui une réalité statistique concrète.
En ce qui concerne nos compatriotes, 30.000 Français étaient inscrits dans nos consulats en Algérie à la fin 2012, les doubles nationaux français et algériens constituant presque 90% de la communauté française et le reste étant constitué essentiellement de détachés (d’entreprises ou d’administrations) ainsi que par quelques centaines de Français qui résident en Algérie depuis longue date, soit qu’ils y sont nés (« pieds noirs »), soit qu’ils soient venus par solidarité en l’Algérie juste après l’indépendance (les « pieds rouges »)(15). Ces chiffres ne reflètent toutefois qu’une partie de la réalité car si tous les ressortissants exclusivement français se font enregistrer dans les consulats (c’est une exigence des autorités algériennes pour l’obtention d’une carte de séjour), en revanche, une partie seulement des doubles-nationaux est connue des consulats puisque beaucoup d’entre eux vivent à cheval sur les deux rives de la Méditerranée et conservent une adresse en France. L’enregistrement consulaire ne leur apporte alors aucun avantage spécifique d’autant plus que les autorités algériennes n’autorisent pas l’exercice de la protection consulaire à leur égard, sur le territoire algérien.
En ce qui concerne la communauté algérienne en France les chiffres sont bien plus imposants. Les statistiques officielles indiquent que les ressortissants algériens titulaires d’un titre ou d’une autorisation de séjour en France au 31 décembre 2011 sont environ 560.000 personnes(16). A ce nombre, on doit bien évidemment ajouter les personnes présentes sur notre territoire mais en situation irrégulière – dont, par définition, il est difficile d’estimer la taille – ainsi que les binationaux qui, selon les sources, seraient entre 2,5 et 4 millions(17).
Au total, si on additionne Français d’Algérie et Algériens de France double nationaux, Français d’origine algérienne et, notamment les « pieds noirs », la dimension humaine de la relation franco-algérienne, c’est-à-dire une population « commune », repose sur une base supérieure 5 millions de personnes. Ce chiffre est impressionnant. Les ressortissants algériens sont aujourd’hui la deuxième communauté étrangère présente en France, derrière les Portugais. Notre pays est, de loin celui qui accueille le plus d’Algériens après l’Algérie elle-même, très loin devant les autres États européens ou nord-américains (18)
Cette population « franco-algérienne », considérée dans un sens très « large », n’est bien évidemment pas immobile. Le lien entre les deux rives de la Méditerranée, au quotidien, c’est d’abord des flux humains significatifs.
La France est la première destination des ressortissants algériens tant à des fins touristiques que d’émigration. Notre réseau consulaire en Algérie a délivré 180.000 visas de court séjour et 20.000 visas de long séjour ont été délivrés à des Algériens en 2012, ce dernier chiffre incluant notamment le regroupement familial et les visas pour suivre des études(19) (le service des visas d’Alger est ainsi le deuxième de notre réseau mondial après Moscou).
L’Algérie reçoit aussi un nombre significatif de citoyens français chaque année. C’est essentiellement un flux de Français possédant également la nationalité algérienne, lesquels se rendent en Algérie avec leur passeport algérien pour effectuer une visite familiale. Plus résiduel est le nombre d’hommes d’affaires appelés à se rendre régulièrement en Algérie dans le cadre de leur activité professionnelle.
Ainsi, malgré les barrières et difficultés politiques administratives, les hommes et les femmes n’ont cessé de circuler entre la France et l’Algérie. Il résulte de l’ensemble de ces liens qui ont pu se tisser qu’un véritable espace commun s’est constitué au fil du temps entre les deux rives de Méditerranée. In fine, la France et l’Algérie sont bien plus proches qu’on pourrait en attendre de deux États indépendants, éloignés l’un de l’autre par un millier de kilomètres. Les relations familiales entretenues régulièrement au téléphone, sur les réseaux sociaux ou lors des « retours au bled » estivaux (20) mais aussi les chaînes télévisées algériennes captées en France et françaises reçues en Algérie, peut-être encore plus que la presse et la littérature, contribuent à entretenir une véritable proximité humaine franco-algérienne qui double les canaux officiels de la diplomatie. Cela ne va pas, bien sûr, sans soulever des questions d’identité et d’intégration, un thème qui n’est pas le sujet de la mission d’information et qui pourrait justifier, à lui seul, un travail spécifique. Cela conduit en tout cas à des situations parfois surprenantes où il apparaît que bon nombre d’Algériens connaissent mieux notre vie politique ou notre paysage audiovisuel bien mieux que certains Français. Lors de son déplacement à Alger, la mission d’information a pu s’en rendre compte par elle-même et a été marquée par les propos tenus par des interlocuteurs, lesquels maîtrisaient parfaitement les subtilités de notre jeu politique. Il est d’ailleurs significatif que les élections françaises semblent passionner bien plus les Algériens que leurs propres scrutins. Votre rapporteur va avoir l’occasion, ultérieurement, de revenir sur ce paradoxe.
En tout état de cause, cet espace commun de part et d’autre de la Méditerranée possède un moteur qui le cimente. Ce moteur, indiscutablement, est la langue française qui joue un grand rôle dans la relation franco-algérienne.
b. La langue française, un pont entre les deux rives
La langue française n’a pas d’existence officielle en Algérie. Aux termes des articles 3 et 3 bis de la constitution, « l’arabe est la langue nationale et officielle » et le « tamazigh est également langue nationale ». On peut aisément comprendre que compte tenu du poids de l’histoire (21) et des réactions contre notre pays au sortir de la période coloniale, les autorités algériennes aient entendu réduire rapidement l’influence de la langue française au profit de la langue arabe, jugée, avec l’islam, comme l’un des deux piliers du nouvel État (22). Un processus d’arabisation du pays fut alors entrepris après l’indépendance, et ce, en dépit d’une administration formée par la France et se montrant une force de résistance non négligeable contre ce processus. Il est d’ailleurs intéressant de relever que l’article 76 de la première constitution du pays, tout en rappelant que « la réalisation effective de l’arabisation [devait] avoir lieu dans les meilleurs délais sur le territoire de la République », admettait, à titre dérogatoire, que « la langue française [puisse] être utilisée provisoirement avec la langue arabe ». Une trentaine de lois ou décret ayant trait à l’arabisation furent donc adoptés dans les années qui suivirent l’indépendance. Ces textes concernèrent l’ensemble des secteurs de la vie publique et administrative mais le domaine économique, par exemple en imposant l’arabe comme langue de l’affichage. Mais c’est surtout dans le domaine de l’enseignement que des mesures importantes furent prises afin d’arabiser progressivement l’ensemble du cursus scolaire. Or, dépourvue d’enseignants d’arabe « classique », l’Algérie dut en recruter dans d’autres pays arabes – en Égypte et en Iraq notamment – lesquels, bien souvent, envoyèrent des incompétents ou des extrémistes. Cela eut inévitablement des conséquences à long-terme sur la société algérienne car tout en nuisant à la qualité globale de l’éducation, cet afflux de maîtres moyen-orientaux médiocres eut aussi sa responsabilité dans la montée de l’islamisme dans les décennies qui suivirent.
Pour autant, en dépit de cette politique d’arabisation, la langue française continue d’être très présente, aujourd’hui, en Algérie. C’est en Algérie que se trouve la seconde communauté francophone au monde avec 16 millions de locuteurs environ (23) (sur 37 millions d’habitants au total) même si la qualité de la maîtrise de notre langue est quelque peu disparate selon les générations. De même, l’Algérie est le lieu d’un véritable foisonnement linguistique et il n’est pas rare – la mission a pu le constater par elle-même à Alger – que les Algériens utilisent plusieurs langues dans la même phrase, la commençant par exemple en français pour la terminer en arabe avec quelques mots de kabyle au milieu, ce qui explique peut-être que bon nombre d’Algériens – avec du dépit mais aussi de l’humour et de l’autodérision – n’hésitent pas à se qualifier d’ « analphabètes trilingues ». Quoiqu’il en soit, en dépit de cette situation, le français est aujourd’hui indispensable pour réussir en Algérie. C’est un sésame incontournable dans le milieu des affaires mais aussi pour obtenir un visa et, le cas échéant poursuivre des études à l’étranger. L’administration, elle aussi, ne fait pas exception et, en dépit de la politique d’arabisation constante depuis l’indépendance, certains secteurs de la fonction publique continuent d’accorder une place prépondérante au français comme, par exemple, la justice dont l’organisation reprend, dans les grandes lignes, celles de la justice française. L’enseignement, lui-même, fait une place non négligeable à notre langue : certes, l’arabe est la langue d’enseignement obligatoire durant les neuf premières années mais le français est enseigné à partir de la troisième année, c’est aussi la langue d’enseignement pour les cours avancés de mathématiques et de sciences. La mission a d’ailleurs pu se rendre compte par elle-même de l’importance de la langue française mais aussi de l’attrait qu’elle exerce auprès de nombreux jeunes Algériens en ayant des conversations riches et passionnantes avec certains d’entre eux(24) mais aussi en visitant l’Institut français d’Alger, véritable havre de tranquillité et de savoir au cœur de la ville. Cet institut est une des antennes de notre réseau culturel en Algérie avec Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen, la réouverture de celle de Tizi-Ouzou, longtemps bloquée et suspendue à la résolution de certaines difficultés administratives, étant aujourd’hui impossible du fait du refus des autorités algériennes (25). Au cours des cinq dernières années, le nombre d’inscrits aux cours de langue française proposés par ces centres a explosé : de 4.500 durant l’année 2008/2009, ils sont aujourd’hui supérieurs 11.000 ! La demande pour notre langue est considérable. Beaucoup de jeunes éprouvent le besoin de se perfectionner au moment de leur entrée à l’université où ils seront confrontés à des cours qui seront uniquement donnés en français, langue qui, comme on l’a vu, est indispensable à la réussite professionnelle ou à l’émigration. Ainsi, l’unique lycée français d’Algérie – le lycée Alexandre Dumas – est-il assailli par les demandes d’inscription. Et il est quelque peu paradoxal de constater que les premiers demandeurs sont souvent de hautes personnalités du régime algérien.
Notre langue est donc encore bien présente en Algérie et est le principal vecteur du lien très fort qui unit, encore aujourd’hui, les destins algérien et français. Malgré tout, elle demeure un enjeu politique et continue d’être officiellement considérée avec prévention comme le montre le refus algérien d’adhérer à l’Organisation internationale de la francophonie ou même de n’y avoir que le statut d’observateur(26). Votre rapporteur, tout en comprenant que le poids de l’histoire puisse encore susciter des réticences, ne peut que constater que la participation de l’Algérie aux travaux de l’OIF enrichirait grandement la famille francophone mondiale. Au cours du déplacement de la mission à Alger, il a, à plusieurs reprises, souligné l’utilité d’un éventuel début de rapprochement au niveau parlementaire, par l’intermédiaire de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. Il espère que cet appel sera entendu et que des progrès pourront être effectués, dans ce domaine, dans les années à venir. Le Français, « butin de guerre » (27) a assurément un avenir prospère en Algérie.
B. UNE RELATION COMPLIQUÉE
1. Le poids de la mémoire
Plus de cinquante ans après l’indépendance, Français et Algériens peinent à se débarrasser des fantômes du passé et, encore aujourd’hui, l’histoire est une composante structurante de la relation bilatérale qui ne facilite pas toujours la coopération entre les deux pays.
a. Une Algérie encore très présente sur la scène politique française
Comme votre rapporteur l’a relevé, la population « algérienne » de France, considérée dans un sens large, c’est-à-dire l’ensemble des personnes ayant des affinités juridiques, familiales ou personnelles avec ce pays, représente plus de 5 millions de personne. Parmi elles, certains groupes, qui trouvent leurs racines dans l’Algérie d’avant 1962, entretiennent la mémoire de cette période, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’agenda politique français.
Parmi ces groupes, il y a bien entendu les « Pieds Noirs », c’est à dire les européens rapatriés d’Algérie, au moment de l’indépendance. Les chiffres précédemment cités par votre rapporteur sont éloquents. En quelque mois, la France métropolitaine dut accueillir, en 1962, dans la précipitation, « comme si un barrage s’était rompu »(28), près de 800.000 de ses citoyens. On a peine à imaginer, de nos jours, l’ampleur de cette migration forcée qui vit des familles entières quitter brusquement et définitivement la terre qui les avait vus naître pour un pays dont beaucoup n’avait jamais foulé le sol. D’autant plus que ce déracinement intervînt dans un contexte lourd, les Pieds Noirs estimant avoir été abandonnés par le pouvoir de l’époque. Ce sentiment trouva son paroxysme au moment des massacres d’Oran, le 5 juillet 1962, une violation flagrante des accords d’Évian face à laquelle la France, à l’époque, choisit de ne pas réagir. De surcroît, à ces souffrances morales et physiques s’ajouta la relative hostilité manifestée par nombre de Français de Métropole qui voyaient dans les Pieds Noirs de riches exploitants privilégiés (29) mais aussi les responsables du conflit meurtrier qui avait mobilisé des milliers d’appelés. Dans ce contexte global loin d’être anodin, il n’est pas anormal qu’en dépit du succès de l’intégration, par la suite, de ces citoyens originaires de la rive sud de la Méditerranée, le souvenir de la guerre d’Algérie soit demeuré vivace, en France, tout au long de ces cinquante dernières années.
Les harkis ont, eux-aussi, contribué à entretenir le souvenir de la guerre d’Algérie. Ce mot arabe, dérivé de « harka », qui signifie « expédition » ou « opération militaire », désigne les membres des forces supplétives françaises en Algérie, entre 1954 et 1962. À l’indépendance, en violation flagrante des accords d’Évian, beaucoup d’entre eux payèrent du prix de leur vie leur choix en faveur de l’ancienne puissance coloniale. Désarmés après le 19 mars 1962, ils furent livrés aux représailles du FLN et ne reçurent pas le soutien qu’ils étaient en droit d’attendre des autorités françaises, lesquelles, à l’époque, n’hésitèrent pas à interdire leur transfert sur notre sol. Si de nombreux officiers choisirent de désobéir à ces ordres, plusieurs dizaines de milliers de harkis – environ 75.000 selon des estimations récentes – furent néanmoins massacrés dans le cadre d’une épuration ignoble. Ceux qui ont pu gagner la France ont généralement été accueillis dans des conditions très précaires et furent longtemps installés dans des « hameaux de forestage » ou des « cités urbaines », le dernier camp fermant ses portes au milieu des années 90. Au total, 15. 000 à 20.000 familles de harkis – soit environ 90.000 personnes – se sont installées en France, entre 1962 à 1968.
Depuis 1962, un autre groupe de la population entretient la mémoire de la guerre d’Algérie : les anciens combattants, qu’ils soient militaires de carrière ou appelés du contingent. Comme le Parlement l’a reconnu en 1999, l’intervention militaire sur le sol algérien ne fut pas une simple opération de police mais une vraie guerre. « De la bataille d’Alger, au premier semestre 1957, durant laquelle les parachutistes ont traqué le FLN dans la ville, aux opérations d’envergure (plan Challe) et à la sécurisation des frontières de l’Algérie pour lutter contre les infiltrations (lignes Morice et Challe), la lutte contre le FLN a pu mobiliser jusqu’à 500.000 soldats sur le terrain. Au total, du fait du recours aux appelés du contingent ainsi qu’aux rappelés, près de deux millions de soldats ont servi en Algérie, soit la quasi-totalité d’une génération »(30). La retraite du combattant versée au titre de la guerre d’Algérie est aujourd’hui versée à près d’un million d’individus(31) . Ces chiffres sont éloquents et contribuent, eux aussi, à expliquer l’impact durable de la guerre d’Algérie sur la conscience collective et politique française tout au long de ces cinquante dernières années.
Cet impact s’est tout d’abord traduit, au niveau institutionnel, par la création d’un secrétariat d’État aux rapatriés dès 1961. Ce portefeuille ministériel dont le premier titulaire fut Robert Boulin perdura jusque dans les années 80. Les questions liées aux rapatriés entrent de nos jours dans le champ de compétences du membre du gouvernement en charge des anciens combattants(32), assisté en cela par une mission interministérielle créé en 2002(33).
Par ailleurs, un système d’aides spécifiques fut mis en place, avant même l’indépendance, et continue de fonctionner aujourd’hui. Si le processus de réparation est loin d’avoir été parfait, il ne doit pas, non plus, être sous-estimé : au total, près de 40 milliards d’euros(34), en cumul, ont été dépensés depuis 1961. Il convient toutefois de relever que ce n’est qu’à partir de la loi du 16 juillet 1987 qu’un régime particulier d’indemnisation fut élaboré en faveur des anciens supplétifs qui s’étaient vu reconnaitre la qualité d’anciens combattants par une loi de décembre 1974(35).
Malheureusement, eu égard sans doute aux conditions dramatiques dans lesquelles est intervenue l’indépendance algérienne, cette présence de l’Algérie sur la scène politique française n’a jamais été consensuelle. Les lois « mémorielles » en sont, sans doute, l’exemple le plus frappant. Quatre concernant la guerre d’Algérie ont été adoptées au cours des deux dernières décennies. La guerre civile algérienne des années 90 n’a sans doute pas été étrangère à ce phénomène en réactivant les souvenirs et en réveillant, en France, toutes les mémoires qui avait été refoulées les décennies précédentes(36). Ces quatre textes, notamment les deux derniers, ont suscité des controverses que la mission d’information n’a pas abordées car tel n’était pas l’objet de ses travaux. Toutefois, votre rapporteur a estimé nécessaire d’en rappeler brièvement le contenu.
Le législateur a ainsi rendu hommage aux harkis avec la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie par laquelle « la République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis ».
Il a mis le droit au diapason de l’histoire et de la mémoire avec la loi du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », les textes évoquant jusqu’alors les « opérations effectuées en Afrique du Nord » ou les « opérations de maintien de l’ordre en Algérie ».
La loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a, elle, tenu à saluer la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie, « la Nation [exprimant] sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France » dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous souveraineté française et reconnaissant, par ailleurs « les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur [rendant], ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage ». En disposant que « les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite » et que « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit », l’article 4 de la loi du 23 février 2005 suscita une vive polémique qui conduisit à l’abrogation de l’alinéa litigieux par décret, le 15 février 2006, à la suite de la reconnaissance de son caractère réglementaire par le Conseil constitutionnel (37).
Plus récemment, la loi du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc provoqua aussi une controverse, la date retenue étant loin de faire l’unanimité. En effet, la guerre d’Algérie ne s’acheva pas le 19 mars 1962 (38) et pour certains, il n’était pas concevable de faire de cette date un moment de souvenir, en raison notamment des crimes et exactions commis dans les semaines et mois suivants. Un autre date, le 5 décembre avait été instituée par un décret du 26 septembre 2003 et avait été aussi reprise par l’article 2 de la loi du 23 février 2005 portant sur les rapatriés et déjà citée par votre rapporteur(39). Elle correspondait à la date de l’inauguration en 2002, par le Président de la République Jacques Chirac, du mémorial du Quai Branly et n’avait, dans la chronologie de la guerre d’Algérie, aucune valeur. Dès lors, aux yeux du législateur, « la date du 19 mars [s’est imposée] comme la seule à même d’assurer la poursuite du devoir de mémoire des générations nées après le conflit envers leurs aînés qui ont combattu et, pour 25.000 d’entre eux, ont péri en Algérie, envers ceux que la France a abandonnés et envers tous ceux dont la douleur n’a jamais disparu » (40).
Au cours des cinquante dernières années, l’agenda politique n’a donc jamais ignoré le passé algérien de la France même si cette mémoire a pu déchaîner les passions et, encore aujourd’hui, est loin de faire l’unanimité.
b. Des ressentiments persistants contre la France en Algérie
Si l’histoire tend à peser sur la relation que la France peut avoir avec l’Algérie, il en va également, en sens inverse, de la perception de notre pays par les Algériens. Il faut dire que la dénonciation des méfaits du colonialisme et la glorification des martyrs de la guerre de libération font partie, depuis 1962, du discours de légitimation du pouvoir algérien. Le sentiment national s’est construit, en Algérie, contre la France, laquelle encore aujourd’hui, malgré elle, est un ciment du nationalisme. L’hymne national algérien ne mentionne-t-il d’ailleurs pas expressément notre pays pour lui demander des comptes ? (41). La rhétorique officielle passe inévitablement par une dénonciation constante du système colonial et des exactions de la guerre d’indépendance même si ce discours, paradoxalement, ne s’adresse pas forcément à notre pays mais a surtout un usage intérieur. Ainsi, les propos anti-français font partie du jeu. Un certain nombre de partis, surtout les islamistes et les anciens moudjahidines, poussent en ce sens et le président Bouteflika lui-même a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de s’en prendre à notre pays, lequel, selon lui, a « tué l’identité algérienne » au cours de la période coloniale(42). Ce phénomène est d’ailleurs encouragé par le fait qu’ « on a accordé énormément de poids aux martyrs et aux moudjahidines qui sont l’un des soutiens essentiels du pouvoir » et bénéficient d’un « statut à la fois symbolique et matériel extrêmement privilégié dans l’Algérie indépendante »(43).
Dans la logique de cette dénonciation récurrente des méfaits de la France, l’appel à la repentance pour les crimes commis par notre pays tout au long de sa présence en Algérie, notamment entre 1954 et 1962, revient souvent du côté algérien, en particulier depuis 2005 et l’exacerbation des tensions autour de la mémoire provoquée par la loi du 23 février 2005. Le pouvoir mais aussi la presse et une bonne partie de l’opinion publique – en particulier la génération qui a connu la période coloniale – sont demandeurs d’excuses officielles de la part de la France. Cette exigence est fréquemment ravivée lors des visites officielles des chefs d’État français en Algérie comme ce fut le cas en 2003, en 2007 ou au mois de décembre 2012 ou bien en réaction ou en réponse aux événements contemporains en relation avec la guerre d’Algérie. Ce fut par exemple le cas, au mois de mars 2012, au moment de la célébration du cinquantenaire des accords d’Évian, au cours de laquelle l’absence de repentance des autorités françaises avait fait dire à Abdelaziz Belkadem, alors secrétaire général du FLN : « que le président français accepte ou refuse, viendra un jour où la France s’excusera »(44) .
La prégnance de l’histoire conduit également bon nombre d’Algériens, tant au sein du pouvoir que dans la presse, à craindre, en permanence, un double jeu de la part de la France. Ce sentiment trouve son origine dans le présupposé, encore largement répandu, que la France n’aurait jamais accepté l’idée d’une Algérie indépendante et, pour certains, n’aurait pas perdu espoir de continuer à exercer une influence discrète mais directe sur les affaires de ce pays. Ce sentiment est ancien – dès la signature des accords d’Évian, par exemple, le chef d’état-major général, Houari Boumediene, s’inquiéta que la position française ne soit une ruse pour que notre pays puisse demeurer durablement en Algérie(45) – et perdure encore de nos jours sous des formes variées. L’opération Serval, à cet égard, a constitué un exemple frappant puisque les objectifs réels de l’intervention militaire française ont été grandement mis en doute en Algérie. Une thèse selon laquelle la France aurait poussé les djihadistes à attaquer le sud du Mali afin de pouvoir intervenir dans le nord avec pour but, à plus long terme, de frapper un jour l’Algérie (46) a même circulé. C’est là un exemple, parmi bien d’autres, du poids que peuvent exercer, encore aujourd’hui, l’histoire et la mémoire sur certains comportements et réflexions de l’autre côté de la Méditerranée.
Indéniablement, la rhétorique anti-française, en Algérie, fait partie du jeu. « Paris est toujours l’épouvantail à agiter quand les choses vont mal et qu’un complot vrai ou faux est à désigner » (47) et accuser un opposant d’appartenir au « parti de la France » est une véritable insulte qui sous-tend une complicité avec l’ancienne puissance coloniale. Ce sont là des paramètres incontournables qu’il convient de prendre en compte lorsqu’on se penche sur les relations franco-algériennes depuis 1962.
2. Une relation inévitablement chaotique
Eu égard, notamment, au poids de l’histoire, il est aisément compréhensible que la relation franco-algérienne ait connu, y compris récemment, des soubresauts. « En cinquante ans, la France, ancienne puissance coloniale, et l’Algérie indépendante ont connu des relations en dents de scie, alternant crises et engouement, mais toujours décrites des deux côtés de la Méditerranée comme « passionnelles » »(48).
Étonnamment, la période qui a suivi l’indépendance de l’Algérie a correspondu à une phase particulièrement haute des relations bilatérales alors qu’on aurait pu croire que la proximité de la guerre n’ait durablement refroidi toute volonté de rapprochement. Dans les années 60, en dépit de la rhétorique officielle anti-française, furent ainsi mises en place plusieurs coopérations, en particulier dans les secteurs économiques, sociaux et éducatifs mais aussi – et cela est plus étonnant – militaire. Si la France ne conserva la base de Mers el Kebir que jusqu’en 1967 alors que les accords d’Évian prévoyaient qu’elle puisse en disposer pendant quinze ans, elle a bénéficié, dans la plus grande discrétion, et jusqu’en 1978, de l’usage de la base dite « B2 Namous », un site de 6000 km² dans le Sahara(49). Cette volonté de coopération dut beaucoup à la volonté de la France qui, sans doute soucieuse de mener une coopération postcoloniale exemplaire, « ferma les yeux » sur les violations flagrantes des accords d’Evian précédemment évoquées par votre rapporteur.
Au début des années 70, sous la présidence de Georges Pompidou, les relations franco-algériennes se détériorèrent, en particulier à la suite de la décision du président Houari Boumediene, prise en 1971, de nationaliser, les sites pétroliers de Hassi Messaoud et gazier de Hassi R’mel au détriment des groupes français Total et Elf. Résolument engagé dans un politique tiers-mondiste, le pouvoir algérien ne pouvait qu’assimiler la coopération menée jusqu’alors par la France à une nouvelle forme de colonialisme et il entendait contrôler pleinement un secteur stratégique de l’économie. Face à cette attitude mais aussi à la suite du choc pétrolier de 1973 et de la crise économique qui s’ensuivit, la France souhaita « normaliser » ses relations avec l’Algérie en ne lui accordant plus de traitement particulier. Il convenait désormais « d’orienter les relations franco-algériennes sur des bases nouvelles, en laissant chacun assumer ses propres souvenirs »(50). Le président Valéry Giscard d’Estaing, en 1975, fut ainsi le premier chef d’État français à se rendre en Algérie depuis l’indépendance et la fin de son septennat fut marquée par la signature d’accords bilatéraux dans plusieurs domaines (émigration, justice, sécurité sociale, situation des personnes…).
François Mitterrand entendit quant à lui renouer avec la politique de coopération traditionnelle avec l’Algérie et entretenir les meilleurs rapports possibles avec ce pays, tout comme avec les deux États du Maghreb. Un des objectifs de cette politique était d’encourager l’implantation de la démocratie dans ces pays sans pour autant les juger en public, mais en favorisant leur développement. Il s’agissait ainsi d’entretenir des rapports dépassionnés et les plus utiles possible. Avec l’Algérie, le président Mitterrand poursuivait plusieurs objectifs : en premier lieu, la réconciliation franco-algérienne devant aboutir à une nouvelle amitié ; en second lieu, la relance de la dynamique commerciale et finalement, sur le plan international, la mise en œuvre d’une coopération franco-algérienne exemplaire et symbolique des nouveaux rapports Nord-Sud. En mettant en œuvre ces objectifs, l’Algérie devait rester au premier rang, comparable à celui du temps de de Gaulle(51). François Mitterrand se rendit à Alger, en 1981 puis à nouveau en 1984, Il reçut le président algérien Chadli en 1983, la première visite d’un chef d’État algérien en France. Sur le plan commercial, la France accepta de signer avec l’Algérie, en 1982, un accord par lequel elle s’engageait à acheter le gaz algérien à un prix supérieur de 25% au cours mondial, présentant ce « cadeau » comme une forme nouvelle d’aide au développement.
La seconde moitié des années 80 vit toutefois une détérioration de la relation franco-algérienne, en particulier à partir de la répression des émeutes de 1988, en Algérie, où l’armée tira à balles réelles sur les manifestants(52) qui, pour certains, mit fin à des « années d’autisme » de la part de la France « qui ne pouvait que constater avec effarement que son modèle de développement allait dans le mur »(53). L’annulation des élections législatives de décembre 1992 et l’arrestation des leaders islamistes sur le point de remporter le scrutin accentua le refroidissement de la relation bilatérale, d’autant plus que cette période fut aussi marquée par un débat, en France, quant à l’attitude à avoir face à cette situation : une partie de la classe politique française, se voulant pragmatique et réaliste, voyait dans le coup d’État un moindre mal face à la menace islamiste, une autre partie, plus « idéaliste », n’admettait pas l’interruption du processus démocratique et l’atteinte portée à la démocratie. Par la suite, lorsqu’un déchainement inouï de violences déferla sur l’Algérie, un autre clivage apparut entre ceux pour qui il n’était pas inenvisageable d’assister à une victoire islamiste qu’il fallait, dès lors anticiper, et ceux pour qui seul n’était possible qu’un soutien – même discret – au régime algérien. « Quelles que soient les circonstances, les Algériens ressent[irent] durement ce tangage du pouvoir français tandis que la violence se radicalis[ait], que les islamistes occup[aient] des régions entières du pays et que les assassinats d’intellectuels, journalistes et hauts fonctionnaires se multipli[aient]. Chaque geste français [fut] surinterprété par un pouvoir algérien sur la défensive »(54). De surcroît, la crise violente qu’éprouva l’Algérie à partir de 1992 eut des répercussions sur la sécurité des ressortissants français, dont une quarantaine furent assassinés. La France fut contrainte de limiter ses relations avec ce pays en y réduisant au minimum sa présence. La prise d’otages de l’Airbus d’Air France en décembre 1994 et l’enlèvement et l’assassinat des sept moines de Tibérine au printemps 1996 contribuèrent à accentuer la réserve de la France.
Toutefois, la violence extrême dont firent preuve, au cours des années 90, les groupes islamistes, contribua à les décrédibiliser totalement aux yeux de l’opinion publique internationale mais aussi, française. Le gouvernement algérien réussit à reprendre le contrôle de la quasi-totalité du pays et apprécia l’engagement actif de la France – atteinte, à son tour, par les attentats en 1995 et 1997 – dans la lutte contre les réseaux terroristes. Au moment de l’élection du président Bouteflika, en avril 1999, un rapprochement au plus haut niveau franco-algérien semblait de nouveau possible même si, pendant un moment, les « préoccupations » exprimées par le gouvernement français sur les circonstances de l’élection présidentielle(55) furent une source de tension entre les deux capitales. Ainsi le chef de l’État algérien se rendit-il, en visite, à Paris, en juin 2000 et, à cette occasion, il fut reçut à l’Assemblée nationale et prononça, dans l’hémicycle, un discours – symboliquement fait en français – dans lequel il salua « les retrouvailles entre deux peuples libres, si proches au fond l’un de l’autre malgré, ou à cause des vicissitudes, qui pourraient parfois suggérer l’inverse » mais rappela aussi que « la colonisation [avait porté] l’aliénation de l’autochtone à ses limites extrêmes » (56). De son côté, lors de cette visite, le Président Chirac rappela le courage et la dignité du peuple algérien dans la lutte contre le terrorisme et manifesta sa confiance dans l’avenir de l’Algérie. Dans la foulée de ce réchauffement, 2003 fut proclamée « Année de l’Algérie en France » et, au mois de mars, Jacques Chirac y effectua une visite d’État qui se révéla être un grand succès. Au-delà de l’accueil excellent qui fut réservé au président de la République, une « déclaration » par laquelle les deux pays s’engageaient à établir un « partenariat d’exception » fut signée et l’élaboration d’un traité d’amitié – à l’image du traité de l’Élysée conclu avec l’Allemagne en 1963 – fut même envisagée.
La nette amélioration des relations entre les deux pays fut cependant vivement contrariée en 2005 à la suite de l’adoption, par le Parlement français, de la loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (57) dont l’article 4, précédemment évoqué par votre rapporteur, reconnaissait le « rôle positif » de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Malgré l’abrogation de la disposition contestée un an plus tard, la polémique fut extrêmement vive tant dans la presse que parmi les autorités officielles. Les parlementaires algériens y répondirent en proposant un texte pour « criminaliser » la colonisation française, initiative restant sans suite mais qui fit à nouveau surface en 2010.
A la suite de ce « coup de froid » en 2005, la relation bilatérale reprit progressivement et retrouva un niveau relativement satisfaisant en 2007. Le 21 janvier de cette année-là, un protocole-cadre prévoyant la création d’une « Grande Commission interparlementaire » fut signé par les présidents de l’Assemblée nationale et de l’Assemblée populaire nationale. Le 8 février, le maire de Paris, M. Bertrand Delanoë, inaugura une place à la mémoire des victimes de Charonne et, au mois d’octobre, la France restitua à l’Algérie le plan des mines posées pendant la guerre, plus de cinquante années auparavant(58). Au mois de décembre, le président Nicolas Sarkozy, élu au mois de mai précédent, effectua à son tour une visite d’État en Algérie au cours de laquelle il reconnut le caractère « profondément injuste d’un « système colonial » qui était « contraire aux trois mots fondateurs de notre République: liberté, égalité, fraternité »(59. Cette déclaration du Président français – qui suivait la reconnaissance, quelques années auparavant, par notre ambassadeur, des massacres de Sétif comme « tragédie inexcusable »(60) – fut bien accueillie par la presse et par l’opinion publique pour qui il y avait là « une avancée considérable qui tranch[ait] avec les positions antérieures de l’État français » (61). En revanche, elle provoqua des critiques tant au sud qu’au nord de la Méditerranée, de la part des anciens combattants algériens mais aussi des cercles, en France, adeptes de la « nostalgérie »(62).
Comme cela avait été le cas sous la présidence de Jacques Chirac, les progrès accomplis au début du mandat de Nicolas Sarkozy furent rapidement remis en cause dans la foulée de la visite d’État. Si, au mois d’avril 2008, l’ambassadeur de France, M. Bernard Bajolet, reconnût la « très lourde responsabilité des autorités françaises de l’époque » dans les massacres du 8 mai 1945, l’arrestation, par erreur, au mois d’août suivant, d’un diplomate algérien par la police française, à Marseille(63), freina considérablement la relation bilatérale. A ce motif de tension s’ajouta toute une série de griefs concernant, par exemple, la politique migratoire française ou, plus tard, l’intervention en Libye. Initialement prévue en 2009, la visite d’État, en France, du président Bouteflika ne cessa d’être ajournée et le nombre de visites ministérielles réciproques fut quelque peu réduit même si les liens ne furent jamais coupés entre la France et l’Algérie. Votre rapporteur en veut pour preuve la signature d’un accord de coopération en matière de défense, en juin 2008, lequel fut ratifié dès 2009 par la partie algérienne(64).
C’est donc dans ce contexte qu’intervînt l’alternance, en France, en mai 2012. L’élection de François Hollande fut accueillie plutôt favorablement tant par les autorités que par la population algérienne, lesquelles avaient été quelque peu crispées par les événements précédemment évoqués par votre rapporteur mais aussi par certains propos jugés, à tort ou à raison, islamophobe ou anti-immigrés, tenus lors de la campagne présidentielle française de 2012. Hasard du calendrier, cette élection eut lieu quelques semaines avant la célébration, par l’Algérie, du cinquantenaire de son indépendance. Or, cet événement a été abordé avec retenue des deux côtés de la Méditerranée(65) alors qu’on aurait pu s’attendre à des excès sur fond d’un passé qui, on l’a vu, est encore très prégnant(66). Comme son prédécesseur, le nouveau Président de la République se rendit rapidement en Algérie où il effectua une visite d’État – la première de son mandat et la troisième d’un président français en Algérie depuis dix ans – les 19 et 20 décembre 2012. Ce déplacement permit d’évoquer les questions liées à la mémoire, alors même que, quelques semaines auparavant, le Président François Hollande avait déclaré que « la République [reconnaissait] avec lucidité » la répression « sanglante » de la manifestation d’Algériens à Paris, le 17 octobre 1961. Devant les deux chambres du Parlement algérien réunies au Palais de la Nation, le chef de l’État marqua sa volonté de fonder l’amitié franco-algérienne « sur le socle de la vérité ». Il admit que « pendant 132 ans, l’Algérie [avait] été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom : c’est la colonisation ». Il reconnut « les souffrances que la colonisation [avait] infligées au peuple algérien », notamment « les massacres de Sétif, de Guelma, de Kherrata », lesquels « demeurent ancrés dans la conscience des Algériens, mais aussi des Français ». Le Président de la République visita également plusieurs lieux de mémoire à Alger, en particulier le cimetière Bologhine, à la fois chrétien et juif, pour saluer la mémoire de la communauté européenne d’Algérie. Il se rendit aussi place Maurice Audin, pour rendre hommage à cette personnalité française engagée en faveur de l’indépendance et décédée sous la torture, ainsi qu’au sanctuaire des martyrs, en l’honneur des combattants de l’indépendance algérienne. La visite d’État du Président de la République eut également pour thème la jeunesse – un thème cher à la mission d’information et sur lequel votre rapporteur va revenir – mais aussi l’économie. Le président François Hollande ouvrit une réunion consacrée aux relations économiques entre les deux pays et appela à une relance plus qualitative et partenariale de ces relations. Au final, plusieurs textes furent adoptés au cours de cette visite. Tout d’abord, la déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et l’Algérie, signée par les deux chefs d’État, laquelle a créé un Comité intergouvernemental de haut niveau présidé par les deux Premiers ministres(67). Ce texte a été complété par un communiqué conjoint des deux ministres des Affaires étrangères, lequel se réjouissait de la signature de nombreux autres documents et accords lors de la visite : le document cadre de partenariat renouvelant pour cinq ans un précédent adopté en 2007, un mémorandum de coopération financière, une déclaration conjointe pour un partenariat industriel et productif, une convention de partenariat et de coopération dans les domaines de l’agriculture, du développement rural et de l’agro-alimentaire ainsi qu’un arrangement administratif relatif à la coopération en matière de protection et de sécurité civiles. De même fut signé le procès-verbal d’échange des instruments de ratification et d’approbation de l’accord franco-algérien de coopération en matière de défense précédemment évoqué par votre rapporteur. Ce texte, signé en juin 2008, avait été ratifié par l’Algérie en mai 2009 mais fut soumis à l’Assemblée nationale et au Sénat en octobre et en novembre 2012 seulement(68).
3. Une relation en voie d’apaisement ?
La visite d’État des 19 et 20 décembre 2012 a été, comme les précédentes, un succès.
Au niveau institutionnel, par exemple, elle a permis d’apaiser certaines tensions apparues par le passé et a été suivie par une multitude de déplacements de membres du gouvernement, tant français qu’algériens. De même, dans le domaine parlementaire, la coopération franco-algérienne a connu une avancée significative avec la tenue de la première réunion, le 13 mars 2013, de la « Grande Commission interparlementaire » qui, comme votre rapporteur a déjà eu l’occasion de la préciser, avait été créée en janvier 2007 à l’initiative du Président Jean-Louis Debré et de son homologue algérien, M. Amar Saadani. Au plan diplomatique, elle a incontestablement contribué à ce que l’Algérie autorise le survol de son territoire au moment de l’opération Serval même si cela n’a pas empêché que subsistent des doutes, du côté algérien, quant aux finalités réelles de l’intervention militaire de notre pays.
Il reste maintenant à savoir si ce « réchauffement » va perdurer. La « malédiction » qui semble avoir frappé les visites d’État des Présidents Chirac, en 2003, et Sarkozy, en 2007, en provoquant, à chaque fois, des phases de crispation peu de temps après, va-t-elle également s’abattre sur la relation actuelle ? La réponse à cette question passera certainement dans la capacité qu’auront les différents acteurs, de part et d’autre de la Méditerranée, à affronter et à dépasser les enjeux liée à la mémoire et au poids de l’histoire.
En tout état de cause, il est certain qu’en dépit des progrès récents, la relation bilatérale franco-algérienne n’est pas pleinement et irréversiblement apaisée. Sa normalisation prendra du temps – sans doute une ou deux générations – car on ne peut pas facilement mettre un terme à plus de 130 ans de liens aussi complexes, qui relèvent tant de l’attirance que, parfois, de la répulsion et qui sont indéniablement uniques. Abdelaziz Bouteflika, lui-même, en 1974, avait su trouver la formule pour qualifier les relations entre la France et l’Algérie : elles « peuvent être bonnes ou mauvaises, en aucun cas elles ne peuvent être banales ».
Dans ces conditions, une approche progressive et pragmatique – un approche des « petits pas – est incontournable et la question d’un éventuel traité d’amitié ne se pose peut-être plus dans les mêmes termes qu’il y a quelques années. Votre rapporteur a rappelé qu’un tel texte avait été envisagé au début des années 2000 mais avait dû être « enterré » rapidement sous l’effet des polémiques et tensions apparues par la suite. La signature d’un traité semblable, de par le symbole, à celui de l’Élysée de 1963 viendra certainement plus tard, d’ici quelques années, lorsque le renouvellement des générations permettra de l’envisager sereinement, sans polémiques inutiles de part et d’autre de la Méditerranée. Dans l’immédiat, il est certainement préférable de poursuivre et d’approfondir le partenariat actuellement en cours avec l’Algérie tout en n’omettant pas de favoriser l’émergence d’une mémoire apaisée entre les deux pays. Ainsi, l’année 2014, année du 70ème anniversaire de la période 1944-1945 et du centenaire de la Grande Guerre, pourrait être l’occasion de rappeler l’exceptionnelle participation algérienne aux deux conflits mondiaux dans lesquels la France fut impliquée au cours du XXème siècle. Au regard du nombre de soldats engagés, cette participation fut sans commune mesure avec celles des autres pays placés, à l’époque, sous souveraineté française puisque 210.000 Algériens prirent part à la première guerre mondiale et 26.000 y perdirent la vie. Entre 1939 et 1945, 150.000 Algériens furent mobilisés et 16.000 d’entre eux périrent. Alger fut la capitale de la France Libre et la base de départ des opérations visant à libérer la Corse. Or, essentiellement concentrée sur la période 1954-1962, l’évocation de l’histoire commune franco-algérienne tend souvent à oublier l’importance du rôle joué par l’Algérie et des Algériens lors des deux guerres mondiales. Mettre en valeur cette participation à l’occasion des prochains cycles commémoratifs permettrait assurément de dépasser, dans le rappel de notre passé commun, les seules périodes conflictuelles. En déplacement à Alger, la mission d’information a pu se rendre compte d’une attitude plutôt ouverte des autorités algériennes sur ces questions. Dès lors, une démarche visant à organiser des actions communes valorisant le rôle des soldats algériens et de l’Algérie
– mais aussi, plus largement, celui de l’ensemble des combattants originaires d’Afrique – durant les deux guerres mondiales mériterait d’être proposée aux autorités des pays concernés(69).
C. UNE COOPÉRATION À POURSUIVRE ET À APPROFONDIR
En dépit du caractère sinusoïdal des relations officielles bilatérales entre la France et l’Algérie, les liens n’ont jamais été rompus.
La coopération entre les deux pays est aujourd’hui bien réelle mais, bien évidemment, est encore largement perfectible.
Ainsi, quatre thèmes ont particulièrement retenu l’attention de la mission d’information. Ces thèmes sont assurément les plus structurants et doivent faire l’objet d’un suivi tout particulier dans les mois et années à venir.
1. L’importance de la dimension humaine
La dimension humaine de la coopération bilatérale est un sujet incontournable eu égard à l’espace démographique franco-algérien précédemment décrit par votre rapporteur.
a. La circulation et le séjour
En premier lieu se pose le problème de la circulation des Algériens et des Français entre les deux pays. La Déclaration d’Alger sur l’amitié et la coopération entre la France et l’Algérie » du 19 décembre 2012 rappelle, à juste titre, que « les échanges humains qui témoignent des liens étroits entre les deux pays, représentent une richesse incomparable pour chacun d’eux » et contient l’engagement des deux Etats de « favoriser le plus largement possible la mobilité de leurs ressortissants entre les deux pays » et de s’efforcer « de répondre aux préoccupations exprimées par l’une des parties en ce qui concerne l’entrée et le séjour de ses ressortissants sur le territoire de l’autre, ainsi que le respect de leurs droits ». Des progrès peuvent et doivent donc être faits sur ces sujets sensibles même si l’honnêteté doit conduire à constater qu’on ne part pas de zéro et que des améliorations ont déjà pu être apportées au cours des dernières années.
Ainsi que votre rapporteur l’a indiqué, notre pays est la première destination des ressortissants algériens tant à des fins touristiques que d’émigration durable, leur circulation dans notre pays étant encadré par la réglementation européenne. Très critiqué, par le passé, par sa lenteur et son taux de refus élevé, notre réseau consulaire en Algérie – qui, pour mémoire, a délivré 155.000 visas de court séjour en 2011 et environ 180.000 en 2012 –, afin de faciliter l’accueil et de réduire les délais, a externalisé la réception des demandes, comme c’est le cas en Chine, en Russie, à Londres ou au Maroc. Aujourd’hui, à Alger, il faut environ deux semaines pour obtenir un rendez-vous et le temps de traitement est généralement d’une semaine à dix jours (70). Votre rapporteur tient à relever qu’environ un tiers des visas de court séjour délivrés le sont en tant que « visas de circulation », lesquels, d’une validité d’un an ou plus, autorisent plusieurs séjours ne pouvant dépasser 90 jours par périodes de six mois. Le séjour des ressortissants algériens en France, quant à lui, est dérogatoire au droit commun des étrangers et est régi par un accord bilatéral du 27 décembre 1968, modifié à trois reprises depuis son entrée en vigueur. Environ 20.000 visas de long séjour ont été délivrés à des Algériens en 2012, ce chiffre incluant notamment le regroupement familial et les visas pour suivre des études. Les principales spécificités du régime institué par l’accord de 1968 sont les suivantes : l’entrée des Algériens en France est facilitée par l’absence d’exigence de visa de long séjour pour la délivrance de titres de séjour aux conjoints et parents de Français ; les Algériens bénéficient de la liberté d’établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante ; enfin, ils peuvent accéder plus rapidement que les ressortissants d’autres États à la délivrance d’un titre de séjour valable 10 ans. Ce régime n’intègre cependant pas les dispositions récentes plus favorables instituées par le droit commun puisque certains titres de séjour concernant l’immigration professionnelle tels que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission », « compétences et talents » ou la carte de résident pour contribution économique exceptionnelle n’ont pas d’équivalent dans l’accord franco-algérien. La France et l’Algérie ayant décidé que l’accord de 1968 ne serait pas modifié, des marges de progression supplémentaires sont assurément possibles en ce qui concerne le traitement des demandes de visas mais aussi l’assouplissement des procédures de délivrance, en particulier en facilitant l’octroi de visas de circulation pour les populations ne présentant aucun risque migratoire et amenées à se rendre régulièrement en France. Il en va de même pour les étudiants comme votre rapporteur l’évoquera ultérieurement.
En tout état de cause, cette question des visas est un sujet éminemment sensible. Votre rapporteur va avoir l’occasion d’y revenir dans la seconde partie du présent rapport mais la possibilité offerte aux Algériens et, plus particulièrement, à la jeunesse, d’émigrer est l’un des éléments qui contribuent à équilibrer les relations entre le régime algérien et sa population, donc au maintien d’une relative stabilité intérieure. Y mettre un terme ou, en tout cas, réduire fortement l’accueil légal de ressortissants algériens sur notre territoire, décision souveraine de la France, aurait indéniablement des conséquences politiques relativement sérieuses en Algérie. Les autorités algériennes suivent avec attention les orientations prises par notre pays en la matière, et ce, plus que tout autre pays serait amené à le faire.
L’entrée et le séjour des Français en Algérie, quant à eux, se font à double titre. Les binationaux – qui sont la principale clientèle touristique du pays – utilisent généralement leurs passeports algériens. Ceux qui sont uniquement français relèvent d’un texte spécifique du droit algérien qui, selon les informations recueillies par votre rapporteur, semble régulièrement méconnu par les autorités algériennes. Nombre de nos compatriotes, que ce soit pour des raisons professionnelles ou familiales, et malgré une règlementation algérienne en principe favorable, éprouvent ainsi des difficultés pour s’installer en Algérie notamment en raison des délais d’obtention des autorisations de travail… dont les Français sont en principe exemptés. De même, les visas de circulation – dont votre rapporteur a montré la part notable dans les visas délivrés par la France – sont eux très peu délivrés par les consulats algériens alors qu’ils sont si précieux et seraient une avancée considérable pour les voyages d’affaires et pour les membres de famille des Français résidant en Algérie. Ainsi que l’a rappelé le président Hollande devant les parlementaires algériens, il est souhaitable que la circulation et le séjour en Algérie de nos compatriotes puissent être facilités.
b. L’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire tant en matière pénale qu’en matière civile représente un enjeu majeur pour la France et l’Algérie, deux pays qui, on l’a vu, en plus d’un passé et d’intérêts communs, partagent aujourd’hui une vaste communauté humaine composée de ressortissants et de doubles nationaux très mobiles.
En ce qui concerne les questions pénales, la bi-nationalité a créé de facto un espace judiciaire commun à la France et à l’Algérie. En effet, il n’est pas rare que des doubles nationaux mis en cause dans des affaires criminelles ou délictuelles fuient en Algérie où ils ne sont dès lors plus considérés comme citoyens français mais seulement comme Algériens. Leur extradition vers notre pays devient alors impossible et les autorités françaises sont amenées à faire des « dénonciations officielles » qui n’ont pas toujours les suites que l’on pourrait éspérer. Il y a aujourd’hui une centaine de dénonciations « pendantes » devant la justice algérienne, lesquelles concernent notamment des infractions à la législation sur les stupéfiants, des vols mais aussi des viols, meurtres ou assassinats. Malheureusement, les condamnations prononcées sont souvent tardives et le taux de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu est élevé. En sens inverse, la coopération s’avère également compliquée par la présence de la peine de mort dans la législation algérienne. Certes, depuis 1993, l’Algérie n’exécute plus mais la peine capitale continue à être requise et prononcée. Cela bloque toute extradition de criminels de la France vers l’Algérie car la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État est claire : non seulement, la France ne peut extrader en cas de prononcé de la peine capitale mais, en plus, les autorités françaises ne peuvent participer à une enquête permettant de conduire au prononcé de la peine de mort. Il est donc indispensable de progresser sur ces questions qui sont régies, pour le moment par deux conventions d’entraide judiciaires de 1962 et 1964 et qui, assurément, sont devenues obsolètes.
Les relations humaines entre la France et l’Algérie ont logiquement conduit à des mariages de part et d’autre de la Méditerranée avec, inévitablement, le problème d’enfants déplacés. C’est là un sujet particulièrement sensible parce qu’humainement délicat mais aussi très complexe sur le plan juridique. Plusieurs contentieux sont actuellement en cours. Aujourd’hui, ils relèvent du cadre fixé par un échange de lettres entre les autorités des deux pays qui remonte à 1980 et par une convention de 1988 qui ne concerne que les couples mariés dont l’un est Français et l’autre Algérien. Or, le plus souvent, le pragmatisme prévaut car les cas d’enfants déplacés concernent des binationaux non mariés qui sont, dès lors, exclus du champ de la convention. Là aussi, sur cette question qui a particulièrement ému la mission d’information, un travail de modernisation des textes doit être entrepris.
Sur ces sujets sensibles mais concrets, la France et l’Algérie ont l’obligation de coopérer quotidiennement. Certes, la question de l’entraide pénale et des enfants déplacés concernent aussi d’autres États mais la densité des liens humains franco-algériens impose sans doute un intérêt accru et une prise de conscience rapide de la nécessité d’améliorer le droit existant et les pratiques administratives et judiciaires.
Dès lors, on ne peut que saluer les rapprochements entrepris par les deux États dans ce domaine si sensible. C’est notamment le cas grâce aux magistrats de liaisons détachés, réciproquement, dans chaque pays. La décision de créer de tels postes a été prise en 2007, à l’issue de la visite du président Sarkozy en Algérie et a été formalisée deux ans plus tard, en 2009. Le premier magistrat de liaison français à Alger – que la mission a eu l’occasion de rencontrer tant sur place qu’à Paris – a pris ses fonctions en septembre 2009. Son rôle est multiple. Il participe à l’entraide judiciaire, qu’elle soit pénale ou civile. Il aide les juges français quand ils délivrent des commissions rogatoires ou des mandats d’arrêt, il participe à la diffusion de la connaissance du droit français aux Algériens et du droit algérien aux Français et contribue à la formation des magistrats algériens, le système judiciaire de ce pays relevant d’une organisation proche de la nôtre. Enfin, il conseille, sur le plan juridique, l’ambassadeur et les trois consuls généraux (Alger, Oran et Annaba). Ce travail, si précieux, doit être poursuivi et votre rapporteur se félicite de la pérennisation de ce poste dont le prochain titulaire est sur le point d’être nommé. De même doit-on saluer les multiples jumelages de cours d’appel qui se sont noués avec le temps – Bordeaux avec Oran, Paris avec Alger, Tlemcen avec Montpellier, Constantine avec Grenoble, Lyon avec Annaba… – et qui sont si utiles pour une meilleure connaissance réciproque et un travail plus efficace. Plus récemment, l’engagement pris par les deux États, à Alger, en décembre 2012, de mettre en place un groupe de travail pour résoudre les cas d’enfants déplacés issus de couples mixtes mais aussi pour faciliter l’entraide pénale doit, lui aussi, être salué.
c. La résolution de divers « irritants »
Si le terme est apprécié des diplomates et sert merveilleusement à désigner des contentieux persistants mais qui ne bloquent pas toute coopération, les « irritants » entre la France et l’Algérie ne doivent pas être négligés pour autant. Les deux pays se sont engagés à progresser dans leur résolution et la mission d’information, qui en a retenu deux, estime qu’un grand pas serait franchi si des résultats tangibles pouvaient rapidement être obtenus.
Il convient de citer, par exemple, la question des créances hospitalières avec l’Algérie, qui existe d’ailleurs avec d’autres pays du Maghreb. Il s’agit en fait de créances de la Caisse nationale de sécurité sociale algérienne mais aussi de créances d’État dont le montant est estimé à 30 millions d’euros concentrés à 80 % sur deux établissements : l’APHP (71) et, à un degré moindre, l’APHM(72). Ce dossier délicat est traité par le ministère des affaires sociales et a bien évidemment été inclus dans le champ de la visite présidentielle de décembre 2012, à l’issue de laquelle les Algériens ont versé plus de 13 millions d’euros, ce qui constitue une première évolution positive alors que la question était bloquée depuis très longtemps.
Un autre sujet de divergences existe entre Paris et Alger : la question des biens immobiliers de certains Français en Algérie dont la propriété est aujourd’hui contestée par les autorités algériennes alors qu’ils n’ont pas été déclarés vacants ou nationalisés après 1962. Il y a peu de cas mais ils sont lourds. Cette question a été évoquée lors de la visite d’État du Président Hollande en Algérie et figure dans le communiqué commun des ministres des affaires étrangères. Avancer sur ce sujet constituerait un signal très positif pour l’avenir des relations franco-algériennes.
2. La culture et l’éducation au service de la jeunesse et de la langue française
La culture et l’éducation sont deux domaines de coopération qui ont particulièrement retenu l’attention de la mission d’information. Ils figurent en bonne place dans la déclaration d’Alger par laquelle « les deux parties souhaitent donner une claire priorité à l’éducation et à la formation » et « conviennent de donner une impulsion significative à leurs relations et aux échanges culturels par la conclusion d’accords dans ce domaine et de faciliter chacune les activités des établissements éducatifs et culturels de l’autre sur son territoire ». Le document-cadre de partenariat signé lors de la visite d’État met quant à lui l’accent sur l’ « appui au renforcement du capital humain » qui passe par un soutien au système éducatif algérien, à l’enseignement du français et en langue française mais aussi à la promotion des échanges culturels. Votre rapporteur se félicite de telles orientations et souhaite vivement que les initiatives envisagées puissent être menées à leur terme et invite la représentation nationale – en particulier par l’intermédiaire de la commission des affaires étrangères – à suivre avec attention leur devenir.
Si la mission n’a pas souhaité rentrer dans les détails de tous les programmes franco-algériens de coopération en matière culturelle et éducative, qu’ils soient actuellement en cours ou envisagés, il lui a semblé opportun de mettre l’accent sur deux pans important de cette coopération : la jeunesse et la langue française.
Pourquoi la jeunesse ? Peut-être parce que plus qu’ailleurs, c’est une des clefs pour comprendre l’Algérie d’aujourd’hui. Votre rapporteur y reviendra en seconde partie du présent rapport mais la jeunesse est aujourd’hui largement prépondérante dans la société algérienne (28 % de la population a moins de 15 ans). Elle en constitue le cœur et ses palpitations ne sont pas sans influence sur la vie politique et sociale du pays. Majoritairement sans emploi dans un pays qui peine à lui faire une place, éprise du désir de découvrir de nouveaux horizons, tiraillée entre les traditions et de légitimes aspirations à plus d’ouverture comme y invite le succès d’internet et de ses réseaux sociaux, la jeunesse algérienne est assurément la « cible » la plus pertinente vers laquelle doivent tendre nos actions de coopération. A ce titre, on ne peut que se féliciter de la décision prise lors de la visite d’Etat de décembre 2012 d’ouvrir et de développer un réseau d’une vingtaine d’Instituts d’enseignements supérieur technologique (IEST) à travers le territoire » (73) algérien et ce avec l’aide de la France.
Plus généralement, au-delà de la formation professionnelle, il est indispensable que les jeunesses française et algérienne apprennent à mieux se connaître. La mission d’information a pu rencontrer de nombreux jeunes Algériens et a été frappée par leur vitalité et leur soif d’apprendre. Leurs désirs et leurs envies sont similaires à ceux des jeunes Français. Les échanges doivent se développer pour, bien sûr, mieux se former mais aussi apprendre les uns des autres et, ainsi, réduire les préjugés et enclencher un cercle vertueux, celui d’un partenariat d’égal à égal, solide et durable. Tel est l’esprit de la déclaration d’Alger signée par les deux chefs d’État en décembre 2012, qui émet le vœu que soit mises « en place toutes les facilités tendant à promouvoir et à encourager les initiatives permettant une meilleure connaissance réciproque de leurs jeunesses, en réponse à leurs attentes ». Dès lors, « pourquoi ne pas saisir le défi et l’adversité du moment pour aller encore plus loin ? Combattre ensemble un ennemi dangereux, avant de se reconstruire un avenir commun ? Jeter des ponts économiques, sociaux et culturels entre les deux rives de la Méditerranée ? Ainsi, pourquoi n’existe-il pas, aujourd’hui, d’Office franco-algérien de la jeunesse, sur le modèle du remarquable OFAJ franco-allemand ? » (74). En effet, les membres de la mission d’information considèrent qu’il serait possible d’envisager à terme la création d’un Office franco-algérien de la jeunesse. Une telle structure existe déjà pour deux Etats avec lesquels nous avons des relations privilégiées : l’Allemagne, on l’a vu, et le Québec. L’OFAJ a ainsi « pour mission d’approfondir les liens qui unissent les enfants, les jeunes, les jeunes adultes et les responsables de jeunesse des deux pays. A cet effet, il contribue à la découverte de la culture du partenaire, encourage les apprentissages interculturels, favorise les mesures de qualification professionnelle, renforce les projets communs d’engagement citoyen ». L’OFQJ, lui, « contribue au rapprochement des jeunesses française et québécoise par des programmes de mobilité axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel et social, tout en favorisant les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux ». Ne pourrait-on pas s’inspirer de ces deux exemples célèbres et reconnus pour créer une structure ayant les mêmes ambitions et tournée vers l’Algérie ? Cette idée est défendue par certaines associations et semble avoir été soulevée par le passé sans pour autant qu’il y soit donné suite. La nouvelle ère dans laquelle entrent les relations franco-algériennes ne peut-elle pas être l’occasion de relancer un tel projet qui dépasserait largement le niveau des symboles ?
Dans le même ordre d’idées et dans le prolongement des observations de votre rapporteur sur la nécessité de faciliter la circulation des personnes entre la France et l’Algérie, il est indispensable d’ouvrir nos universités aux étudiants algériens. Durant l’année 2011-2012, ils représentaient pourtant le troisième contingent des étudiants étrangers en France avec 23.700 personnes, derrière les étudiants marocains, (32.500 personnes) et les étudiants chinois (29 700)(75). Or, il existe une forte demande des étudiants algériens pour obtenir un visa de départ vers notre pays. Cinq mille sont délivrés chaque année, ce qui oblige à une très forte sélection. De plus en plus, le Canada, qui conserve une politique migratoire ouverte, tend à relayer la France comme pays d’opportunités. La mission d’information a pu constater que nos Instituts français en Algérie servent de plus en plus de lieux d’examen pour tester le niveau en français afin de partir étudier, ensuite, au Québec ! Le gouvernement est conscient de l’enjeu. Lors du débat tenu en séance publique le 13 juin dernier et consacré à l’immigration professionnelle et étudiante, Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, ne déclarait-elle pas que « nous devons amplifier notre dispositif d’accueil en direction de nos amis disposés à la francophonie (…) car il faut faire attention à ce que notre zone d’influence au Maghreb et en Afrique subsaharienne ne se réduise pas » ? L’Algérie est en première ligne. Il faut maintenant se donner les moyens de soutenir ses étudiants en développant, par exemple, les bourses qui leurs sont destinées.
Parallèlement et en complément aux efforts dirigés vers la jeunesse algérienne, notre coopération culturelle et éducative avec l’Algérie doit permettre de soutenir et de promouvoir notre langue en Algérie. Votre rapporteur ne va pas revenir sur l’importance de celle-ci pour bon nombre d’Algériens mais aussi sur les sensibilités qui peuvent parfois être exacerbées lorsque le français est d’abord perçu comme la langue de l’ancienne puissance coloniale avant de l’être comme un outil d’ouverture et d’échange, présent sur les cinq continents. A juste titre, le document cadre de partenariat pour 2013-2017 signé par la France et l’Algérie, en décembre dernier, souligne l’importance de l’enseignement de notre langue en Algérie où elle est l’« une des langues d’apprentissage » et où « sa bonne maîtrise est un facteur supplémentaire de réussite ». Le communiqué conjoint des deux ministres des affaires étrangères prévoit que « deux nouvelles écoles françaises à Oran et Annaba seront ouvertes ». Cela ne peut que réjouir votre rapporteur qui a précédemment relevé l’engouement pour notre langue manifesté par de nombreux Algériens, lequel conduit, malheureusement, à l’encombrement de notre réseau culturel et scolaire en Algérie. Cette perspective de deux écoles supplémentaires doit donc être saluée et il conviendra d’en suivre le devenir. De même, faudra-t-il rapidement tirer les conséquences du refus des autorités algériennes d’autoriser la réouverture de l’Institut français de Tizi-Ouzou en envisageant, éventuellement, la création d’un nouveau centre dans une autre ville.
Ce bref panorama des points saillants de la coopération culturelle et éducative retenus par la mission ne serait pas complet sans mentionner la nécessaire réciprocité qui doit aller de pair en la matière. La présence culturelle et scolaire algérienne en France, quoique plus réduite que celle de notre pays en Algérie, doit être soutenue. Il est ainsi prévu qu’un « statut conventionnel pour le centre culturel algérien et pour les écoles algériennes à Paris » soit défini par les deux États. La commission des affaires étrangères sera peut-être amenée, dans un avenir proche, à être saisie d’un éventuel accord mettant en œuvre cet objectif. Par ailleurs, la mission d’information estime que l’enseignement de la langue arabe, en France, doit être encouragé. Cela ne peut que contribuer au rapprochement entre notre pays et l’Algérie. De même, une meilleure connaissance de cette langue internationale qu’est l’arabe ne peut qu’être un atout pour la France, laquelle, en la matière, dispose d’un avantage unique : celui d’avoir en son sein des millions de ressortissants qui la connaissent, la maîtrisent et sont autant de ponts vers les sociétés arabophones. Or, ce constat, qui est une évidence, est pourtant nié. L’agrégation d’arabe, par exemple, est constamment menacée alors même que l’arabe été introduit au Collège de France par François Ier. Sachons ouvrir l’école publique et, surtout, l’université à l’arabe, langue par laquelle, comme l’a dit le Président Nicolas Sarkozy, « s’expriment tant de valeurs de civilisation et de valeurs spirituelles »(76).
3. Pour une relation économique « gagnant-gagnant »
a. L’Algérie, un partenaire de premier plan pour la France
La France est le premier fournisseur de l’Algérie. En 2012, notre pays a assuré 12,83 % des importations algériennes, suivi de très près par la Chine avec une part de 12,56 % et par l’Italie avec une part de 9,29 %. L’Algérie est ainsi le troisième marché pour les exportations françaises hors pays de l’OCDE, et ce, après la Chine et la Russie et devant la Turquie. Concrètement, nos exportations vers l’Algérie sont assez diversifiées. Au-delà des véhicules (17 % du total)(77), des céréales (13 %), des produits pharmaceutiques (11 %) et des produits du raffinage de pétrole (11 %), les exportations françaises se composent également de machines pour l’extraction ou la construction (2,6 %), d’ordinateurs et d’équipements périphériques (2,2 %), de produits sidérurgiques (2,1 %), de produits laitiers et fromages (2 %), d’accessoires pour véhicules automobiles (1,8 %) et les instruments et appareils de mesure, d’essai et de navigation (1,5 %) (78).
Nos importations en provenance d’Algérie se composent presqu’exclusivement d’hydrocarbures. En 2012, ces derniers correspondaient à 97 % du total des produits importés d’Algérie par la France, avec du pétrole brut (45% des importations), du gaz naturel (40 %), des produits de raffinage (11 %) et des gaz industriels (1%)(79). Au total, l’Algérie assurait, en 2011, environ 10 % de notre approvisionnement en gaz et 5 % de celui en pétrole.
Au total, nos échanges commerciaux avec l’Algérie dégagent un excédent en notre faveur (taux de couverture de 131 % en 2011) mais, regardé sur la durée, ce résultat doit être fortement relativisé : notre part de marché qui, on l’a vu, était de 12,83 % en 2012, était de 15,12 % un an plus tôt. Plus généralement, elle a subi une érosion constante au cours des dernières années puisqu’elle était de 25 % en 2000. Dans l’intervalle, la concurrence s’est considérablement accrue. L’Italie, l’Espagne mais surtout Chine et plus récemment la Corée du Sud ont réalisé de considérables progrès sur le marché algérien. Ainsi, si nos exportations vers l’Algérie ont enregistré un taux de croissance moyen de 11 % par an depuis 10 ans – soit une multiplication par 3,2 –, la Chine a multiplié ses exportations vers l’Algérie par 21, l’Italie par 5,6, l’Espagne par 6, la Corée par 8,9. Le tableau suivant réalisé à partir d’informations fournies par les douanes algériennes est, à cet égard, édifiant :
Cette érosion des parts de marché françaises en Algérie ne doit toutefois pas occulter le fait que notre pays y est, hors hydrocarbures, le premier investisseur. Les flux d’Investissements directs français en Algérie ont atteint en moyenne entre 200 et 250 millions d’euros par an depuis 5 ans. Le stock d’IDE français en Algérie était estimé à 1,9 milliard d’euros en 2011, composé à 34 % d’investissements dans les activités financières (présence de nos banques Société Générale, BNP Paribas, Natixis, des compagnies d’assurance Macif, Cardiff, plus récemment Axa). Le secteur hydrocarbures arrivait en deuxième position (9 % du stock) avec Total et GdF-Suez, suivis de près par les industries pharmaceutiques (6,5 %) avec Sanofi-Aventis, agroalimentaire (5 %) avec Danone, Lactalis, Hubbard, Bel, In Vivo, l’automobile (4 %) avec les réseaux de concessionnaires des groupes Renault et PSA, ou encore dans l’industrie (Schneider Electric, Michelin, Saint-Gobain, Alstom.
Au total, environ 450 entreprises et entrepreneurs français se sont implantés en Algérie. Ils y emploient près de 40.000 salariés (pour environ 100.000 emplois indirects) et y réinvestissent une bonne partie de leurs bénéfices (autour de 80 % pour les sociétés les plus importantes d’entre elles(80)).
b. L’Algérie, un marché difficile mais des intérêts économiques convergents avec les nôtres
Le fait que l’Algérie soit un partenaire commercial et économique de premier plan pour la France ne doit pas occulter le fait que les entreprises éprouvent certaines difficultés sur le marché algérien. Bureaucratie pesante, réglementation complexe et volatile, contrôle des changes pointilleux, conditions sécuritaires parfois incertaines, pénalisation de l’acte de gestion… sont autant d’obstacles au développement de la présence économique française en Algérie tout comme l’est la loi dite « 51/49 ». Ce texte, dont l’évocation est omniprésente lorsqu’on interroge les acteurs de la relation économique avec l’Algérie, a été voté en 2009 et dispose qu’un minimum de 51 % du capital d’une entreprise étrangère industrielle ou prestataire de services, souhaitant s’implanter en Algérie soit détenu par une personne physique de nationalité algérienne et/ou une personne morale dont les actionnaires sont Algériens. De même, tout projet d’investissement étranger (direct ou en partenariat) doit être soumis à l’examen préalable du Conseil national de l’investissement (CNI) et doit être financé uniquement par recours à l’emprunt auprès d’institutions locales. Ce genre de mesures – justifié, selon les Algériens, par la nécessité de protéger temporairement leur marché – peut légitimement susciter des réserves de la part des investisseurs étrangers et votre rapporteur y reviendra plus longuement dans la seconde partie du présent rapport lorsqu’il évoquera le climat d’affaire dégradé qui prévaut en Algérie.
Ces difficultés sont regrettables et dommageables mais doivent être en partie nuancées.
Tout d’abord, les autorités françaises et algériennes en sont conscientes : la relance actuelle de la relation bilatérale contient un volet économique substantiel qui a pleinement profité du succès de la visite du Président de la République à Alger, en décembre dernier. À cette occasion, la mission d’information tient à saluer le travail effectué, depuis 2010, par M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et vice-président du Sénat, en tant que « représentant spécial pour les relations économiques franco-algériennes ». En liaison avec M. Cherif Rahmani, ministre de l’industrie(81), il a effectué un travail remarquable au bénéfice des entrepreneurs des deux côtés de la Méditerranée et sa reconduction, à ce poste, après l’alternance politique en France, l’a pleinement démontré. Une fois la mission de M. Raffarin parvenue à son terme, la nomination d’une nouvelle personnalité apte à jouer le même rôle – si précieux – devra à nouveau être envisagée.
Par ailleurs, s’il est certes difficile, le marché algérien peut présenter des avantages pour les entreprises françaises. La proximité géographique, culturelle et linguistique leurs donnent des avantages indéniables. De plus, la taille du marché algérien et ses 38 millions d’habitants mais aussi son aisance financière avec de grands programmes d’investissements sur budget public et un taux d’épargne élevé des ménages constituent des facteurs attractifs. De même, si certains pans de la réglementation algérienne telle que la loi 51/49 peuvent susciter des interrogations légitimes, plusieurs interlocuteurs rencontrés par la mission d’information en Algérie ont insisté sur le caractère généralement durable des investissements réalisés dans ce pays malgré – ou grâce à – la relative difficulté à la pénétrer.
En tout état de cause, la France et l’Algérie ont un intérêt commun au renforcement de leurs relations économiques. « Les deux pays sont condamnés à trouver des solutions à la sortie de crise commune à l’Europe et à la Méditerranée »(82). Ils font face aux mêmes défis : une dépendance excessive aux hydrocarbures (la France comme consommatrice et l’Algérie comme productrice), une industrie malmenée sous l’effet de la mondialisation, une jeunesse confrontée au chômage. En outre, la France et l’Algérie ont des économies complémentaires avec d’un côté, la maîtrise de technologies avancées et de l’autre la volonté et la capacité de procéder à de gros investissements, ce qui ne peut que plaider en faveur d’opérations de « colocalisation »(83).
c. Vers un nouveau partenariat économique entre la France et l’Algérie ?
La visite d’Etat du Président de la République à Alger, les 19 et 20 décembre 2012, a comporté un large volet économique, la France et l’Algérie entendant donner un « nouvel élan » à leurs relations dans ce domaine, « favoriser une relance équilibrée de leurs échanges et encourager le développement des investissements entre leurs entreprises »(84).
A cet effet a été signée par Mme Nicole Bricq, M. Arnaud Montebourg et M. Cherif Rahmani une « déclaration conjointe pour un partenariat industriel et productif » qui jette les bases d’un développement de la « colocalisation » entre les deux rives de la Méditerranée, afin d’enclencher un cercle vertueux profitant à tous. On pourrait par exemple imaginer que des investissements algériens viennent aider des entreprises françaises en difficulté, leur permettant ainsi d’acquérir des technologies et des savoirs faires industriels pour investir ensuite conjointement en Algérie dans un partage de la chaîne de valeur qui assurerait une meilleure compétitivité face à la concurrence d’autres pays.
L’implantation d’une usine Renault en Algérie relève de cette stratégie de coproduction. Lors de la visite du président Hollande, Renault et ses partenaires algériens – la SNVI (85) et le FNI (86) – ont signé un accord pour la construction d’une usine de montage de véhicules près d’Oran. La mission d’information a eu l’occasion de rencontrer des représentants du groupe Renault qui ont pu lui présenter ce projet ambitieux qui a fait l’objet d’un suivi attentif au plus haut niveau et a été minutieusement préparé avec les autorités algériennes. Dans un premier temps, l’objectif de l’usine (détenue à 51 % par la SNVI et le FNI et à 49 % par Renault) sera de produire 25.000 voitures par an puis 75.000 à terme et de développer, en Algérie une véritable filière industrielle soutenue par une amélioration de l’offre locale de formation professionnelle. 350 emplois directs devraient être créés dans un premier temps.
Assurément, ce genre d’initiative est remarquable et doit être encouragé. Car, « au-delà de la mise en œuvre de très beaux projets comme la construction de l’usine Renault d’Oran, [la France et l’Algérie] ont surtout compris que l’intérêt des deux parties, mais aussi leurs responsabilités leur commandaient d’établir un partenariat durable entre les deux rives de la Méditerranée. Produire en Algérie, créer du travail en Algérie, investir en Algérie, transférer du savoir-faire vers l’Algérie peut aller de pair avec plus de production, plus de travail, plus de compétences en France. Nos économies sont interdépendantes plutôt que concurrentes. Le développement de l’Algérie, dans toutes ses dimensions, n’est pas seulement dans l’intérêt du peuple algérien : il est aussi dans l’intérêt de la France »(87).
Au plan institutionnel, les 28 et 29 mai derniers, à Alger, Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur, a ouvert, avec M. Chérif Rahmani, ministre algérien de l’industrie, le premier « Forum de partenariat », une manifestation organisée par Ubifrance et qui a rassemblé une cinquantaine d’entreprises françaises et une centaine d’algériennes dans les filières de l’agroalimentaire du BTP, de la mécanique et de la santé. Les deux ministres ont également installé le premiercomité mixte économique franco-algérien (COMEFA), engagement inscrit dans la déclaration d’Alger signée par les deux chefs d’Etat, en décembre 2012. Cette instance de pilotage de la relation économique entre la France et l’Algérie, qui se réunira une fois par an, assurera un suivi des projets économiques et commerciaux en cours et traitera les éventuels difficultés et blocages.
Indéniablement l’Algérie est aujourd’hui bien plus qu’un marché : c’est un partenaire majeur avec lequel nos entreprises doivent travailler dans la durée.
4. La sécurité, une préoccupation partagée
La France et l’Algérie ont un intérêt convergent majeur : la lutte contre le terrorisme islamiste.
Votre rapporteur ne va pas revenir sur l’histoire algérienne de ces vingt dernières années avec, notamment, la décennie noire et l’émergence d’Al-Qaeda au Maghreb islamique (AQMI)(88). Certes, la violence terroriste en Algérie n’a aujourd’hui plus rien à voir avec celle des années 90 mais ce pays est encore régulièrement confronté à des attaques meurtrières de la part des groupes terroristes. En 2012, par exemple, le MUJAO avait été à l’origine de deux attentats : l’un à la voiture piégée ayant fait 23 blessés, le 3 mars 2012 à Tamanrasset et l’autre, une attaque suicide, contre le siège régional de la gendarmerie à Ouargla, le 29 juin. En août de la même année, deux attentats à la bombe près de Tebessa et Tizi-Ouzou (Kabylie) firent deux morts et sept blessés parmi les militaires algériens. En 2013, le mois de janvier fut marqué par l’attentat d’In Amenas et la mort de 38 otages.
De son côté, la France est confrontée au terrorisme islamiste depuis les années 1990. Entre juillet et octobre 1995, elle a connu une vague d’attentats qui ont été attribués au GIA algérien. Le plus meurtrier, celui de la station de RER Saint-Michel à Paris le 25 juillet, a fait 8 morts et 119 blessés. Plus récemment les lâches assassinats commis par Mohammed Merah, à Toulouse, ont fait revivre aux Français les heures noires et douloureuses du terrorisme fanatique.
La France et l’Algérie collaborent depuis longtemps sur ces questions. Les liens entre le DRS et la DCRI sont connus et toute coopération en la matière doit être poursuivie. Comme l’ont fait les deux ministres des affaires étrangères dans leur communiqué conjoint lors de la visite d’Etat de décembre 2012, on ne peut que se féliciter « de l’atmosphère constructive et sereine caractérisant le dialogue entre les deux pays » et il est indispensable de « tout mettre en œuvre pour poursuivre et intensifier encore ce dialogue afin que leur partenariat stratégique se traduise dans le bien-être de leurs ressortissants ».
Dans cette perspective, une coopération franco-algérienne renforcée sur le dossier du Sahel est incontournable. La perspective d’une implantation durable d’AQMI dans cette région, dans une sorte de « base avancée » vers l’Europe et la France était très préoccupante. Après l’Afghanistan, le Sahel était susceptible, il y a encore quelques mois, de devenir à son tour un camp d’entraînement pour djihadistes de tous les pays. Les katibas mettaient en péril la stabilité de toute une région. Heureusement, si l’opération Serval a permis de mettre un terme à l’imminence de cette menace, elle a aussi conduit l’Algérie à faire preuve d’une ouverture tout à fait remarquable à l’égard de notre pays en facilitant nos opérations militaires contre les mouvements terroristes au Mali. Comme l’analysera votre rapporteur dans la seconde partie, une telle décision n’allait pas de soi quelques semaines auparavant. La visite du président Hollande à Alger, moins d’un mois avant le déclenchement de l’opération Serval, a certainement contribué à créer un cadre favorable à ce que l’Algérie agisse de la sorte, à un moment où nos troupes luttaient contre le fléau terroriste sur le sol malien.
Il faut maintenant transformer l’essai. La coopération militaire bilatérale devra être au rendez-vous et l’accord franco-algérien dans ce domaine, entré en vigueur en février dernier, s’il est mis en œuvre avec volontarisme, ouvre des perspectives prometteuses dans cet important secteur.
II. L’ALGÉRIE À L’HEURE DES CHOIX
A. UN PAYS À L’ECART DU « PRINTEMPS ARABE » DE 2011
1. Une réaction habile face aux émeutes
L’année 2011 a débuté, en Algérie, par des émeutes violentes dans 20 des 48 wilayas du pays. Connue pour être une terre de « jacqueries » régulièrement secouée de soubresauts, l’Algérie vécut, entre le 5 et le 8 janvier 2011, un mouvement d’insurrection, fondé sur des revendications à la fois politiques et sociales, dénonçant le pouvoir et la vie chère, et qui fut une véritable surprise tant aux yeux des autorités que des Algériens eux-mêmes. « De Bab el-Oued, quartier chaud de la capitale, à Tirigou, cité des laissés-pour-compte d’Oran, la deuxième ville du pays, en passant par Bouira et Béjaïa, en Kabylie, Chlef et Relizane dans le Nord-Ouest, Tiaret dans les hauts Plateaux, Djelfa et Laghouat aux portes du désert, l’Algérie [s’embrasa] en quelques heures. Liaisons ferroviaires interrompues, axes routiers coupés, rideaux de magasins baissés et rues livrées à des hordes de jeunes armées de sabres et de barres de fer… Un très fort sentiment d’insécurité planait sur les grandes villes du pays »89. Le 12 février suivant, une marche fut organisée à Alger, à l’initiative de la CNCD, la coordination nationale pour le changement et la démocratie, et ce, en dépit de l’interdiction de manifester dans cette ville en vigueur depuis juin 2011. Le mouvement s’essouffla rapidement et le nombre de participants, estimé à 8.000 personnes le premier jour, décrut rapidement les jours suivants.
Ainsi s’achevait la séquence algérienne du « Printemps arabe » qui secoua le Maghreb et le Moyen-Orient à la même époque. Le contraste avec la Tunisie, pays voisin, était frappant puisque les manifestations populaires qui y débutèrent à partir du 17 décembre 2010, après l’immolation du jeune Mohamed Bouazizi, se muèrent, en quelques semaines, en une vraie révolution qui provoqua la chute de Zine el-Abidine Ben Ali, le 14 janvier 2011.
L’échec du Printemps arabe en Algérie doit beaucoup à l’habileté des autorités algériennes, et ce, dès les premières heures des émeutes de janvier 2011.
Sur le plan du maintien de l’ordre, les manifestations ont été bien contenues. La police, reprise en main quelques mois avant le début des émeutes par le général Abdelghani Hamel, avait pour consigne de ne pas recourir aux armes létales. Contrairement à d’autres moments de l’histoire de l’Algérie, elle géra la situation avec un certain doigté puisque, de source gouvernementale, une seule victime fut à déplorer parmi les manifestants. De même, le 22 février 2011, lors de la marche organisée par le CNCD, 30.000 policiers avaient été déployés à Alger, ce qui dissuada rapidement les manifestants de poursuivre leur mouvement de protestation.
Le régime parvînt également à calmer les revendications en ne tardant pas à prendre des mesures destinées à faire baisser les prix du sucre et de l’huile, deux produits dont la flambée des cours avait suscité un fort mécontentement. Dès le 8 janvier 2011, le Gouvernement annonça une série de décisions en ce sens, mêlant subventions et exonérations fiscales et douanières sur les matières premières entrant dans leur fabrication. Au-delà, à la suite des manifestations de janvier et février 2011 et des grèves organisées dans plusieurs secteurs, les autorités n’hésitèrent pas à puiser dans les importantes réserves financières du pays – réserves dont ne disposaient pas, il faut le relever, ni Bel Ali ni Moubarak – pour ramener la « paix ». Ainsi, plusieurs corps de fonctionnaires virent leur salaire augmenter avec effet rétroactif. Au total, l’équivalent de presque 20 milliards d’euros auraient été dépensés en trois mois pour financer ces diverses mesures sociales.
Enfin, au niveau politique, la réponse des autorités fut double. D’une part, elles laissèrent la presse s’exprimer librement et offrirent ainsi à l’opinion publique un défouloir bienvenu lui permettant d’exprimer sa colère. D’autre part, elles souhaitèrent ne pas se montrer immobiles face aux revendications en acceptant de s’engager dans un processus de réformes. Le 15 avril 2011, le président Bouteflika annonça, dans une intervention télévisée, une série de mesures devant permettre de consolider la démocratie en Algérie. Certaines d’entre elles furent rapidement adoptées comme la levée de l’état d’urgence et les votes de nouvelles lois sur les élections90, les partis politiques et les associations91. De même, la perspective d’une révision de la Constitution fut également envisagée avec, au préalable la tenue de consultations permettant de définir les paramètres d’un jeu politique ouvert et la tenue d’élections véritablement démocratiques. À ce jour, ce processus de réformes ne semble pas avoir vu d’effets concrets et paraît avoir été délibérément allongé(92). Les autorités algériennes ont su apporter une réponse habile qui a permis de calmer un certain nombre de revendications.
2. Des raisons plus structurelles
a. Le « printemps » de 1988 et l’impact de la décennie noire
Pour la plupart des personnalités auditionnées par la mission d’information, la principale raison qui explique que l’Algérie n’ait pas été confrontée aux mêmes troubles que ses voisins arabes, en 2011, réside dans le douloureux souvenir de la décennie noire qui affecte, encore aujourd’hui, de nombreux Algériens. Cette terrible guerre civile fit près de 200.000 victimes et des dizaines de milliers de disparus. Elle succéda à une période d’ouverture démocratique, en 1988, qui, pour beaucoup, fut le premier « printemps arabe » de la région. Entre le 5 et le 10 octobre 1988, de graves émeutes se déclarèrent dans toute l’Algérie. Face à ces évènements très violents et mal anticipés par le pouvoir, le président Chadli, après avoir proclamé l’état de siège, fit appel à l’armée pour rétablir l’ordre ce qui, selon un bilan officieux, aurait provoqué la mort de 500 à 600 personnes. Toutefois, le 10 octobre 1988, le chef de l’État intervînt à la télévision et annonça une série de réformes favorables au multipartisme et à la liberté d’expression. C’est dans ce contexte que les islamistes montèrent rapidement en puissance, favorisés notamment par le choc qu’avait constitué, aux yeux de nombreux Algériens la terrible répression d’octobre 1988. Le FIS remporta les élections municipales de 1989 puis fut sur le point de gagner le scrutin législatif de 1990 avant que le processus électoral ne soit suspendu, entre les deux tours, le 26 décembre 1991 et laisse place à la guerre civile qui fit souffrir l’Algérie tout au long des années 90.
Ce « printemps algérien », constitua assurément une expérience traumatisante pour le peuple algérien puisqu’il se termina par un terrible bain de sang qui s’étala sur une décennie. Il est donc aisé d’imaginer que face aux soubresauts qu’a connus le monde arabe au cours de l’année 2011, les Algériens aient préféré faire preuve de prudence. De plus, par un « matraquage médiatique [tendant] à identifier les révoltés des « printemps arabe » à des agents travaillant à la déstabilisation de la région » (93), le pouvoir algérien a assurément su faire de la Tunisie, de la Libye, de l’Egypte ou de la Syrie des épouvantails et l’histoire récente ne peut d’ailleurs pas forcément donner tort à ce type de raisonnement : les violences libyennes et syriennes évoquent beaucoup, pour l’inconscient collectif algérien, les périodes les plus sombres et font office de repoussoir.
b. Un pouvoir non personnalisé
Les révolutions arabes de 2011 ont vu des peuples chasser – ou essayer de chasser – des dictateurs : Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, Kadhafi en Lybie ou Bachar El Assad en Syrie. Dans ces pays, le pouvoir était dans les mains d’une famille ou d’un clan qui avait accaparé les richesses et le système économique et contrôlait l’ensemble des instruments répressifs pour préserver leur position.
Ce « modèle » ne peut être transposé à l’Algérie.
Tout d’abord, il serait injurieux de comparer le président Bouteflika aux anciens despotes d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. D’ailleurs, les manifestations du début de l’année 2011 n’ont jamais eu pour mot d’ordre de renverser le chef de l’État. Au contraire, le président Bouteflika a toujours joui d’une certaine popularité, en particulier pour avoir contribué, après son élection, par le processus de « réconciliation nationale », à clore la décennie noire et à ramener la paix civile dans le pays.
En outre, l’Algérie n’est pas une dictature militaire et le pouvoir doit y être analysé avec subtilité. Si l’appareil étatique repose sur des institutions classiques qui nous sont familières – présidence de la République, gouvernement, parlement bicaméral, conseil constitutionnel, double ordre de juridictions… – il doit être analysé à travers une « grille de lecture » propre à l’Algérie. En effet, au-delà de la façade officielle, le pouvoir semble impliquer plusieurs rouages de l’État dans un mode de fonctionnement relativement collégial et autonome mais empreint d’opacité. « Conseil d’administration » ou « conclave » sont des termes fréquemment entendus par la mission d’information, au cours de ses auditions, pour désigner cette façon d’exercer le pouvoir, également appelée « Nidham » (« système ») par les Algériens. En tout état de cause, il apparaît difficile de cerner les contours exacts de ce « cercle » dirigeant qui, selon certains observateurs attentifs de la vie politique algérienne, « n’est pas une somme d’individus mais un ensemble de rouages interdépendants et d’inégale importance » composé, en premier lieu « du rouage suprême, l’institution présidentielle, qui en assure la pérennité » mais aussi de « deux autres rouages indispensables, l’Armée nationale populaire (ANP) et les services de renseignements (hier Sécurité militaire, aujourd’hui Département du renseignement et de la sécurité, DRS) » (94). Cette relative opacité du cœur du pouvoir algérien et le fait qu’il semble être quelque peu autonome vis-à-vis de l’architecture officielle des institutions soulèvent régulièrement la question de la réalité du pouvoir algérien et de l’identité des véritables responsables du pays(95).
Quoiqu’il en soit, cet exercice collégial du pouvoir en Algérie, s’il peut être déroutant pour un observateur non au fait des subtilités de la vie politique locale, a aussi pour conséquence de ne pas remettre toute l’autorité dans les mains d’un seul homme. Et cette caractéristique a assurément joué dans le fait que les événements de janvier 2011 n’ont pas eu plus de conséquences : contrairement à ses voisins orientaux, l’Algérie n’avait pas à offrir la figure d’un tyran exerçant un pouvoir sans partage.
c. Des « soupapes de sécurité »
Une autre raison qui a fait que 2011 n’a pas été l’année d’une révolution algérienne fut l’existence, à ce moment-là – et encore aujourd’hui – d’espaces de liberté qui n’existaient pas en Tunisie ou en Libye. Et ces marges de manœuvre ont assurément permis de diminuer la pression exercée sur les dirigeants en permettant à l’opinion publique de se défouler au moment opportun.
Ainsi la liberté de presse – la presse écrite essentiellement96 – est-elle une réalité, en Algérie, et ce, depuis la fin des années 80. Il existe aujourd’hui plus de 80 titres (le tiers environ étant francophones) et leur lecture est édifiante de par les propos, souvent très critiques, qu’on peut lire. Certes, il y a quelques tabous et cela fut visible, il y a peu, lorsque certains journaux ne purent en totale liberté évoquer la santé du chef de l’État97. Certes il y a sans doute, dans certains cas, une part d’auto censure étant donné que le pouvoir dispose de moyens de pression potentiellement très efficaces dans la mesure où il contrôle l’impression des journaux et les recettes publicitaires. Il n’en demeure pas moins que les journalistes savent être féroces et n’hésitent pas à critiquer ouvertement le pouvoir voire le régime, à soulever des affaires de corruption ou à remettre en cause les politiques menées par les autorités. Les caricaturistes Hic dans El Watan ou Dilem, « le Plantu algérien », dans Liberté, sont certainement les acteurs les plus connus de la presse algérienne et leurs dessins ne sont pas tendres avec les dirigeants algériens, y compris ceux dont aurait pu croire, tel le Président Bouteflika ou le général Mediène, chef du DRS, qu’ils auraient été intouchables98.
De nombreux journaux affichent régulièrement une tonalité critique vis-à-vis du pouvoir et El Watan a même pu organiser, en juillet 2012, un colloque à l’occasion du cinquantenaire de l’Algérie qui n’a pas hésité à remettre en cause un certain nombre d’idées reçues et de mythes fondateurs de l’historiographie officielle algérienne.
Aux côtés de la liberté de la presse, l’émigration et les familles vivant à l’étranger – notamment en France – sont également des « soupapes de sécurité » indispensable à la stabilité de l’Algérie d’aujourd’hui. La « respiration » des hommes et des idées entre les deux rives de la Méditerranée sont une donnée essentielle pour appréhender la réalité algérienne actuelle. Sans cette possibilité offerte à la jeunesse algérienne de pouvoir partir – en tout cas, l’espoir de pouvoir, un jour, émigrer –, le pouvoir algérien serait assurément confronté à une population beaucoup plus hostile qui aurait probablement réagi de manière différente au cours des dernières années. D’où l’importance que revêt la question des visas attribuée par notre pays aux ressortissants de l’Algérie. C’est là une question qui est bien évidemment un enjeu de la relation bilatérale mais qui est aussi, par la force des choses, un pilier de la stabilité du régime algérien.
B. UN PAYS SOUS PRESSION
1. Le « mal vivre » algérien
a. Une défiance absolue par rapport au pouvoir et à la politique au sens large
La mission d’information a été frappée par la méfiance manifestée par le peuple algérien à l’égard de ceux qui gouvernent le pays mais aussi de la politique en général. Cette méfiance n’est pas anodine et créé un climat parfois pesant qu’on doit inévitablement prendre en compte lorsqu’on se penche sur l’Algérie d’aujourd’hui.
Cette méfiance a d’abord une origine historique. Ce pays a connu deux guerres – la guerre d’indépendance et la guerre civile des années 90 – en l’espace de trente ans, soit moins d’une génération. Ce pays a été sur-idéologisé et, tour à tour, a été confronté aux expériences du nationalisme arabe, du communisme, du socialisme, de l’islamisme… Autant de systèmes qui ont montré leurs limites et dont les échecs répétés ont logiquement conduit les Algériens à tempérer sérieusement l’enthousiasme qu’ils pourraient encore avoir vis-à-vis de la politique. Au moment des « révolutions » de 2011, l’Égypte et la Tunisie étaient dans des situations différentes puisqu’aucun de ces pays n’ayant eu le même vécu que l’Algérie, ils pouvaient – et peuvent encore – croire à la possibilité d’un changement.
Cette méfiance prend également source dans le sentiment qu’ont de nombreux Algériens que voter ne sert à rien et que quel que soit le résultat des élections, rien ne changera. La permanence du « Nidham », que votre rapporteur a décrite précédemment, l’autorité relative des institutions élues, une opposition qui semble accepter les « règles du jeu » fixées par le pouvoir mais aussi un personnel politique qui, aux yeux de beaucoup d’Algériens, se renouvelle trop lentement voire pas du tout sont autant de facteurs qui affaiblissent la portée des scrutins organisés en Algérie et minent la confiance du peuple envers ses représentants. « À quoi reconnaît-on un « indigné » algérien ? Il ne défile pas dans les rues, comme d’autres dans le monde arabe, au Yémen ou en Égypte, ni ne campe sous une tente comme en Espagne. Il ne porte aucune banderole, ne crie pas de slogans hostiles au pouvoir et ne se voit pour ainsi dire pas. L’« indigné » algérien existe, pourtant. Sa façon à lui de manifester: il ne vote pas »99. D’où des taux de participation aux élections relativement bas, alors même que les chiffres officiels sont sans doute quelque peu artificiellement surévalués, aux dires de plusieurs interlocuteurs rencontrés par la mission d’information. D’où également un désintérêt assez généralisé pour la vie politique algérienne et, dans le même temps, une vraie connaissance du jeu politique français, connaissance facilitée par la large diffusion des chaînes de télévision françaises et par les contacts avec les membres de la famille établis en France. À cet égard, l’année 2012 illustra parfaitement ce paradoxe puisque l’élection présidentielle française précéda de quelques jours les législatives en Algérie et, comme le suggéra si habilement Dilem à l’époque, il semble bien que les premières passionnèrent bien plus les Algériens que les secondes100.
Pour autant, certains Algériens refusent encore de se résigner et croient encore à la possibilité d’apporter des changements à leur pays par le biais, notamment, du débat d’idées et du jeu politique. Bon nombre de double-nationaux ou d’Algériens vivant à l’étranger sont dans ce cas. Leur réussite au-delà des frontières algériennes et leur ouverture sur le monde en font de vraies forces de proposition et un atout majeur pour l’Algérie(101). Votre rapporteur tient également à citer le groupe NABNI (102) qui rassemble des universitaires, des cadres, des chefs d’entreprise, des professions libérales de différents horizons, en Algérie et dans la communauté algérienne à l’étranger, autour de la volonté de débattre et de proposer des mesures susceptibles de transformer en profondeur leur pays. La plus récente publication de NABNI, le rapport publié à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance et suggérant « cinquante chantiers de rupture pour bâtir l’Algérie de 2020 » ne peut que passionner quiconque s’intéresse au devenir de ce pays(103).
b. Corruption, bureaucratie et incivilités
La corruption apparaît être un fléau très sérieux qui mine, aujourd’hui, le développement de l’Algérie et pèse énormément sur la vie quotidienne des Algériens. Transparency International classe le pays à la 105ème place sur 176 dans le monde et à la 21ème place sur 50 pays en Afrique104. Pour l’Association algérienne de lutte contre la corruption, citée par le quotidien Le Matin, ce classement relativement médiocre s’explique « d’une part, parce que les scandales de corruption ne cessent d’éclater, et que d’autre part, non seulement l’absence de volonté politique du gouvernement à lutter contre la corruption est la règle, mais plus grave encore, des ministres en exercice – cités et/ ou impliqués dans des affaires de corruption -, continuent de bénéficier d’une totale impunité et de l’inertie de la justice »105.
Il est vrai que, ces dernières années, l’actualité algérienne a été nourrie par plusieurs scandales notamment l’affaire Khalifa ou celle impliquant la Sonatrach – l’entreprise nationale de pétrole – et des personnes liées au pouvoir106 .
Ces scandales à répétions ne sont pas sans conséquence sur l’opinion publique. Ils diffusent un réel sentiment d’injustice dont la mission d’information a pu se rendre compte au cours de nombreux entretiens. Ils incitent également les Algériens à considérer que toute la société est pourrie et que, in fine, le système sera toujours plus fort qu’eux. Ce phénomène de lassitude voire de résignation est amplifié par le fait que la corruption va souvent de pair avec des pratiques administratives lentes et paperassières qu’un « coup de pouce » opportun permettra toujours d’accélérer ou d’orienter en sa faveur.
Ce constat d’une réalité qui contribue tant au « mal vivre » algérien, la mission d’information l’a fait, au fil de ses auditons, tant à Paris qu’en Algérie. Votre rapporteur a conscience qu’il est délicat de soulever une telle question, d’autant plus que notre pays est loin de pouvoir prétendre à l’exemplarité en la matière. Malgré tout, il faut souligner que les autorités algériennes reconnaissent elles-mêmes qu’il y a là un problème prégnant et que la corruption inflige quotidiennement une véritable souffrance au peuple algérien :
« La corruption mine le tissu social de notre pays. Elle a essaimé sur l’ensemble du territoire national et a touché toutes les classes sociales. La corruption exacerbe les relations sociales, et, annihile les valeurs sur lesquelles doit reposer tout groupement de personnes devant vivre en société.
« Les valeurs fondamentales que sont le travail, le mérite, le savoir, la droiture, l’honnêteté, l’éducation et la citoyenneté sont devenues opaques. Leur visibilité tendant de plus en plus à être estompée par la corruption qui a atteint quasiment tous les niveaux de responsabilités dans l’ensemble des domaines, et qui constitue réellement un « sport national » qui est en train d’hypothéquer les actions tendant au développement économique et social de notre pays. De même, la corruption a transformé la moralité publique en une « foire à tchipas », en une « foire à bakchichs ».
« C’est pourquoi, les citoyens n’ont plus confiance dans leurs institutions. Ils ont recours aux personnes, qui, à différents échelons, peuvent « octroyer » des droits et avantages au détriment de la loi. Ces personnes, cadres ou simples agents de l’Etat, privatisent la fonction exercée, aidées en cela par une nomination sans fin dans leurs fonctions. Et, ils dirigent les différentes institutions et administrations dont ils ont la charge comme un bien qui leur rapporte à chaque acte ou décision des avantages matériels. Une telle attitude est observée à tous les niveaux de responsabilité.
« Le degré de prévalence de la corruption est tel qu’il a introduit d’autres « valeurs» et sous-tend la société uniquement par les choses matérielles. Tout se vend, tout s’achète, tout a un prix. Cette situation est exacerbée, également, par l’impunité. La volonté politique affichée par notre pays dans la lutte contre ce fléau n’a eu aucune emprise sur ce phénomène qui se développe allégrement, se banalise, et, devient, de plus en plus, une source d’enrichissement « licite » »107.
c. Une société en ébullition
Si, fâchés avec le jeu politique, nombre d’Algériens semblent avoir mis de de côté leurs revendications sur ce terrain-là en boycottant massivement les élections, les manifestations à connotation sociale rythment quotidiennement la vie de l’Algérie. Et les actions peuvent être violentes. « L’« « indigné » algérien, pauvre dans un pays riche se révolte. Il dresse des barricades sur la route, incendie des pneus, affronte des policiers, mais toujours dans son quartier, et pour des motifs bien précis: le logement, l’emploi, la vie chère »108. Une flambée des prix sur des fruits ou légumes peut mobiliser bien plus que les réunions de partis sans programme et devenus inaudibles.
Les chiffres exacts ne sont pas connus mais il y aurait, jusqu’à un millier de manifestations, chaque année, en Algérie. Ce fut d’ailleurs le cas quelques jours avant le déplacement, à Alger, de la mission d’information, puisque la ville de Ouargla accueillit une imposante « marche des chômeurs » et fut le théâtre, quelques semaines plus tard, de véritables émeutes dont le mobile déclencheur semble avoir été la protestation contre une liste de logements sociaux affichée par les autorités locales.
Cet état quasi-insurrectionnel permanent témoigne, une fois de plus, du mal-être d’une partie de la société algérienne qui ne profite pas des richesses du pays, sur lesquelles votre rapporteur va avoir l’occasion de revenir. Un exemple frappant est sans doute le secteur de la santé dont beaucoup d’Algériens dénoncent le sous-équipement et la corruption, lesquels rendent incontournable le recours à l’étranger pour pouvoir se soigner correctement(109). Une solution onéreuse que peu de personnes, bien évidemment, peuvent se permettre. En matière d’emploi, « selon les sources officielles, le chômage en Algérie concernerait 10 % de la population. D’autres chiffres – officieux ceux-là –avancent un taux d’inactivité établi à 30 %. Sur une population de 37 millions d’habitants, dont 64 % sont en âge de travailler, c’est beaucoup »110. Cela est d’autant plus inquiétant que la jeunesse algérienne est la principale victime de la situation.
d. Une jeunesse frustrée
La principale victime du « mal vivre » des Algériens est assurément la jeunesse. En 2010, selon une étude du Centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement, un organisme algérien spécialisé dans la recherche démographique, 60 % des jeunes scolarisés dénonçaient le flou caractérisant leur avenir, les trois-quarts critiquaient leur cadre de vie, un tiers rêvait de quitter le pays et 90 % affirmaient se désintéresser de toute activité associative ou en lien avec un parti politique111.
Aucune des auditions menées par la mission d’information n’a remis en cause ce constat : le désir d’émigrer est très massivement répandu parmi la jeunesse algérienne. Il n’y a qu’à en juger, par exemple, par les « visa, visas » criés par la foule lors des dernières visites des présidents français en Algérie et que votre rapporteur a eu l’occasion d’évoquer lorsqu’il a abordé la relation bilatérale. De même, la « harga » – l’émigration irrégulière – montre la volonté de partir à tout prix exprimée par certains jeunes, et ce, malgré les dangers et une loi de juin 2008 qui punit passeurs et immigrés d’une peine de prison et de lourdes amendes. Ainsi, en 2012, 5.479 Algériens – les harragas – ayant tenté de venir illégalement dans l’espace Schengen ont été interceptés aux frontières communautaires. Ce chiffre classe l’Algérie au deuxième rang des pays dont sont originaires les immigrants illégaux arrêtés (10 % du total), loin derrière l’Afghanistan (31%) mais devant la Turquie (6, 8%) et la Syrie (6 %)(112). Les routes de l’immigration clandestine sont aujourd’hui diverses et la voie traditionnelle de l’ouest méditerranéen est aujourd’hui légèrement supplantée par les passages plus à l’est, y compris via la Turquie est les Balkans. Le portrait-robot de l’harraga algérien est celui d’un homme, âgé de 18 à 30 ans, confronté à un manque de travail, la plupart du temps célibataire, parlant arabe et, dans une moindre mesure, le français voire l’anglais, ayant de la famille dans l’Union européenne, notamment en France, en Belgique, en Allemagne ou en Espagne, famille qui sera susceptible de l’aider à trouver un travail et à s’installer au sein d’une communauté déjà présente. Concrètement, la bande de territoire comprise entre la frontière marocaine et la ville de Mostaganem est connue pour être le lieu de départ des traversées maritimes clandestines vers Almeria ou Murcia, en Espagne(113).
Au-delà des problèmes d’emploi, c’est aussi un sentiment d’étouffement qui contribue à rendre l’Algérie incapable de garder ses enfants. Ce pays de 37 millions d’habitants compte moins de 50 salles de cinéma et à peine une dizaine de théâtres. Les membres de la mission d’information eux-mêmes ont pu se rendre compte, en traversant à maintes reprises plusieurs quartiers d’Alger, du « calme » de la ville et du caractère atone de sa vie nocturne. Le gouvernement algérien a d’ailleurs compris la nécessité d’agir sur ce domaine et vient de lancer un programme destiné à faire revivre Alger la nuit, y faisant semble-t-il régner « un petit air festif inhabituel »114.
En tout état de cause, les députés membres de la mission qui se sont rendus à Alger au mois de mars dernier ont eu l’occasion de constater la vitalité et la diversité de la jeunesse algérienne en rencontrant les dirigeants et les membres de l’association SOS Bab El Oued. Et cette jeunesse, talentueuse et motivée, aspire légitimement à un bonheur qu’elle mérite pleinement.
e. Le corset du conservatisme
Au soutien de l’initiative tendant à donner une impulsion nouvelle à la vie nocturne algéroise que votre rapporteur vient d’évoquer, le Premier ministre Sellal a déclaré, le 4 juin dernier, que « la jeunesse a besoin de vivre » et qu’on ne peut pas « l’envoyer dormir juste après la prière du soir. »115. La formule est intéressante car, en creux, elle indique la difficulté de concilier modernité et tradition en l’Algérie.
En effet, les chaînes de télévision étrangères sont très largement reçues dans les foyers, la jeunesse ressemble à celles des pays voisins, écoute les mêmes musiques et « surfe » sur Facebook ou les autres réseaux sociaux avec le même enthousiasme. La société de consommation se développe de plus en plus, comme en témoigne l’ouverture récente d’un centre commercial géant de 45.000 m² à Bab Ezzouar, une ville nouvelle et universitaire de la banlieue d’Alger.
En parallèle, l’Algérie est un pays musulman. Le droit algérien le proclame. La Constitution le dit clairement : « l’Islam est la religion de l’État » (article 2) et « les institutions s’interdisent (…) les pratiques contraires à la morale islamique » (article 9). En outre, la famille algérienne est soumise au droit musulman essentiellement selon le rite malékite qui est fondé sur la morale et la religion. Le régime matrimonial des conjoints, par exemple, est soumis aux règles du droit musulman classique : le mariage n’institue aucune communauté de biens entre les époux et laisse subsister distinct le patrimoine de la femme de celui du mari. Quoique peu pratiquée dans les faits, la polygamie est autorisée par la loi et une femme musulmane ne peut épouser un non-musulman. Par ailleurs, le droit établit une inégalité en matière successorale, la fille n’héritant que de la moitié des parts de son frère.
Ainsi la société algérienne demeure-t-elle essentiellement patriarcale et conservatrice. « La tradition pure et dure (…), réduite à ses pires travers, se porte toujours comme un charme en Algérie : contrôle social du groupe culturel ou familial, déni de l’individu, enclavement et méfiance vis-à-vis de l’étranger, machisme et traitement rétrograde de la femme, rejet de tout changement ou nouveauté issu de l’extérieur »116. Des tensions sont alors inévitables. C’est particulièrement vrai s’agissant de la situation des femmes algériennes, à la fois au sein des familles – où l’accès des femmes à l’éducation et à l’espace public modifie en profondeur les équilibres –, qu’au sein de la société, où les réflexes conservateurs se doublent d’une agressivité marquée à l’égard des femmes, par exemple celles se déplaçant seules dans la rue, signe tant d’une profonde frustration sociale que d’un conservatisme prenant prétexte de la religion pour se faire « justice ».
Au final, « cela donne surtout un peuple perdu, dans un total brouillage des repères, meilleur terreau des extrémistes »117.
2. Un modèle économique bloqué
a. Une économie rentière
« Comment va l’Algérie ? Elle pourrait aller mieux si elle ne dépendait pas autant des hydrocarbures, qui représentent 97 % des exportations. Cela ne peut plus durer »(118). En quelques mots, Issad Rebrab, fondateur et PDG de Cevital, premier groupe privé d’Algérie, a parfaitement décrit l’obstacle majeur auquel est confronté son pays : une hyper-dépendance à un seul secteur qui n’est pas sans conséquence néfastes sur les autres domaines de l’économie algérienne.
En effet, l’économie algérienne est principalement fondée sur l’exploitation des ressources du sous-sol, pétrole et gaz. Le secteur des hydrocarbures n’emploie que 3 % de la population active mais représente environ 40 % du PIB, environ 70 % des recettes fiscales et 97 % des recettes d’exportations. Et la majorité des 3 % restants est issue de produits dérivés d’hydrocarbures ou liés à la sidérurgie, les produits agricoles, agroalimentaires ou manufacturés demeurant marginaux dans les exportations globales(119).
La manne qui est tirée de cette « rente » a permis de rembourser la quasi-totalité de la dette extérieure qui est aujourd’hui tombée à 2,2% du PIB, ce qui fait de l’Algérie le pays le moins endetté de la région Moyen-Orient Afrique du Nord grâce à des réserves de changes estimées à 200 milliards de dollars.
Pour autant, ces données que jalouseraient bien des pays en Europe, ne doivent pas tromper : la situation économique de l’Algérie est préoccupante et, à terme, loin d’être viable.
Tout d’abord, gaz et pétrole ne sont pas éternels. D’après les informations recueillies par votre rapporteur, le « pic » pétrolier et gazier – c’est-à-dire le moment où la production commencera à décliner – n’est pas très éloigné. « Si l’on en croit la BP Statistical Review, une référence dans les milieux énergétiques, le pays dispose de dix-huit années de réserves pétrolières au taux actuel de production et de cinquante années en ce qui concerne le gaz. En fait, nombre d’experts s’attendent à voir intervenir le pic bien avant : pour le pétrole, dès 2020, pour le gaz, vers 2030. Il est peu probable que l’on découvre de fortes réserves d’hydrocarbures conventionnels »(120).
De même, gaz et pétrole apparaissent être des ressources relativement instables pour l’Algérie en raison des variations que peuvent connaître les cours internationaux de ces matières. Or, ces cours ont une influence directe sur les ressources budgétaires du pays, lequel voit son destin lié à un prix qui peut connaître des chutes vertigineuses comme en 2008, année où le baril, après avoir atteint un record de 147 dollars en juillet, chuta à moins de 34 dollars en décembre(121). Dans ce contexte, la question de l’équilibre budgétaire de l’État algérien se pose avec acuité, d’autant plus que le volume des exportations algériennes d’hydrocarbures a baissé au cours des dernières années – de par une concurrence internationale accrue et une demande européenne atone – et que la demande intérieure a explosé. La rente pétrolière devient de plus en plus vulnérable : désormais, il semble qu’il faille un baril autour de 121 dollars pour équilibrer le budget, ce qui est loin d’être acquis actuellement. Certes, l’Algérie dispose de marges de manœuvres confortables avec, entre autres, des réserves de change couvrant près de trois années d’importations et une dette extérieure devenue résiduelle mais il est évident que le modèle algérien fondé sur une rente très généreuse n’est guère durable.
De surcroît, la rente liée aux hydrocarbures a eu un effet anesthésiant sur l’économie algérienne en freinant, pendant longtemps, tout effort de diversification de l’économie. Un exemple a frappé la mission d’information : l’absence de réelle ouverture de l’Algérie au tourisme alors même que ce pays, à la population si accueillante, a des atouts immenses. Outre son climat agréable, il offre à ceux qui le visitent des paysages magnifiques et un patrimoine historique remarquable qui pourraient en faire une destination de premier plan. Or, l’Algérie apparait, encore aujourd’hui, et malgré des efforts de diversification que votre rapporteur va avoir l’occasion de souligner ultérieurement, comme prisonnière d’un secteur unique. L’aisance budgétaire permet de financer des importations massives même si ce doit être, parfois, au prix, d’un non-sens économique(122). Elle offre aussi à l’État la possibilité de jouer un rôle prédominant dans la vie économique du pays au détriment d’un « paysage entrepreneurial algérien [qui] ressemble malheureusement plus aux steppes arides de Biskra (ville de l’Est, porte du désert) qu’aux plaines fertiles de la Mitidja (plaine agricole de l’arrière-pays algérois)… Moins de 12 entrepreneurs pour 1.000 habitants, un ratio largement inférieur à ce qu’on voit ailleurs ; 30 créations d’entreprises pour 1000 habitants »(123), soit dix fois moins qu’au Maroc. La rente facilite aussi le clientélisme et permet de financer la politique sociale du gouvernement : augmentations des salaires et des retraites, construction de logements et autres infrastructures qui, comme votre rapporteur l’a souligné, ont permis à l’État de faire face efficacement à la contestation apparue au début de l’année 2011.
b. Un climat des affaires dégradé
Outre les effets néfastes de sa rente pétrolière, l’Algérie souffre également d’un environnement des affaires difficile et, par là même, peu favorable au développement du secteur privé et aux investissements étrangers.
Comme votre rapporteur a déjà eu l’occasion de le relever – et les autorités algériennes l’admettent elles-aussi (124) – la bureaucratie et des pratiques administratives parfois pesantes bloquent grandement l’initiative privée et le développement de l’économie algérienne. Bien souvent, la volonté gouvernementale se retrouve encalminée dans l’appareil administratif et ne donne pas les résultats escomptés. Le cas du marché financier algérien, par exemple, est impressionnant : « depuis plus de 15 ans maintenant, [il] reste obstinément réduit à des proportions lilliputiennes : la capitalisation financière de la Bourse d’Alger représente moins de 1/1000e du PIB national. Le bilan est squelettique : trois titres cotés, bientôt quatre, un nombre d’obligations en chute libre avec un niveau de transaction annuel qui ne dépasse pas deux millions de dollars. En comparaison, la Bourse de Palestine, qui ne dispose quand même pas de toutes les facilités, compte plus de 40 titres cotés, celle du Vietnam, toujours dirigée par un parti communiste, représente déjà plus de 15% du PIB. Les Tunisiens arrivent à 20% du PIB alors que la Bourse de Casablanca accueille des centaines de sociétés et représente en capitalisation plus de 60% du produit national marocain » (125).
La législation algérienne elle-même peut également soulever des inquiétudes auprès des investisseurs. La règle la plus fréquemment citée est assurément la loi dite 51/49 qui, depuis 2009, plafonne à 49 % les participations étrangères au capital des entreprises tant dans les secteurs stratégiques que non stratégiques. Selon les autorités algériennes rencontrées par les membres de la mission à Alger, en mars 2013, un tel texte, s’il permet de protéger l’économie du pays le temps qu’elle acquière une compétitivité suffisante pour résister à une ouverture plus large, est aussi favorable aux entreprises étrangères puisqu’en devant s’associer à un partenaire algérien, le risque financier qu’elles prennent est réduit et leur appréhension des arcanes de l’administration algérienne est moins problématique. Par ailleurs, la législation algérienne impose aussi un contrôle pointilleux des changes qui constitue une gêne pour les sociétés étrangères. Le droit des affaires présente aussi un côté « repoussoir » car en disposant que la bonne foi du contrevenant ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale, un chef d’entreprise qui prend un acte de gestion s’avérant mauvais pour l’intérêt de la société est passible d’une peine de prison alors même qu’il n’y avait pas d’intérêt personnel en jeu.
Ce climat des affaires peu favorable se traduit par un classement guère brillant de l’Algérie dans les études internationales. Le rapport de la Banque mondiale « Doing Business » pour 2013, par exemple, place l’Algérie au 152ème rang sur 185 pays(126). Certes, votre rapporteur admet bien volontiers les biais et les limites méthodologiques de ce genre de « palmarès » mais il n’en contient pas moins un fonds de vérité. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’Algérie n’a pas encore adhéré à l’OMC alors que la demande d’adhésion au GATT remonte à 1987 et que les négociations effectives d’adhésion ont débuté en 1998 (127).
c. Une prise de conscience suffisante ?
Les autorités algériennes semblent avoir conscience des risques que fait courir sur l’avenir du pays le modèle économique actuel qui prévaut en Algérie.
En effet, comme l’ont indiqué, à Alger, plusieurs interlocuteurs rencontrés par la mission d’information, les autorités algériennes entendent privilégier désormais le redressement de leur appareil industriel, encore largement dominé par les entreprises publiques, bien qu’un secteur privé dynamique commence à émerger (128), afin d’assurer la diversification indispensable de l’économie, la création d’emplois, la montée en gamme et en compétences de l’appareil productif, et envisager, à terme, une capacité d’exportation qui, on l’a vu, est aujourd’hui quasi inexistante à l’exception des hydrocarbures. Dans cette perspective, la volonté de rapprochement avec la France évoquée précédemment par votre rapporteur traduit parfaitement cette orientation de politique économique dont il convient désormais de suivre avec attention la mise en œuvre et les résultats. Car la volonté de diversification n’est pas nouvelle. L’Algérie a, par le passé, adopté plusieurs plans successifs ayant, entre autre, cet objectif. Ce fut notamment le cas du « plan complémentaire de soutien à la croissance » (PCSC) qui allouait une enveloppe de 180 milliards de dollars(129), sur la période 2005-2009 pour le développement des infrastructures et la diversification de l’économie. Un nouveau plan lui a succédé, le « plan quinquennal pour la période 2010-2014 » qui prévoit des investissements publics d’un montant de 286 milliards de dollars dont 130 sont destinés à parachever les grands projets non achevés du précédent plan, notamment dans les secteurs de l’eau, des transports ferroviaire et des routes, ce qui traduit assurément une certaine difficulté à mener à bien les projets entamés.
En ce qui concerne l’attractivité de l’Algérie, là aussi, les autorités du pays paraissent désireuses d’apporter des améliorations. Un « comité national d’amélioration du climat des affaires » a ainsi été créé en réponse au mauvais classement de l’Algérie dans le rapport « Doing Business » de la Banque mondiale précédemment évoqué par votre rapporteur. Ce comité, auquel, fait notable, a été associée la Banque, a été installé, au mois de mars, par le ministre de l’industrie, M. Chérif Rahmani, avec l’idée de rendre « amical et convivial » le climat de l’investissement en Algérie et d’inscrire durablement le pays dans une dynamique de croissance et d’attractivité afin de rompre avec la logique de « rattrapage permanent » dans lequel il se trouve vis-à-vis tant de ses partenaires régionaux que de ses concurrents internationaux. Ce comité semble avoir agi rapidement puisqu’il aurait remis à la Banque mondiale son rapport sur « les mesures de facilitation et d’allègement relatives à l’environnement de l’entreprise et de l’investissement » prises en 2012-2013 » (130). Il sera intéressant de voir les suites concrètes qui seront données à ce travail mais aussi de constater l’éventuel effet de celui-ci sur le prochain classement « Doing Business » que produira prochainement la Banque mondiale.
3. Une diplomatie à rude épreuve
a. Une puissance régionale volontairement en retrait sur la scène internationale
Puissance régionale, l’Algérie l’est sûrement. Avec ses 37 millions d’habitants – ce qui en fait un des États les plus peuplés d’Afrique du Nord, et en tout cas le plus peuplé dans son environnement immédiat –, son ouverture sur la Méditerranée et sa proximité avec le Sahel, ce pays est un carrefour entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. Avec un territoire de 2.381.741 millions de km², c’est aussi le plus vaste État africain depuis la partition du Soudan, en 2011. Sur le plan militaire, l’Algérie consacre 3,3 % de son PIB à la défense et elle dispose d’une force conséquente avec une armée de 400.000 hommes, dont 170.000 pour les forces terrestres, 14.000 pour les forces aériennes et 26.000 pour les forces navales, ce qui lui offre une capacité d’intervention militaire significative(131).
Pour autant, cette puissance n’a pas de traduction diplomatique directe car, en matière de politique étrangère, l’Algérie reste fidèle à ses principes fondateurs, au moment de son indépendance : lutte en faveur de la décolonisation des peuples du tiers-monde, « non alignement », soutien aux « causes justes » comme la cause palestinienne, respect de la souveraineté des États indépendants ou, refus de toute interférence étrangère. L’Algérie s’est d’ailleurs vivement opposée à l’intervention internationale en Libye, en 2011, ce que n’ont pas manqué de rappeler nombre d’interlocuteurs algériens rencontrés par la mission d’information, à Alger, en mars 2013. De même l’Algérie s’interdit-elle d’envoyer des soldats à l’étranger. La Constitution algérienne contient d’ailleurs diverses dispositions qui sont interprétées dans ce sens comme son article 26 qui précise que « l’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples » et « s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques » ou son article 28 qui dispose que « l’Algérie œuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les États, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. » .
La défense des principes fondateurs de l’Algérie indépendante est donc encore une réalité aujourd’hui et empêche certainement ce pays de se donner les moyens d’une diplomatie active et entreprenante.
b. Un environnement régional tendu
À côté des limites « doctrinales » qui la caractérisent, la diplomatie algérienne est aussi confrontée à un environnement régional tendu qui exerce une pression certaine à ses frontières.
i. A l’Ouest, la rivalité structurelle avec le Maroc et la question du Sahara occidental
La rivalité entre l’Algérie et le Maroc remonte à la « guerre des sables », en 1963, née d’incidents à propos des frontières coloniales et dont le souvenir reste vivace chez les militaires algériens. Depuis ce conflit, Alger et Rabat n’ont cessé de diverger. Durant la guerre froide, par exemple, la république démocratique tiers-mondiste n’était pas dans le même camp que la monarchie ouverte et proche de l’Occident. Sur le plan économique, les modèles retenus par les deux États furent, dès le début, antinomiques et, sur le plan militaire, les doctrines et postures des deux « frères ennemis » étaient clairement distinctes(132) , ce qui a encore un impact sur l’organisation des armées respectives. Il n’y a qu’à voir, par exemple, aujourd’hui, l’équipement des forces aériennes de chaque État : là où l’Algérie s’approvisionne quasi exclusivement auprès de fournisseurs de l’ex URSS (Sukhoi 30, Mig 29, Yak 130…), le Maroc, lui, a longtemps fait confiance à la France et, plus récemment, s’est équipé de F16 américains qui en font l’un des pays les mieux équipés en Afrique du Nord.
Deux contentieux historiques douloureux empêchent aujourd’hui une normalisation des relations algéro-marocaines. Il y a d’abord un contentieux humain remontant aux années 70 à la suite de la dépossession de milliers d’Algériens de leurs terres agricoles au Maroc mais aussi de l’expulsion de plus de 300.000 Marocains d’Algérie, en 1975 après la « marche verte » décidée par le roi Hassan II (133). Le Sahara occidental constitue le second – et assurément le plus célèbre – contentieux entre l’Algérie et le Maroc. La question du statut du Sahara occidental est en effet non résolue depuis le départ de la puissance coloniale – l’Espagne –, en 1975 et oppose durablement un Maroc qui en revendique la souveraineté à une Algérie clamant le droit à l’autodétermination des Sahraouis et soutenant le Front Polisario.
|
La question du Sahara occidental 1884 : début de la colonisation espagnole. À terme, l’Espagne administre trois régions différentes : au nord, l’enclave de l’Ifni et la zone de Tarfaya ; au centre, la Seguiet-el-Hamra et, au sud, le Rio-de-Oro. 1958 : l’Espagne restitue au Maroc la zone de Tarfaya. Elle en fait de même, en 1969, avec l’enclave de l’Ifni. 1963 : « guerre des sables » entre l’Algérie et le Maroc. 1973 : constitution du Front populaire de libération de la Seguiet-el-Hamra et du Rio-de-Oro (Front Polisario) qui vise, dès 1974, à l’indépendance du territoire. 1974 : l’Espagne décide d’organiser un referendum d’autodétermination au cours du premier semestre de l’année 1975. Le Maroc s’y oppose et considère que le Sahara occidental doit lui revenir. L’Algérie soutient, elle, l’autodétermination. L’Assemblée générale des Nations unies saisit la CIJ (Cour internationale de justice). 1975 : le 16 octobre, la CIJ rend son avis, lequel indique que les liens juridiques anciens entre le territoire et le Maroc ne sont pas de nature à empêcher l’application du principe d’autodétermination. Le même jour, au soir, le roi Hassan II décide d’organiser une marche de 350.000 personnes sur El Ayoun (« la marche verte »), laquelle s’arrête quelques kilomètres après la frontière. Signature d’un accord tripartite (Espagne-Maroc-Mauritanie) le 14 novembre prévoyant la fin de la présence espagnole le 26 février suivant. Les troupes marocaines et mauritaniennes commencent à remplacer les soldats espagnols. 1976 : le 27 février, le Front Polisario proclame l’indépendance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et s’engage dans une guérilla contre les forces marocaines et mauritaniennes. 1979 : accord de paix entre le Front Polisario et la Mauritanie, laquelle retire ses troupes du Sahara occidental et reconnaît, en 1984, la RASD en tant qu’État. 1984 : adhésion de la RASD à l’Organisation de l’unité africaine (OUA) et, en réaction, départ du Maroc de cette dernière (à ce jour, le Maroc n’est toujours pas membre de l’Union africaine, qui a succédé, en 2002, à l’OUA). 1991 : en avril, création, par le Conseil de sécurité, de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). En septembre, cessez-le feu entre les belligérants. 1991-2013 : la MINURSO est prolongée d’année en année. |
Depuis trente-huit ans, le Sahara occidental est un abcès pour l’ensemble de la région. Officiellement entre les mains de l’ONU, il oppose régulièrement l’Algérie et le Maroc sur la scène internationale. Si, dans la foulée des évènements du « printemps arabe » de 2011, on a pu assister à un semblant d’accalmie avec la visite du ministre des affaires étrangères du Maroc en Algérie, début 2012, et l’échange de nombreuses visites techniques, le durcissement est à nouveau de mise. On l’a vu, en mai 2012, lorsque le Maroc a retiré sa confiance à M. Christopher Ross, envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental(134). On l’a également vu plus récemment lors de la tentative américaine d’étendre le mandat de la MINURSO au suivi des droits de l’homme(135). De surcroît, ces tensions sont à chaque fois exacerbées par des campagnes médiatiques hostiles de part et d’autre (136) et imposent aussi à notre diplomatie une prudence extrême, la France devant sans cesse composer avec cette dommageable rivalité(137).
Les conséquences les plus spectaculaires de ces contentieux persistants entre l’Algérie et le Maroc ont été la fermeture de la frontière entre les deux États mais aussi l’absence de véritable perspective d’intégration régionale au Maghreb. Ainsi la frontière algéro-marocaine n’est-elle restée ouverte, ces cinquante dernières années, que pendant 28 ans, de 1963 à 1974 et de 1975 à 1994. Peu d’indices semblent indiquer, aujourd’hui, sa réouverture prochaine, quand bien même la situation actuelle confine parfois au ridicule. Car alors que tant de pays se regroupent aujourd’hui en marchés communs ou en zones de libre-échange, le Maghreb, lui, reste ostensiblement à l’écart. Ainsi, « pour qu’une tomate marocaine se vende sur un marché algérien, il lui faut d’abord transiter par Marseille »(138). La boutade est cruelle mais malheureusement pas infondée. Pourtant, potentiellement, les instruments sont là. L’Algérie est membre de l’Union du Maghreb arabe, organisation économique formée par les cinq pays du Grand Maghreb. Par ailleurs, comme votre rapporteur l’a déjà souligné, l’Algérie est l’un des membres fondateurs du processus euro-méditerranéen de Barcelone lancé les 27 et 28 novembre 1995. Dans le prolongement de cette initiative, elle a également rejoint l’Union pour la Méditerranée (UpM) le 13 juillet 2008, sous l’impulsion de la France et de l’Égypte. L’Algérie est également membre depuis le 1er janvier 2009 de la Zone arabe de libre-échange (ZALE) ayant pour but la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre les États arabes. Il est plus que dommage qu’aucune de ces initiatives, bloquée ou ralentie par les tensions politiques, diplomatiques et économiques, ne parviennent à donner une portée concrète à la coopération et à l’intégration régionales dont le Maroc et l’Algérie pourraient être de remarquables moteurs comme la France et l’Allemagne l’ont été en l’Europe.
ii. A l’Est, des transitions sous surveillance
Comme votre rapporteur l’a précédemment souligné, le souvenir terrible de la décennie noire a beaucoup contribué à ce que l’Algérie ne s’aventure pas, comme la Tunisie, la Libye ou l’Égypte, dans un changement brutal de régime au cours de l’année 2011.
Pour de nombreux Algériens, les révolutions qui ont embrasé leurs voisins orientaux ont été perçues avec inquiétude – voire assez négativement – car synonymes d’instabilité pour la région. Ces expériences politiques renvoient en effet l’Algérie à sa propre histoire, celle de la fin des années 80 et du début des années 90 où, à la suite de l’interruption du processus électoral, le pays plongea dans une guerre civile des plus meurtrières.
Et les faits ne donnent peut-être pas tort à l’Algérie. La Libye, par exemple, est devenue une réelle source d’insécurité, pour le Maghreb et pour le Sahel dans leur ensemble, mais aussi, plus spécifiquement, pour l’Algérie puisque c’est du territoire libyen que se sont infiltrés les terroristes d’In Amenas. De même, la destitution du Président égyptien Mohamed Morsi, en juillet 2013, est également allée dans le sens des pourfendeurs du Printemps arabe – nombreux en Algérie – et a implicitement conforté le régime algérien qui, à plusieurs reprises, a mis en garde contre les risques de la « vague verte » consécutive aux révolutions de 2011.
L’évolution de la région est donc suivie avec la plus grande attention en Algérie, tant par les autorités, la presse que par la population. Votre rapporteur y reviendra plus tard mais ce pays semble être en attente, en position d’observateur privilégié d’une situation qu’il juge périlleuse et qu’il estime pouvoir apprécier avec justesse à l’aune de l’expérience de la « décennie noire ». Mais cette attente est remplie d’inquiétudes et constitue une source de pression supplémentaire sur l’Algérie et les Algériens.
iii. Au Sud, l’instabilité du Sahel
La région sahélienne constitue une source de préoccupation majeure qui alimente, elle aussi, grandement, les obsessions obsidionales de l’Algérie.
Pendant longtemps, cette dernière a eu un comportement envers la situation sécuritaire du Sahel pouvant, à certains égards, être considéré comme « ambigüe ». L’Algérie, en effet, a longtemps refusé catégoriquement que toute puissance étrangère – notamment occidentale – puisse intervenir aux marges de son flanc sud. La France était notamment visée, tant en raison du poids de l’histoire qu’à cause d’un prétendu « agenda caché » inavouable(139). Elle a ainsi, pendant plusieurs années, insisté sur la nécessité d’une solution politique sans pour autant en fournir les clefs. De même, elle a tenté, sans succès, d’affirmer son « leadership » dans la coordination des efforts régionaux dans la lutte contre AQMI et les autres groupes terroristes, arguant, entre autres, de sa réussite dans leur éradication sur son sol. Elle fut ainsi à l’initiative de l’installation du CEMOC – comité d’état-major conjoint (140) – à Tamanrasset, en avril 2010 mais cette structure, bien qu’unique en Afrique, ne donna aucun résultat tangible. Comme avaient pu l’analyser nos collègues François Loncle et Henri Plagnol dans leur rapport d’information intitulé « Le Sahel pris en otage », publié à la fin de la XIIIème législature, il n’était pas inenvisageable de voir dans l’attitude de l’Algérie un double, voire un triple langage(141). Car, tout en assurant prendre au sérieux la menace terroriste sur son flanc sud, ce pays n’en prenait pas moins des actions allant dans un sens contraire. Par exemple, le « pari » algérien sur Ansar Eddine a pu soulever de légitimes interrogations(142). Il était également frappant de constater que l’organisation géographique de l’outil militaire algérien, de loin le plus important de la région, était entièrement tournée vers la « menace » marocaine et non vers la frontière méridionale.
Les autorités algériennes se sont rapidement adaptées à la nouvelle donne créée par l’opération Serval en assouplissant leurs positions traditionnelles hostiles à toute interférence étrangère dans la région. L’Algérie autorisa ainsi le survol de son territoire par nos avions et par ceux de nos alliés. Elle contribua également à la fourniture de carburant à nos troupes et cette aide fut des plus précieuses lorsque nos soldats combattaient, dans des conditions difficiles, dans des zones proches de la frontière algéro-marocaine.
Ainsi que votre rapporteur l’a souligné dans la première partie, cette coopération a été « spectaculaire » car inimaginable encore quelques semaines auparavant et a sans doute été rendue possible par le réchauffement des relations entre la France et l’Algérie consécutif à la visite d’État du président Hollande. Pour autant, laisse-t-elle présager un changement durable d’attitude de la part de l’Algérie sur la question sahélienne? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire mais nul doute que cette dernière va demeurer une source d’inquiétude vive pour les autorités algériennes, d’autant plus que, pour certains, l’opération Serval n’a fait qu’illustrer « l’incapacité de l’Algérie à sécuriser son environnement régional »(143). En tout état de cause, l’évolution de l’influence de l’Algérie sur la région, la stabilité des États du champ, le sort des Touareg (144), la dissémination des djihadistes dans les pays environnants… sont autant de paramètres qui vont, encore plus qu’avant, structurer la diplomatie algérienne dans les mois et les années à venir.
C. 2014 ET APRÈS ?
1. Un exercice prospectif délicat
Si la mission d’information a essayé de s’interroger sur l’évolution de l’Algérie dans les mois et les années, votre rapporteur doit avouer que l’exercice s’est révélé fort difficile et que nulle certitude n’est ressortie de ses travaux.
Tout d’abord, comme cela a déjà été précisé, prendre la mesure exacte du système politique algérien est loin d’être aisé et passe par de subtiles et peu accessibles « clefs de compréhension ». La plupart des interlocuteurs de la mission – y compris ceux dont on aurait pu croire qu’ils auraient pu avoir, de par leur fonction ou leurs travaux, une connaissance exacte de la réalité – ont fait part de leurs doutes face à la situation politique algérienne et de leurs difficultés à l’appréhender correctement. La relative opacité du système mais aussi son fonctionnement collégial et ne recoupant pas forcément les institutions officielles, contribuent beaucoup à compliquer toute réflexion sur le devenir de l’Algérie. Une des personnes auditionnées par la mission est allée jusqu’à prétendre, non sans humour, que cette dernière ferait mal son travail si elle devait parvenir à une compréhension parfaite du système algérien. Il y a malheureusement du vrai dans cette boutade.
Il faut dire que plusieurs « précédents » plaident en faveur de la plus grande prudence. Ces dernières années ont été émaillées de « surprises » politiques que peu de spécialistes avaient prévues. Le Printemps arabe de 2011 et la révolution tunisienne, par exemple, ont pris de court nombre d’observateurs pourtant parmi les plus avertis, de la même manière qu’il y a vingt-quatre ans, la chute du Mur de Berlin surprit la plupart des spécialistes. Il suffit de se rappeler les premières réactions des autorités françaises de l’époque face à la « révolution de jasmin » pour se rendre compte de la difficulté d’anticiper correctement l’évolution récente des pays nord-africains.
En ce qui concerne plus spécialement l’Algérie, l’actualité de la seule année 2013 a montré que, là aussi, il était vain de vouloir prédire avec acuité l’évolution, de ce pays. L’attentat d’In Amenas, le 16 janvier 2013, a créé une nouvelle donne en plaçant une épée de Damoclès sur la production d’hydrocarbures du pays alors même que celle-ci n’avait jamais été touchée durant toute la décennie noire. Sur le plan politique, un événement inédit – et inimaginable il y a encore quelques temps – s’est produit : la publication dans El Watan, le 18 février, d’une lettre ouverte d’un ancien vice-président de la Sonatrach au général Mediène, surnommé « Toufik », le chef du DRS, accusant celui-ci d’avoir mise en coupe réglée l’Algérie dans le but d’en capter une partie de la rente. Plus récemment, à la fin du mois de juin 2013, l’ambassadeur d’Algérie en France, a été remercié de manière inattendue et sans ménagement. Cette décision – qui pourrait être relativement banale dans la plupart des pays – prend un tour particulier en Algérie lorsqu’on sait que le poste d’ambassadeur à Paris est parmi les plus élevés de la carrière diplomatique et qu’il est traditionnellement dévolu à une personnalité très proche du chef de l’État. Enfin, les problèmes de santé du président Bouteflika, sur lesquels votre rapporteur va revenir, ont également marqué l’actualité de la vie politique algérienne de ces derniers mois. Ces événements et faits politiques étaient peu prévisibles en début d’année. Ils traduisent le bouillonnement actuel du pouvoir et de la société algériens, lesquels imposent la plus grande modestie dans toute esquisse de scenario quant au futur – y compris proche – de l’Algérie.
2. Une équation électorale à trois inconnues
a. Quand ?
Aux termes de l’article 74 de la constitution algérienne, « la durée du mandat présidentiel est de cinq ans ». Réélu à la tête du pays le 9 avril 2009, le mandat d’Abdelazi Bouteflika s’achèvera donc dans quelques mois, en avril 2014. Les problèmes de santé du chef de l’État algérien qui ont conduit à son séjour en France, du 27 avril au 16 juillet 2013, laissent toutefois planer un doute quant à la date des prochaines élections présidentielles. « Entre des versions officielles angéliques distillées à dose homéopathique, et les versions alarmistes que répandent certains médias français et algériens, il est difficile de se forger une opinion »(145).
Quoiqu’il en soit, la question de la santé du Président Bouteflika est aujourd’hui impossible à éluder. Si le secret qui l’entoure est total, la longue absence du chef de l’État puis son relatif effacement de la scène politique sont devenus le prisme d’analyse de tout événement ou de toute décision prise par les autorités algériennes. Ils ont conduit à ce que se diffusent de nombreuses rumeurs mais ne semblent pas troubler la vie quotidienne des Algériens, lesquels ne vivent pas ici une situation inédite puisque l’état de santé de leur président a déjà pu poser problème par le passé, comme en 2005 lorsque Abdelaziz Bouteflika avait dû être hospitalisé au Val de Grâce.
En tout état de cause, s’il devait y avoir une élection anticipée, ce serait en application de l’article 88 de la constitution algérienne, lequel dispose que « lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement ». Après s’être prononcés aux deux tiers, les parlementaires confient alors la charge de président par intérim au président du Conseil de la Nation, la seconde chambre du Parlement, pour une durée maximale de 45 jours. Si, à l’issue de ce délai, l’incapacité du chef de l’État se poursuit, « il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit » et de nouvelles élections présidentielles doivent alors être organisées. En cas de démission ou de décès du président de la République, « le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’État pour une durée maximale de soixante jours (146) », une période durant laquelle un nouveau scrutin a lieu.
Toutefois, le scénario d’une élection anticipée ne s’est jamais réellement imposé. Comme la mission d’information a pu s’en rendre compte au cours de ses travaux, un vote avant avril 2014 semble peu probable en raison notamment des doutes qui entourent le choix des futurs candidats, sur lesquels votre rapporteur va revenir. De surcroît, plusieurs décisions prises par le président Bouteflika au cours de l’été 2013 semblent témoigner du maintien de son influence sur la conduite des affaires (147) et éloignent, elles aussi, la perspective d’un scrutin avant la date prévue par la constitution.
b. Qui ?
Que les prochaines élections présidentielles algériennes aient lieu en avril 2014 ou avant, qui sera candidat ?
Au moment de la publication du présent rapport, un seul candidat s’est déclaré : il s’agit d’Ahmed Benbitour, chef du gouvernement de décembre 1999 jusqu’au 26 août 2000, date de sa démission survenue en raison d’importantes divergences avec le président de la République. La mission d’information a eu l’occasion de le rencontrer lors de son déplacement à Alger, le 26 mars dernier. Il a dressé un tableau assez sombre de la situation actuelle de son pays et a fait part de son programme s’articulant autour de quatre axes principaux : la refondation de l’État – passant notamment par la restructuration des administrations centrale et locales mais aussi par la lutte contre la corruption –, la refondation de l’école, celle de l’économie et la promotion des compétences nationales. D’après les informations recueillies par les membres de la mission d’information mais aussi à la lecture de la presse algérienne, les chances de M. Benbitour paraissent aujourd’hui relativement faibles eu égard à son poids politique semble-t-il assez réduit dans le régime algérien actuel avec lequel, au demeurant, il s’est montré très critique(148).
Aux côtés de cette candidature déclarée, plusieurs noms ont été évoqués par la presse algérienne.
Longtemps incertaine puis compromise par des ennuis de santé, l’hypothèse d’une nouvelle candidature du Président Bouteflika est réapparue dans les médias algériens au mois de septembre 2013. Dans un premier temps, l’élection précipitée et controversée, au cours du mois d’août, de M. Amar Saadani comme secrétaire général du FLN – un poste qui était vacant depuis huit mois – fut interprétée comme une signe de reprise en main de la part du camp présidentiel : ancien président de l’Assemblée populaire nationale de 2004 à 2007, Amar Saadani est réputé être un proche d’Abdelaziz Bouteflika(149). Dans la foulée de cette élection à la tête de la principale formation politique du pays, le chef de l’État a, pour la première fois depuis son hospitalisation, reçu des responsables étrangers (150) et a procédé à un important remaniement ministériel, le 11 septembre 2013. Si le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a été maintenu dans ses fonctions, plusieurs changements sont intervenus, notamment au sein des ministères régaliens : le général Ahmad Gaïd Salah, jusqu’alors chef d’état-major de l’armée, a été nommé vice-ministre de la défense nationale (151) tout en conservant ses précédentes fonctions ; le président du Conseil constitutionnel, M. Tayeb Belaïz, a été nommé ministre de l’intérieur ; M. Ramtane Lamanra, ancien ambassadeur aux États-Unis et aux Nations unies, a remplacé M. Mourad Medelci – nommé président du Conseil constitutionnel – au poste de ministre des affaires étrangères et M. Taïeb Louh, ancien ministre du travail, a été nommé à la Justice. Comme le nouveau secrétaire général du FLN, ces quatre hommes sont des proches du président Bouteflika et leur nomination, pour une grande partie de la presse, « trahit la volonté manifeste de son architecte de lancer une bataille électorale » (152), que ce soit dans la perspective d’un nouveau mandat ou dans celle de pouvoir choisir sans entrave son successeur voire de s’engager dans une voie qui, longtemps envisagée, semblait pourtant peu probable il y a encore quelque semaines : celle d’une révision de la constitution qui rétablirait la limitation du nombre de mandats présidentiels (153) et allongerait la durée de celui-ci à sept ans avec, le cas échéant, la création d’un poste de vice-président. Ce scénario pourrait ainsi permettre au président Bouteflika d’achever son mandat tout en retardant le choix d’un successeur. Votre rapporteur, de surcroît, relève que l’hypothèse d’une « reprise en main » du camp présidentiel est renforcée par la décision du chef de l’État de réduire les prérogatives du DRS en lui retirant ses pouvoirs de police judiciaire, le privant ainsi d’une de ses principales capacités d’agir(154).
Par ailleurs, plusieurs noms ont, à ce jour, été évoqués par la presse algérienne pour succéder à Abdelaziz Bouteflika, le principal critère pour figurer dans cette liste étant l’aptitude à incarner le meilleur compromis acceptable pour le « système » mais aussi la population. Abdelmalek Sellal, le Premier ministre actuel, Cherif Rahmani, ministre de l’industrie jusqu’au 11 septembre dernier(155), Ahmed Ouyahia, à la tête du gouvernement jusqu’en septembre 2013, mais aussi Mouloud Hamrouche, et Abdelaziz Belkhadem, respectivement premiers ministres de 1989 à 1991et de 2006 à 2008, ont ainsi, à un moment ou un autre, été cités comme d’éventuels présidentiables. Le nom d’Ali Benflis, chef du gouvernement 2000 à 2003, est lui aussi revenu avec insistance au cours des derniers mois mais, pour de nombreux observateurs, le remaniement ministériel du 11 septembre dernier a considérablement abaissé sa côte(156). Quoiqu’il en soit, cette liste est assurément loin d’être close et on ne peut exclure qu’un ou plusieurs noms vienne s’y ajouter.
A ce stade, rien ne permet donc de savoir qui sera le candidat le mieux placé lors de la prochaine élection présidentielle. Comme votre rapporteur va avoir l’occasion de le souligner à la fin du présent rapport, une atmosphère d’attente prévaut en Algérie où, depuis quelques mois s’est engagé un processus de recomposition du paysage politique sans que n’émerge une personnalité dont on saurait quasiment à coup sûr qu’elle aurait vocation à être le prochain chef d’État. Les deux principales forces du pays, le Front de Libération Nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND), traversent des turbulences. La première, au cours du mois d’août, a élu un nouveau secrétaire général dans de conditions très contestées. La seconde n’en a toujours pas (157). Deux autres partis, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) éprouvent encore des difficultés à l’issue du départ de leurs fondateurs respectifs, Hocine Aït Ahmed et Saïd Sadli. Du côté des islamistes, en revanche, le Mouvement de la société pour la paix – qui, pendant longtemps, a accepté de faire partie de la coalition gouvernementale jusqu’à ce que le printemps arabe de 2011 porte des partis islamistes au pouvoir, dans les pays voisins – est dirigé, depuis le 5 mai dernier, par Abderrazak Mokri. Ce dernier, que la mission d’information a pu rencontrer, à Alger, le 25 mars dernier, bénéficie du soutien de Rached Ghannouchi, le chef du parti tunisien Ennahda (158) et a appelé les partis de la même sensibilité que le sien à se rassembler autour d’une candidature unique à la prochaine élection présidentielle(159).
A quelques mois de la prochaine élection présidentielle en Algérie, le flou est encore total. Observateur attentif de la vie politique algérienne le journal Jeune Afrique a tenté de dresser le portrait-robot du candidat « idéal » : « Plus jeune, donc n’appartenant pas à la génération de l’indépendance qui dirige le pays depuis 1962 ; suscitant l’espoir sans s’attaquer brutalement au fameux « système », comme l’appellent les Algériens, et aux multiples intérêts en jeu ; moderne et ouvert sans pour autant s’aliéner les islamistes modérés ou les conservateurs ; originaire d’une autre région que le Nord-Ouest frontalier du Maroc d’où sont issus nombre de caciques du régime ; expérimenté mais indépendant ; enfin, aucunement éclaboussé par la ribambelle de dossiers de corruption qui ont fleuri ces derniers mois et visaient – comme par hasard – l’entourage du chef de l’État. Last but not least, cet oiseau rare devra obtenir le parrainage des jumeaux nationalistes, décapités mais toujours influents, que sont le Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND) »(160).
Votre rapporteur tient à souligner qu’au-delà de l’élection présidentielle, deux autres désignations vont revêtir un enjeu tout aussi déterminant – si ce n’est plus eu égard à la relativité de l’autorité des institutions politiques officielles en Algérie – dans les années à venir : il s’agit des remplacement, à terme, du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général Ahmed Gaïd Salah (qui occupe ce poste depuis 2004 et vient d’être également nommé vice-ministre de la défense) et du général Médiène (en fonction depuis 1990), qui dirige le DRS et qui, assurément, détiennent une part importante du destin algérien dans leurs mains.
c. Comment ?
Aux côtés de la date et du nom des candidats – notamment du candidat « officiel » –, les conditions d’organisation du prochain scrutin présidentiel sont également une des inconnues de l’équation électorale algérienne.
Les élections seront-elles libres, pluralistes et transparentes ? La plupart des interlocuteurs de la mission d’information ont émis des doutes quant au degré réel de la sincérité du prochain scrutin. Ils ont notamment souligné le pourcentage de voix recueilli à chaque fois par Abdelaziz Bouteflika lors des précédentes échéances (161) et ont indiqué que, selon eux, le régime algérien n’était pas encore prêt à aller vers un scrutin parfaitement « ouvert », et ce, quand bien même des observateurs internationaux seront présents le jour du vote(162). La presse algérienne se montre elle aussi pessimiste comme l’ont par exemple montré les principaux éditoriaux des grands quotidiens qui ont fait suite au remaniement ministériel du 11 septembre dernier.
Par ailleurs, le taux de participation sera un paramètre qu’il conviendra de suivre avec attention. Votre rapporteur a eu l’occasion de relever sa faiblesse récurrente, due notamment à la perte de confiance de bon nombre d’Algériens dans leurs représentants et dans l’inefficacité de la sphère politique à régler le problème. Officiellement de 74 % aux élections présidentielles de 2009 et de 43 % aux élections législatives de 2012(163), le taux de participation sera-t-il inférieur lors du prochain scrutin ?
In fine, il apparaît clairement que la prochaine élection présidentielle revêt un enjeu fondamental pour l’avenir de l’Algérie. Et cet enjeu est primordial car les difficultés qu’éprouve aujourd’hui l’Algérie et évoquées précédemment ne sauraient perdurer et être réglées pacifiquement sans un pouvoir politique ayant la pleine confiance du peuple algérien. Peut-être le scrutin à venir permettra-t-il l’élection d’une personnalité qui sera à même d’impulser les réformes nécessaires, quand bien-même cette élection ne sera pas des plus ouvertes et conservera des caractéristiques semblables aux précédentes ? Il est encore trop tôt pour le dire mais il apparaît désormais que les mois à venir vont être déterminants pour l’avenir de l’Algérie mais aussi, plus largement, pour celui de la région.
3. Un pays en attente
Si l’exercice prospectif n’est pas chose aisée et si, comme votre rapporteur vient de le décrire, l’avenir politique de l’Algérie est encore difficilement prévisible, un constat s’impose toutefois : l’Algérie, aujourd’hui, semble être un pays en attente. Votre rapporteur a déjà eu l’occasion d’évoquer cette idée mais, face aux révolutions arabes et aux troubles qui émaillent la Libye, l’Égypte et, à un degré moindre, la Tunisie, l’Algérie ne préfère-t-elle pas observer ses voisins et mesurer les difficultés qu’ils éprouvent au lieu de s’aventurer dans une voie dont elle connaît trop bien les dangers ? Il est vrai que l’impact de la décennie noire dans la mémoire collective des Algériens est impressionnant et, on l’a vu, il est l’un des facteurs– peut-être le plus déterminant – qui ont fait que le Printemps arabe de 2011 n’a pas eu, en Algérie, le même succès que dans les pays alentours.
À l’issue de ses travaux, la mission d’information a ainsi le sentiment que les Algériens font en ce moment preuve d’une grande prudence, ce qui peut permettre d’envisager que le pays ne va pas connaître de profondes et brutales évolutions dans les mois à venir.
Cette prudence est manifeste en ce qui concerne les rapports de l’Algérie avec ses voisins où l’exercice du pouvoir par les islamistes – seuls ou en coalition – est observé avec attention et tend à faire figure d’épouvantail et à dissuader bon nombre d’Algériens de se lancer dans une transition politique en dehors du cadre actuel. Le renversement du président Morsi a ainsi conduit plusieurs journaux algériens, essentiellement les francophones, à voir dans ces événements un échec de l’islam politique – valant tant pour le Maghreb en général que pour leur pays en particulier – mais aussi un argument de poids en faveur du régime algérien. Ainsi, pour beaucoup, les chances des islamistes d’arriver au pouvoir en Algérie ont fortement diminué en raison de l’incapacité de ceux-ci de gouverner sereinement et efficacement dans les Etats nord-africains. L’exemple tunisien est lui aussi observé avec scepticisme. Outre les lâches assassinats de Chokri Belaïd, le 6 février 2013, et de Mohamed Brahimi, le 25 juillet 2013, mais aussi les divers troubles qui émaillent durablement la Tunisie, les longs débats, sur la future constitution de ce pays et sur la place de l’islam dans celle-ci ont reçu un accueil généralement hostile de la part de nombreux Algériens, les confortant dans l’idée qu’un « printemps arabe » n’était décidemment pas la bonne réponse à apporter aux problèmes rencontrés par leur pays.
Cette prudence se traduit aussi, sur le plan intérieur, par le ralentissement du processus de réformes engagé par le président Bouteflika, le 15 avril 2011, notamment son volet « constitutionnel ». La commission qui est chargée de préparer une révision de la Constitution n’a été installée que le 8 avril dernier soit, près de deux ans après l’annonce de la réforme par le chef de l’État(164). Par ailleurs, si, en principe, elle pourra se prononcer sur tous les sujets – à l’exception de ceux relatifs « aux constantes nationales et aux valeurs et principes fondateurs de la société algérienne qui incarnent sa longue histoire, sa civilisation millénaire et une vision d’avenir portée par des valeurs et principes partagés par l’ensemble des citoyens algériens »(165) – cette commission semble être étroitement encadrée puisqu’elle doit débattre à partir d’un document de base élaboré par le président de la République, lequel appréciera également la suite à donner aux conclusions auxquelles elle aboutira. Sur le fond, aucune information ne permet de déterminer quelle direction prendra une éventuelle révision constitutionnelle. La délégation de la mission d’information qui s’est rendu à Alger au mois de mars 2013 a essayé, à plusieurs reprises, d’obtenir des précisions tant sur les idées en débat que sur le calendrier de la réforme mais aucun interlocuteur ne fut en mesure d’y répondre.
En dépit des manifestations et revendications quotidiennes, que votre rapporteur a déjà eu l’occasion de relever, l’Algérie paraît donc être, en ce moment, dans une phase quelque peu particulière où aucune décision majeure ne semble devoir être prise, tant ce pays appréhende de s’engager dans une voie qui pourrait, in fine le conduire à perdre sa remarquable stabilité dans un environnement régional qui en est largement dépourvu. Pour autant, il convient de rester prudent car le probable n’est jamais certain. Cette prudence et cette attente ont également des relents de « veillée d’armes », à quelques mois d’une échéance électorale que les ennuis de santé du président Bouteflika, on l’a vu, contribuent à rendre encore plus incertaine.
Inévitablement, cette attitude attentiste ne peut qu’interpeller les partenaires de l’Algérie, lesquels, à l’image de la France, sont eux aussi en attente face aux évolutions futures de ce pays. Pour nous, Français, le devenir de l’Algérie est aujourd’hui un enjeu national et nous ne pouvons en aucun cas rester indifférents face à son évolution. Plus largement, c’est aussi une des clefs de la stabilité, de la prospérité et de la sécurité du Maghreb, une clef à laquelle nous devrons prêter la plus grande des attentions.
CONCLUSION
L’Algérie est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Ce pays resté à l’écart des « révolutions arabes » est confronté à de nombreuses difficultés. Assurément, il y a un « mal vivre » algérien constitué, entre autres, d’un fort sentiment de défiance à l’égard du politique et se manifestant par de fréquentes « poussées de fièvre » au sein de la population. De même, le modèle économique suivi par ce pays suscite de légitimes interrogations quant à sa viabilité eu égard aux nombreux blocages qui l’affectent et le pénalisent.
La mission d’information a souhaité aborder de la manière la plus objective qui soit ces problèmes dont la plupart, d’ailleurs, sont connus et reconnus par les autorités algériennes. Sa démarche a été des plus sincères. Jamais la mission n’a voulu s’immiscer dans les affaires intérieures algériennes en préconisant telle ou telle solution. Elle a tout simplement voulu décrire certaines des difficultés auxquelles est confrontée, aujourd’hui, l’Algérie, sans oublier de souligner, bien sûr, ses indéniables atouts comme son potentiel touristique exceptionnel ou la force de sa jeunesse.
Pays sous pression, l’Algérie évoluera-t-elle et, si oui, dans quelle direction ? La mission d’information s’est posé maintes fois ces questions sans pour autant parvenir à une réponse ferme et définitive. 2014, toutefois, peut être une année décisive avec le rendez-vous électoral prévu au printemps.
En tout état de cause, l’avenir de l’Algérie revêt un enjeu majeur. Pour le pays et ses habitants bien évidemment, lesquels peuvent légitiment aspirer à des évolutions notables. Pour la région et pour l’ensemble du bassin méditerranéen, ensuite, vis à vis desquels l’Algérie fait figure de « poids lourd » et détient une partie des clefs de nombreux problèmes, que ce soit en matière sécuritaire, migratoire ou énergétique. Enfin, c’est également une question qui doit intéresser au plus haut point notre pays de par l’intensité qu’atteignent, désormais, les liens entre la France et l’Algérie.
En effet, ces liens sont uniques. Comme a pu le déclarer le Président de la République lors de sa visite d’État de décembre 2012, « la proximité entre l’Algérie et la France n’est pas une incantation prononcée à chaque voyage d’un président de la République française en Algérie ». Ce « n’est pas une abstraction, n’est pas une construction elle est une réalité. Elle se fonde sur des liens intimes, profonds, uniques pour la France comme pour l’Algérie ».
Ces liens, la mission d’information a pu en mesurer l’importance. Il y a bien sûr l’histoire, qui, parfois très pesante, continue d’imprimer sa marque sur la relation bilatérale. Il y a aussi cet extraordinaire « espace commun » qui s’est construit entre les deux pays, lequel repose, notamment, sur un lien démographique dense et dynamique. De chaque côté de la Méditerrané, des hommes et des femmes font battre le cœur de cette relation si spéciale et sont en attente de décisions permettant de faciliter les échanges. Au-delà, la relation franco-algérienne se caractérise par de multiples intérêts convergents comme peut l’être, par exemple, la sécurité. La France et l’Algérie connaissent tous deux la menace terroriste et expriment la même détermination dans le combat contre ce fléau. En matière économique, ils font face à des défis similaires et la complémentarité de leurs économies plaide en faveur de solutions communes innovantes comme la « colocalisation ».
Pour toutes ces raisons, la France et l’Algérie ne peuvent se tourner le dos. Volens nolens, leurs destins sont entremêlés et cette situation exceptionnelle appelle, dans bien des domaines, des solutions concertées et, donc, une coopération étroite et renforcée. À cette fin, la mission a souhaité mettre en valeur ou préconiser des initiatives fortes qui lui tiennent à cœur.
Par exemple, en ce qui concerne la dimension humaine de la relation, il lui semble indispensable d’engager ou de poursuivre les efforts déjà entrepris en faveur d’une meilleure circulation des personnes entre les deux pays, en facilitant, du côté français, l’octroi de visas de circulation pour les populations ne présentant aucun risque migratoire et en invitant les autorités algériennes à en faire de même à l’égard de nos compatriotes souhaitant se rendre et s’installer en Algérie. De même, il convient d’entreprendre, sans tarder, l’indispensable modernisation des conventions franco-algériennes relatives à la coopération en matière judiciaire, rendue nécessaire par l’importance croissante de l’espace démographique commun aux deux pays.
Sur le plan de la mémoire, la mission n’a pas entendu se prononcer sur les polémiques qui, malheureusement, émaillent la relation bilatérale. Elle a conscience qu’en dépit des progrès récents, cette dernière n’est pas pleinement et irréversiblement apaisée et que sa normalisation prendra du temps car on ne peut pas facilement mettre un terme à plus de 130 ans de liens aussi complexes, qui relèvent tant de l’attirance que, parfois, de la répulsion et qui sont indéniablement uniques. Aussi, dans l’immédiat, une approche progressive et pragmatique – une approche des « petits pas » – est incontournable et, dans cet esprit, la mission recommande d’associer étroitement l’Algérie, si elle le souhaite, aux cycles commémoratifs des deux guerres mondiales du XXème siècle qui va avoir lieu tout au long de l’année 2014.
La mission d’information a également accordé une place toute particulière à la jeunesse algérienne qui, peut-être plus qu’ailleurs, est une des clefs qui permet de mieux comprends le pays aujourd’hui. Des initiatives ont déjà été prises par les deux gouvernements telle celle consistant à développer un réseau d’instituts d’enseignement supérieur et technologique à travers l’Algérie. La mission recommande d’aller plus loin et de créer un Office franco-algérien de la jeunesse, à l’image des deux offices qui existent déjà avec l’Allemagne et le Québec. De même, accroître la présence algérienne dans les universités françaises est une nécessité. Cela passe par une politique de visas plus adaptée et un effort en matière de bourses.
Véritable « butin de guerre » comme a pu le décrire le poète algérien Kateb Yacine et, incontestablement, premier vecteur des échanges entre les deux rives, la langue française doit être soutenue. Le réseau de l’Institut français est un outil exceptionnel qui mène un travail remarquable. Il conviendrait peut-être de le soutenir en envisageant la création d’un nouveau centre pour tirer conséquences de l’impossibilité de rouvrir l’Institut français de Tizi-Ouzou. Par ailleurs, à défaut d’une adhésion de l’Algérie à l’Organisation internationale de la francophonie, ne pourrait-on pas envisager une association, par un statut adapté, de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation algériens aux travaux de l’Assemblée parlementaire de la francophonie ?
Poursuivant son analyse, la mission d’information a apporté une attention toute particulière à la relation économique franco-algérienne, laquelle revêt un énorme potentiel en dépit des difficultés constatées. Nos entreprises comme la plupart des investisseurs étrangers se heurtent à certains obstacles dont semblent d’ailleurs conscientes les autorités algériennes. Tout naturellement, la mission n’a pas souhaité s’ingérer dans les affaires de ce pays en proposant une réforme plutôt qu’une autre. L’Algérie doit cependant savoir qu’elle peut compter sur la France pour avancer dans ce domaine comme le montrent les nombreuses initiatives qui ont été prises en la matière, ces derniers mois, et qui tendent à approfondir les partenariats économiques entre les deux pays. À cet égard, une fois la mission de M. Jean-Pierre Raffarin parvenue à son terme, le maintien de la fonction de « représentant spécial pour les relations économiques franco-algériennes », qui a montré tout son intérêt ces dernières années, devra être envisagé.
Enfin, dans le domaine de la sécurité, un pas doit être franchi, dans la foulée des avancées constatées au début de l’année 2013 au plus fort de la crise malienne. Dans cette perspective, il faut développer la coopération militaire bilatérale dans le cadre de l’accord franco-algérien conclu en juin 2008 et entré en vigueur en février 2013 qui, s’il est mis en œuvre avec volontarisme, peut ouvrir des perspectives prometteuses dans cet important secteur.
Telles sont les principales recommandations de la mission.
Et si en décembre dernier, la France et l’Algérie ont signé une déclaration d’amitié, il leur appartient, maintenant, de la cultiver.